Votre panier est actuellement vide !
Étiquette : femmes
-
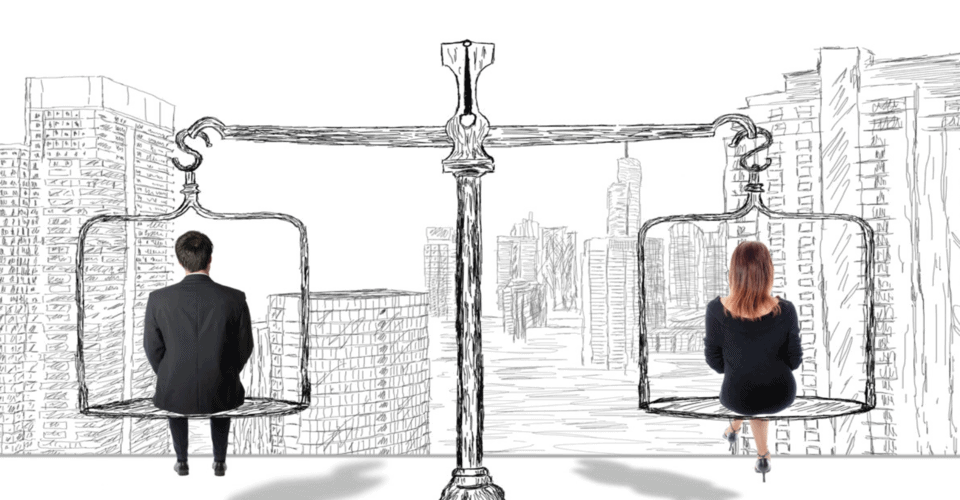
Les inégalités au travail : continuons le combat !
Si l’on entend beaucoup parler de l’égalité hommes/femmes dans le monde du travail, disons-le d’emblée, nous en sommes encore très loin !
Le constat est sans appel…
Certains secteurs et métiers sont encore aujourd’hui toujours réservés à la gent masculine. Et c’est sans parler des inégalités salariales…
Dans cet article, je vais juste tenter de faire le point sur la condition des femmes dans le monde professionnel. Tout d’abord je ferai un petit retour en arrière. Ensuite, j’évoquerai le monde d’aujourd’hui, et ce que nous pouvons espérer dans l’avenir.
Mais qu’appelle-t-on égalité hommes/femmes ?
Quels sont les critères utilisés pour la mesurer ? Il y en a quatre :
- L’obligation d’égalité salariale entre hommes et femmes
- L’interdiction à la discrimination à l’embauche,
- L’obligation d’égalité dans le déroulement de carrière,
- Et enfin l’obligation de parité dans les conseils d’administration.

Quelle était la situation des femmes d’hier ?
Avant 1945, la plupart des femmes étaient professionnellement inactives.
Ce n’est qu’après la fin de la seconde guerre mondiale que le pourcentage de femmes qui travaillent a commencé à augmenter progressivement. Les femmes se divisent alors en deux groupes : celles qui travaillent toute leur vie et celles qui alternent entre vie professionnelle et vie de femme au foyer. C’est à partir des années 70, que l’on observe une continuité de l’activité professionnelle. À partir de cette date, et pour encourager les femmes à s’insérer encore plus dans la vie active, plusieurs lois sont votées. Les principales sont :
- En 1972, est proclamée l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
- En 1983, l’égalité professionnelle
- En 1986, une circulaire qui préconise la féminisation des termes de métiers, grades et une politique volontariste. Le but est de diminuer les discriminations dont sont encore victimes les femmes au travail.
Qu’en est-il, aujourd’hui, de cette volonté à l’égalité hommes/femmes au travail ?
Quel est le constat aujourd’hui ?
Aujourd’hui, et fort heureusement, il est ancré dans les esprits (la plupart) qu’il est normal qu’une femme travaille au même titre qu’un homme. En revanche, force est de constater qu’il existe encore de nombreuses différences.
Déjà, il existe une disparité importante dans la nature des métiers exercés. De nombreux métiers sont quasiment exclusivement féminins (sage-femme, assistante maternelle, aide-soignante, etc.). Certes la situation évolue, mais que c’est lent… !
La présence croissante des femmes dans certains métiers dits « d’hommes »
En effet, les femmes sont de plus en plus présentes dans des métiers auparavant réservés exclusivement aux hommes. Elles ont eu accès au fil du temps à des postes de cadres, d’ingénieurs et aussi aux professions libérales, par exemple. Elles sont aussi de plus en plus représentées comme commerciales, leurs atouts dans les négociations ayant été reconnus. Elles seraient même meilleures négociatrices que les hommes !
Mais certains secteurs et métiers restent exclusivement masculins
Par choix ou par la force des choses
Certains secteurs comme le bâtiment, l’énergie, l’informatique, l’électronique, la mécanique et des métiers physiques comme manutentionnaire, bûcheron, maçon, reconnaissons-le, n’attirent pas les femmes. Ces derniers étant très physiques, voire même « trop », peu de femmes y postulent.
Et dans les autres secteurs ?
Si certaines femmes font le choix de ne pas se diriger vers certains secteurs ou métiers, qu’en est-il des autres ? Bien que les femmes semblent faire leur place dans des métiers jusqu’ici encore très « masculins », le chemin paraît encore long dans certains domaines pourtant « accessibles » comme la politique, l’entrepreunariat et les postes à responsabilité. La « parité hommes/femmes » pour accéder à ses métiers est encore loin d’être une évidence.
Une situation qui s’améliore mais des inégalités qui persistent …
Le plafond de verre
Selon la Banque Mondiale, la France fait partie des six pays du monde où les droits des femmes sont les plus respectés. Dans les faits, c’est beaucoup moins rose !
En effet, malgré une place croissante des femmes dans le monde du travail, elles restent encore largement minoritaires aux postes de décisions (cadres, entrepreneurs, politiques…). Il existe, en effet, ce que l’on appelle le « plafond de verre » ou encore « glass ceiling » qui entrave leur carrière. Cette expression, apparue aux États-Unis à la fin des années 1970, décrit l’ensemble des obstacles que rencontrent les femmes dans leur chemin pour accéder à des postes à responsabilités ou plus généralement dans des postes plus élevés dans la hiérarchie professionnelle. Je vous conseille la lecture de cet excellent article si vous voulez en savoir plus : https://www.scienceshumaines.com/peut-on-en-finir-avec-le-plafond-de-verre_fr_22408.html.

Pire encore, nombreuses sont celles qui ont été confrontées à ce que l’on appelle « la promotion canapé »… C’est-à-dire qu’elles ont dû « coucher » pour bénéficier d’une évolution. Même si ce sujet est plutôt tabou, il n’en reste pas moins une triste réalité pour un bon nombre de femmes encore aujourd’hui.
Les inégalités salariales
Et lorsqu’elles arrivent à gravir les échelons reste encore le problème de l’inégalité salariale. En effet, à postes égaux, trop de femmes restent encore moins payées que les hommes. En 2019, d’après le collectif féministe « Les Glorieuses », les Françaises ont commencé à travailler “bénévolement” le mardi 5 novembre 2019.
Quelques données pour décrypter ces inégalités :
- 17,4%, c’est le pourcentage de différence entre ce que gagne une femme et un homme à temps plein sur une année.
- 21%, c’est le pourcentage d’écart qui existe entre les hommes et les femmes pour un poste de cadre équivalent.
- 8,4%, c’est le taux représentant des inégalités de salaire liées aux discriminations ou aux stéréotypes, qui peuvent bloquer l’avancement salarial des travailleuses.
Même si des lois ont été mises en place ces dernières années et que des efforts sont réalisés, ne pouvons-nous pas faire plus en faveur d’une égalité encore meilleure entre les hommes et les femmes au travail ?

Qu’en sera-t-il demain ?
La priorité semble être donnée à l’abolition des inégalités salariales.
« Avant la fin du quinquennat, les femmes seront aussi bien payées que les hommes dans les entreprises », selon les mots de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, mardi 23 octobre 2018. Elle a ajouté qu’à partir du 1er janvier 2019, les sociétés de plus de 50 salariés où des inégalités salariales entre femmes et hommes auront été constatées, disposeront de trois ans pour agir. En faveur de l’égalité salariale. Si cette loi n’est pas respectée, une sanction financière équivalente à 1% de leur chiffre d’affaires leur sera appliquée.
« Dans cinq ans, il faut que l’on ait réglé ce problème qui est une honte et qui est mauvais pour les femmes et pour l’économie”, a-t-elle annoncé.
A priori, c’est l’inspection du travail qui doit réaliser des contrôles… 7 000 contrôles étaient prévus dans les entreprises de plus de 1 000 salariés en 2019. Ont-ils été menés ? Et quid des sanctions… et des entreprises plus petites qui sont les plus nombreuses ?
Alors, oui, il y a des progrès, mais que c’est lent ! Surtout lorsque l’on est directement concernée en tant que femme…
Mais, essayons de voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide et démarrons l’année pleines d’enthousiasme. Continuons à nous battre pour une meilleure égalité et pour l’abolition des différentes inégalités (salaire, discrimination à l’embauche, sexisme etc.). Le combat n’est pas terminé et je suis sûre qu’il ne sera pas vain !
Charlotte Vallet – Sophrologue et hypnothérapeute à Paris

-

Les femmes se remettent-elles plus en question que les hommes ?
Libérée, délivrée… Désolée, si je vous mets cet air en tête pour toute la journée… mais c’est en écoutant ce refrain que je me suis dit : les femmes sont tout de même devenues de véritables battantes. Et cette liberté, cette délivrance, elles ne tombent pas du Ciel.
Un grand nombre de femmes dénoncent de plus en plus leurs difficultés et ne se contentent plus de subir, mais elles cherchent comment s’en sortir, comment les résoudre.
On dit souvent que les femmes se posent trop de questions, qu’elles se remettent plus en question… plus que les hommes ? Est-ce un problème ?
Car se remettre en question et s’interroger sur soi-même sont des démarches saines et même salutaires. L’introspection donne à chacun (et chacune) d’entre nous des atouts psychologiques qui permettent de nous libérer de certitudes parfois trop ancrées, et aussi de trouver une issue pour sortir des moments difficiles.
Et curieusement, il semble que les femmes soient plus enclines que les hommes à pratiquer cette remise en question. L’introspection serait donc une activité essentiellement féminine. Est-ce une simple impression ? Pas si sûr.
La remise en question s’accorde au féminin
Nous pouvons le vérifier chaque jour dans notre entourage : les femmes se posent globalement plus de questions que les hommes. Sur le sens qu’elles donnent à leur vie, sur les raisons de leurs passions amoureuses, sur les ambiguïtés qui naissent de leurs relations, sur leur rôle de mère parfaite ou d’épouse idéale… la liste est loin d’être exhaustive (rires).
Sommes-nous les seules à nous poser ces questions existentielles ? Les hommes ne s’en posent-ils aucune ?
Dans les faits, il est fort probable que femmes et hommes se posent autant de questions au cours de leur existence.
Mais on a culturellement appris aux hommes à ne pas exprimer leurs émotions, à masquer ce qui serait considéré comme « une faiblesse ». Les questions existentielles sont ainsi souvent refoulées par pur « virilisme » dans une activité annexe (le travail, le sport, le jeu…) qui occupe le « temps de cerveau disponible ».
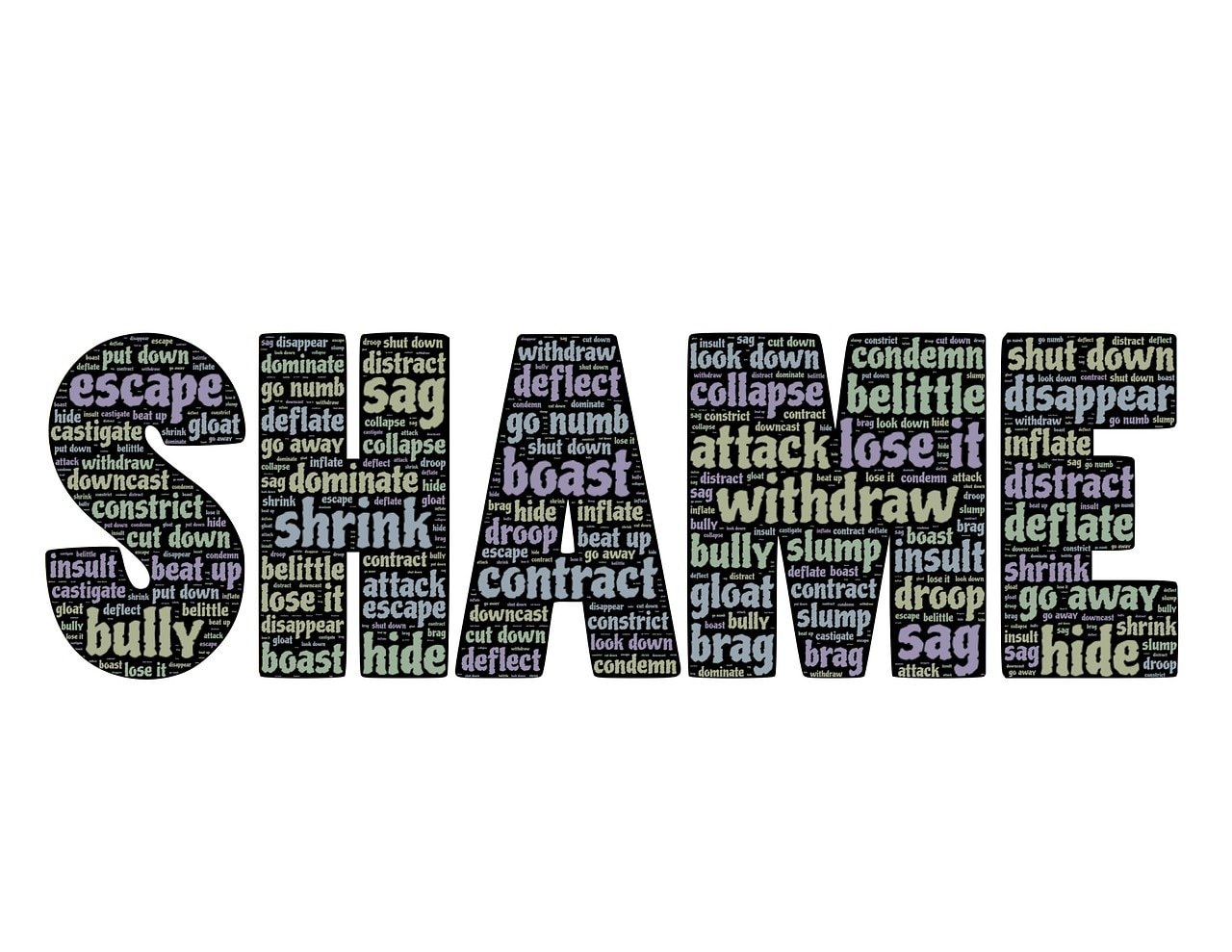
Les femmes, au contraire, expriment plus volontiers leurs émotions, leurs craintes, leurs interrogations. Elles y sont « autorisées ». Ce qui laisse en effet à penser que la remise en question s’accorde au féminin.
Un questionnement permanent
La femme se pose mille questions. Elle a constamment besoin de faire le point. Elle se considère plus terre à terre, plus proche des contingences de la vie quotidienne. Une femme est globalement plus inquiète pour sa santé ou celle de ses proches, pour son avenir, pour l’image qu’elle donne d’elle-même. Elle s’inquiète aussi beaucoup pour son entourage, pour ses enfants et leur potentiel, pour son mari et sa réussite, pour la famille et les amis…
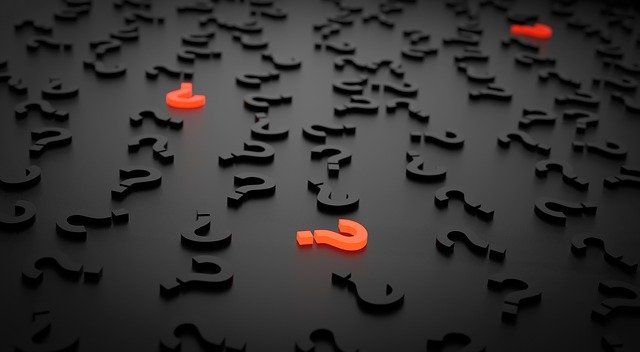
Et lorsqu’elle est amoureuse, la femme s’interroge encore plus. Sur l’engagement de son conjoint dans cette relation… sur sa capacité à vraiment aimer. Elle décortique, pèse le pour et le contre, traque les axes d’améliorations, évalue les hypothèses… tandis que l’élu de son cœur (s’il est masculin) se contente de vivre sa passion au jour le jour, le sourire béat. Il ne se posera des questions que le jour où il commencera à avoir des doutes sur sa compagne, lorsque la relation commencera à se dégrader.
C’est souvent salutaire mais pas toujours sauf si…
Dans le cerveau d’une femme, l’intellect et les émotions sont moins compartimentés que dans celui d’un homme. Son analyse d’une situation diffère ainsi de celle de son compagnon. Là où lui classe rapidement le dossier, elle cherche encore et toujours à comprendre, à expliquer, à émettre des hypothèses, à remettre en cause. Son questionnement est permanent.
Mais attention… Une femme qui se montre trop réceptive aux pensées négatives, et qui est dépassée par tous ces questionnements multiples, peut vite sombrer dans la déprime. La femme se trouve ainsi plus exposée qu’un homme aux périodes d’anxiété et à la dépression. Son éveil permanent l’empêche de se construire une carapace aussi imperméable aux émotions que celle de l’homme.
Les femmes ont donc un besoin plus fort de réfléchir à leur situation. J’ai déjà évoqué dans un article précédent le problème de la charge mentale (le syndrôme de la femme épuisée) dont sont sujettes de nombreuses femmes. Celles-ci font de la bonne tenue de leur foyer une mission à laquelle elles ne peuvent déroger. Je proposais comme principal « remède » un changement de comportement vis-à-vis du conjoint mais aussi de soi-même. Or ce changement, très profond, souvent difficile, nécessite une vraie remise en question.
Et la bonne nouvelle, c’est qu’elles y parviennent de plus en plus ! Elles osent affronter leurs peurs, entre autres.

Ainsi les femmes sont plus disposées que leurs compagnons masculins à réaliser les changements qu’elles estiment nécessaires. Là où l’homme cherchera le plus souvent un compromis, la femme n’hésitera pas à modifier radicalement son comportement, ses habitudes, son cadre de vie. Elle envisagera ainsi plus rapidement une séparation, par exemple.
Mais très souvent, ce processus n’est obtenu qu’après une thérapie plus ou moins longue.
Le recours aux thérapies
La femme, c’est un fait, a besoin de rêver, de se nourrir d’émotions (quitte à se laisser parfois (souvent même) envahir par des émotions négatives). Et ce besoin, elle l’exprime couramment. Auprès de son compagnon, de ses amis, de sa famille. Et si elle ne trouve ni écoute, ni solution, elle se tourne plus volontiers vers un spécialiste.
Les études démontrent que 70 % des personnes qui consultent un psychothérapeute sont des femmes. Moi-même, sophrologue et hypnothérapeute, j’ai une patientèle qui est composée à 80% de femmes.
Pourquoi une minorité d’hommes ? Les hommes rechigneraient-ils à bousculer leurs convictions ?
- Oui… pas tous mais une majorité.
Un homme a-t-il plus peur d’être confronté à des vérités qu’il n’accepterait pas ?
- Oui… pas tous mais une majorité.
Ou peut-être plus simplement estime-t-il, suite à notre système éducatif, que consulter un thérapeute n’est pas une démarche “normale”, qu’elle relève une faiblesse, voire un psychisme défaillant.
Le problème est bien là, à mon avis…

Conclusion
Alors oui : la femme se remet plus souvent en question que les hommes. Elle s’interroge constamment sur le sens de ses actions, de ses relations, de sa vie.
Elle est plus curieuse d’elle-même que peut l’être un homme « naturellement ». Et franchit plus rapidement la porte lorsqu’il s’agit d’essayer les thérapies alternatives et la médecine douce qui peuvent l’accompagner dans sa démarche.
S’interroger sur soi, c’est chercher à vivre pleinement sa vie. Il faut juste apprendre à ne pas se laisser parasiter par les sentiments négatifs et destructeurs. Et très certainement faire comprendre aux hommes qui intériorisent toutes leurs émotions, qu’ils devraient essayer, eux aussi, de se remettre en question. De mon point de vue, lequel je pense est largement partagé, ce serait plutôt un signe de courage que de faiblesse.
Et pour aller encore plus loin… on peut même penser que cela réduirait considérablement les problèmes de violence…
À bon entendeur…
Charlotte Vallet – Sophrologue et Hypnothérapeute à Paris
-

La charge mentale : le syndrome de la femme épuisée
À peine réveillée, votre esprit est déjà en suractivité et passe en revue tout ce que vous avez à faire dans la journée ? Penser à aller chercher les enfants au sport, prévoir les courses pour le dîner (et pour celui de demain où vous avez invité quelques amis). Passer au pressing chercher les chemises de votre conjoint, aller à la pharmacie pour prendre le sirop pour Antoine, téléphoner au vétérinaire pour le vaccin de minou, envoyer le paiement de vos impôts, etc. etc. etc. etc. etc.
Ah j’oubliais. Et bien sûr, aller travailler !
Vivement le week-end durant lequel vous pourrez prendre le temps de faire les machines à laver, repasser, le ménage et vous occuper un peu plus des devoirs de vos enfants !
Et votre conjoint ? Il fait quoi ? Beh… il travaille !?! Mais sûrement plus, plus tard, plus loin ? Voilà ce que nous entendons systématiquement.
Notre société a beau évoluer dans le sens de l’égalité homme-femme, la bonne tenue d’un foyer reste, dans nos mentalités, même au 21e siècle, l’affaire des femmes. Et dans une société qui évolue en mode accéléré, il est donc normal que les femmes finissent par s’épuiser… Pourtant, on parle de plus en plus du partage des tâches…

Le partage des tâches… où en est-on vraiment ?
Il faut reconnaître que de plus en plus d’hommes participent à la vie quotidienne. Pourtant les femmes demeurent encore les impliquées dans la tenue du foyer.
Les femmes seraient-elles donc conditionnées pour se sentir obligées d’être de parfaites épouses, mères et d’irréprochables maîtresses de maison ? Oui, c’est une réalité. Il semble d’ailleurs que même dans un couple où le partage des tâches est avéré, l’épouse reste la plus inquiète des deux dans la bonne gestion des actes de la vie quotidienne.
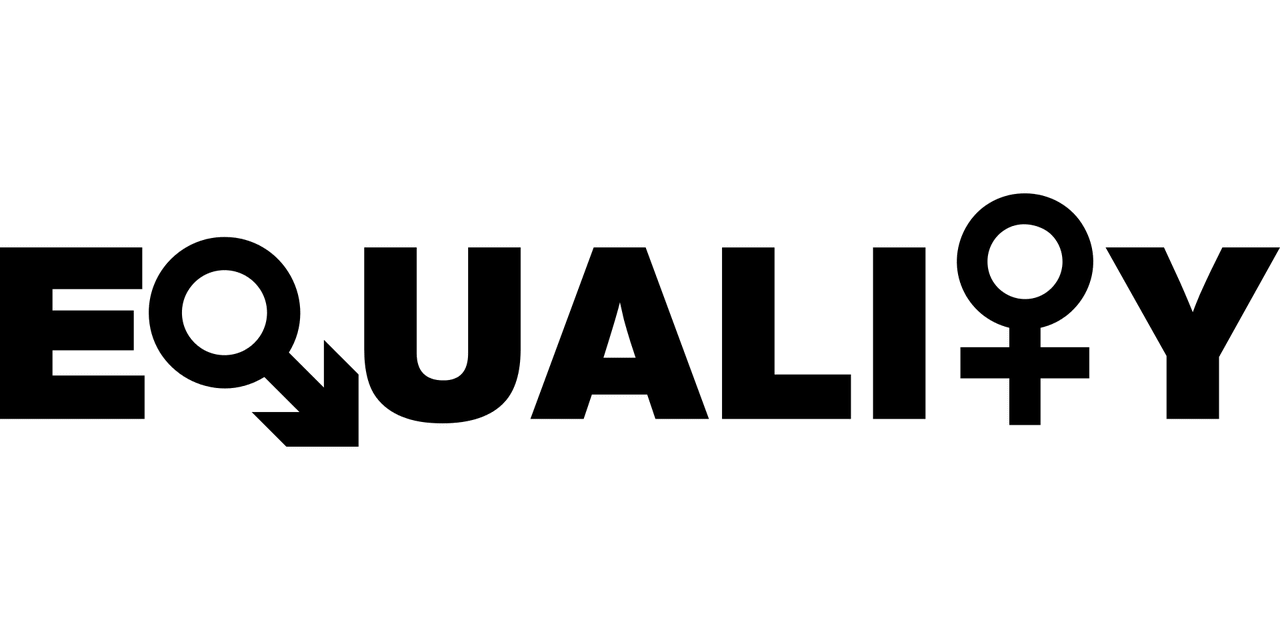
Mais avant tout, le partage des tâches est-il aujourd’hui une réalité ?
Des études menées en 1985 révélaient que les femmes en France étaient chargées de 69% des tâches ménagères du foyer, et à 80% de l’éducation des enfants. 25 ans plus tard, les mêmes études démontrent un net progrès sur le plan parental (71%) mais une très infime progression sur le plan des tâches ménagères (64%).
Il reste donc du chemin à faire pour atteindre un parfait 50/50. Les hommes ont beau s’efforcer de faire la part qui leur revient, les femmes restent sujettes à ce qu’on appelle aujourd’hui la charge mentale. Mais qu’est-ce que la charge mentale ?
Qu’est-ce que la “charge mentale” ?
C’est une théorie développée par une chercheuse canadienne, Nicole Brais. La compagne, se met plus de pression que son conjoint dans le bon ordonnancement du foyer. Elle doit « penser à tout ». Même lorsque monsieur fait, madame se sent obliger de superviser, de vérifier la bonne exécution des tâches. Celles du conjoint, des enfants, mais aussi de la femme de ménage alors que les services de celle-ci ont été demandés pour éviter le problème.
Cette charge est d’autant plus stressante de nos jours que les femmes ont désormais un emploi. Au stress du travail s’ajoute donc celui de la maison, ce qui alimente un épuisement mental très élevé. Nicole Brais, la chercheuse canadienne, insiste beaucoup sur une petite phrase malheureuse qui survient lors d’une situation que connaissent beaucoup de couples.
Madame, au four et au moulin, oublie le fer sur la table à repasser ou le lait sur le feu. Monsieur croit alors venir la consoler en lui adressant un malheureux « Pourquoi tu ne me demandes pas de t’aider ? ».
La phrase qui fait souvent exploser une femme. En quelques mots, le conjoint admet considérer que c’est la femme qui est la responsable des tâches ménagères. Consciemment ou non, les hommes n’interviennent pas tant que les femmes ne leur auront pas spécifiquement assigné à une mission.
Ainsi dans chaque foyer, il y a un membre victime de charge mentale, et c’est quasiment toujours la femme. Celle-ci prend donc le leadership du foyer sur les tâches ménagères, les courses, l’éducation des enfants tout en assumant un métier exigeant et en essayant même de se dégager du temps pour une vie sociale.

Comment en finir avec la charge mentale ?
Ne pas trop se réjouir d’être une bonne ménagère !
Il faut d’abord faire admettre aux hommes qu’ils ont un rôle à jouer. Mais il faut également que les femmes comprennent que leur attitude peut engendrer ces comportements inégaux. Souvent, l’investissement remarquable des femmes reçoit l’approbation passive des hommes. Beaucoup de femmes semblent alors s’épanouir dans ce rôle ! Mais jusqu’à quand ? Jusqu’à… l’épuisement…
Ne pas être systématiquement reconnaissante
Lorsqu’un homme prend l’initiative de faire la vaisselle (par exemple), la femme approuve souvent la démarche et adresse un remerciement qui confirmerait le caractère « exceptionnel » de la situation. Alors qu’elle devrait faire comme si de rien n’était, ne pas habituer son conjoint à des remerciements à chaque effort réalisé. C’est normal !
En finir avec le besoin de tout contrôler et le besoin que tout soit parfait
Il y a aussi le syndrome de « l’inspectrice des travaux finis », ce moment (que l’on a évoqué plus haut) ou la femme vérifie si le travail de son conjoint a été bien fait. Un irrépressible besoin de contrôler qui, finalement, déresponsabilise celui qui l’a fait. C’est encore pire quand on reproche systématiquement à son conjoint qu’il s’est encore trompé de marque ou de produit quand il revient des courses, ou que décidément il n’est pas doué pour telle ou telle tâche. Avec au bout du compte l’expression qu’il faut pourtant éviter à tout prix “Laisse, je vais faire…”.
Un amas de clichés ? Certes, le trait de mes exemples est quelque peu grossi, mais ce sont des situations que vivent réellement, avec plus de nuances, de nombreux couples. La solution est souvent d’inviter le conjoint à faire sa part. Non pas en lui assignant des tâches d’autorité, mais en lui laissant implicitement l’espace des tâches à réaliser. Laisser traîner des choses. Le laisser s’en occuper et, surtout accepter qu’il s’en occupe à sa façon. Une démarche qui ne se fera pas du jour au lendemain, et qui peut même générer quelques tensions. Mais on sait que les choses ne peuvent que s’aplanir et s’améliorer dans le dialogue et le respect mutuel.

Casser les clichés et changer notre attitude
Il est donc important de briser la figure un peu vieillotte de la maîtresse de maison. Casser le cliché selon lequel monsieur rentre à la maison pour se reposer, après une longue journée de travail. Aujourd’hui un homme n’est plus le seul à assurer les revenus du foyer. L’épouse du XXIe siècle à un job, il arrive même qu’elle soit mieux payée que son conjoint, qu’elle exerce un métier beaucoup plus exigeant ! L’époque n’exige plus qu’elle soit la wonder-woman du foyer.
Plus facile à écrire qu’à faire. Nous sommes tous (toutes) un peu conditionné(e)s par l’image que donnaient nos parents, cette espèce d’harmonie du couple qui semblait émaner de la maman « multitâches » et du papa moins concerné. Une harmonie pourtant fort trompeuse… car on en voit aujourd’hui les dégâts… Mais c’est à nous désormais de changer les choses et nos propres comportements !
Charlotte Vallet – Sophrologue et Hypnothérapeute à Paris