Votre panier est actuellement vide !
Catégorie : Méditation
-

Comment méditer autrement qu’en fermant les yeux ?
Dans une société où la productivité se place au premier rang, ou l’argent est roi et dans laquelle il faut tout faire, tout de suite, il est parfois difficile de s’y retrouver. Et surtout, de se retrouver. Depuis quelques années, pourtant, les pratiques de médecines parallèles et de soins holistiques s’étendent par-delà les continents et les cultures. La méditation fait partie de ces pratiques qui permettent de se (re)poser, de se (re)centrer sur soi-même, et de pouvoir repartir dans la vie avec davantage de cohésion. Et si souvent, la méditation est associée à une assise en tailleur et un « ommm » tourné en dérision, il y a en réalité de multiples façons de s’adonner à la méditation. Prêts à trouver la vôtre ?
La méditation, késako ?
La méditation, dans son sens général décrit l’action de penser une chose, un corps, un concept, des émotions…etc. Au sens spirituel du terme, elle possède un sens beaucoup plus précis, car il s’agit d’une voie qui mène à la réalisation de Soi ou à un éveil. Les premières traces de méditation remontent d’ailleurs à plus de deux milles ans avant notre ère, ce qui se situe bien avant l’apparition du bouddhisme par celui qui la développa : Siddhartha.
Présente au cœur du bouddhisme, du taoïsme, du yoga ou du christianisme, la méditation est une pratique présente dans toutes les religions et de nombreux domaines, bien qu’elle s’exprime différemment dans chacun d’eux. Dans le cadre de la spiritualité, la méditation s’apparente surtout au chemin qui mène droit vers l’éveil de son « moi profond », et la connexion à soi.
Ainsi, il est possible de définir la méditation, venant du latin « meditare » qui signifie « contempler », comme une pratique mentale et spirituelle qui favorise le lien à soi-même, libère les tensions et permet d’ouvrir son esprit.
Les bienfaits de la méditation
Parmi les nombreux bienfaits que la méditation provoque sur le corps et l’esprit, l’on retrouve :
- Réduction du stress :
- Amélioration de la mémoire et de l’attention ;
- Réduction d’un sentiment ou d’une blessure douloureux/se ;
- Diminution des risques de maladies cardiovasculaires ;
- Baisse des symptômes en cas de virus ;
- Renforcement du système immunitaire dans sa généralité ;
- Apaisement de pensées négatives ;
- Provoque une sensation de détente ;
- Développe l’intuition ;
- Augmente la créativité ;
- Améliore l’estime de soi et développe la confiance personnelle.
Les techniques de méditation sans fermer les yeux
La méditation, si elle peut parfois se confronter aux préjugés et stéréotypes que l’on porte sur elle, a pourtant bien des façons de se pratiquer, et une multitude de formes pour le faire. Zoom sur ces méthodes de méditation simples à mettre en place, qui permettent de se recentrer sur soi, dans presque toutes les circonstances !
La méditation de pleine conscience :
Cette méditation est parfois difficile à apprivoiser tant elle peut être intimidante. Et pourtant, une fois que vous la maîtriserez, vous pourrez l’exercer partout, et ce, dès que vous en sentirez le besoin ! Car la méditation de pleine conscience, c’est avant tout la force de l’esprit et de l’instant présent. Et pour cause, la méditation de pleine conscience peut se faire à n’importe quel moment de la journée, dans n’importe quel lieu.
Méthode : il s’agit de se concentrer sur ce que vos sens perçoivent dans un moment M, peu importe où vous vous trouvez, ne songez qu’au présent, aux choses de la vie lors de cet instant spécifique. Il est important de ne pas se projeter ou de se remémorer. Tout ce qui compte à cet instant, lors de ce moment –votre moment- de méditation, c’est la façon dont vous rencontrez le monde extérieur.
Cette méthode peut également être efficace en cas de stress, d’angoisse ou bien de dépression.
La méditation avec mantra :
La méditation avec mantra consiste à renforcer l’instant de méditation via le son. L’intérêt du mantra est qu’à défaut de vous raccrocher au « ommm » (qui représente la connexion avec la source de l’énergie, appelée prana), vous pouvez adapter le mantra à une phrase, un mot ou un son qui vous convient ou ressemble davantage. « Je suis paix », « je suis tolérance », sont par exemple des mantras qui peuvent accompagner votre méditation.
La méditation guidée :
La méditation guidée est certainement l’une des façons de méditer les plus simples qui existent. Et pour cause, comme son nom l’indique, il s’agit ici de se laisser guider. Via un enregistrement audio, il est possible de choisir la méditation qui vous convient le mieux. En prenant en compte le moment auquel vous souhaitez méditer (matin ou soir), il vous suffit de brancher l’enregistrement, et de vous laisser porter par ce que la voix communique.
C’est une méthode idéale pour les personnes qui veulent débuter sans savoir par où commencer !
La méditation par la respiration :
Cette technique de méditation est relativement simple, puisqu’elle passe à travers l’une des actions que nous faisons le plus : respirer. Quel que soit votre emploi du temps, cette technique est relativement simple et très accessible.
Méthode : il s’agit de pouvoir s’isoler quelques instants, et se concentrer sur sa respiration. Inspirez par le nez, en songeant à cette énergie nouvelle qui vous envahit. Et lors de chacune des expirations par la bouche, visualisez les entraves, le stress ou encore les problèmes vous quitter. Cinq à dix respirations sont parfois nécessaires, et trois suffisent à d’autres moment.
Cette technique se montre très efficace si vous avez besoin de souffler (littéralement !), et de faire une pause car les circonstances sont trop stressantes.
Ainsi, il existe une multitude de techniques de méditations différentes. Il est également possible d’adapter ces méthodes à un environnement particulier, comme dans un bain (le contact avec l’eau est bénéfique et « nettoie » symboliquement vos soucis), ou encore en pleine nature (vous vous revigorez grâce à la présence de la nature).
Toutes les techniques de méditation ont leurs propres particularités, bien qu’il soit parfois plus simple, selon le contexte dans lequel vous vous trouvez d’en privilégier une plutôt qu’une autre. Quoiqu’il en soit, la méditation demeure un outil fiable auquel il est possible de se référer à n’importe quel moment. Elle calme le stress, apaise les maux, et nous guide toujours plus loin sur le chemin du bien être !
Toutefois, si certaines tensions ou problématiques s’accumulent et s’ancrent dans vos quotidiens, il est possible d’utiliser la méditation en plus d’autres techniques, comme l’hypnose. Hypnothérapeute et experte en neurosciences, je propose des séances d’hypnose à Paris, ainsi que des séances de soins thérapeutiques pour le corps (drainage lymphatique), ou pour le visage (drainage du visage).
Vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib.
Et il vous est possible d’en apprendre davantage sur moi en écoutant le podcast dans lequel j’ai été interviewée ou en écoutant mon podcast Combattantes.
Et si le quotidien semble vous engloutir sans aucun répit, peut-être est-il alors temps de vous offrir une petite retraite ?
Inspirez…
Soufflez…
Vivez !
-

POURQUOI SE MET-ON EN COUPLE ? EST-CE NECESSAIRE D’ÊTRE EN COUPLE À PART POUR PROCRÉER ?
Ces questions peuvent déjà vous avoir effleuré, ou peut-être jamais. À travers les âges et les époques, le couple a toujours tenu une place sacrée, source de nombreux conflits et jalousies –qui ne connaît pas la tragique histoire de Rachel et Jacob ? Par ailleurs, s’il était courant jadis de choisir un(e) époux (se) dans l’espoir de concevoir un héritier, aujourd’hui, tout cela est révolu. Alors pourquoi se mettre en couple ? Le désir de procréer pourrait-il à lui seul justifier cette décision ?
Le couple : du flirt à l’amour
Pourquoi se mettre en couple ? Lorsque deux personnes se rencontrent, il peut parfois y avoir des étincelles. Il existe autant de relations qu’il y a de personnes différentes, et chaque relation est unique. Qu’il s’agisse d’une phase de flirt ou suite à de grandes déclarations passionnées, le couple peut se former sous couvert d’attirance, de sentiments naissants ou affirmés, ou encore d’une symbiose totale.
Que l’on respecte les étapes d’une vie de couple « basique » ou non, l’essentiel est que chaque personne s’y plaise tant que durent les sentiments. Si votre copine Léa a décidé d’entamer une relation à distance, c’est tout aussi respectable que Marc, qui vient d’emménager avec son amour du lycée. Voilà comment deux inconnus, forment désormais un couple heureux.

Il paraît que seul on va plus vite, et qu’à deux on va plus loin…
Être en couple, c’est avoir des papillons dans le ventre et des étoiles dans les yeux. Mais c’est aussi –et surtout-dans une relation saine, pouvoir compter sur l’autre. Être une équipe, et savoir que le ou la partenaire nous soutient, quoiqu’il arrive. C’est aussi la stabilité, émotionnelle et financière. Plus de perspectives peuvent s’ouvrir à notre regard amoureux, par le fait même qu’un soutien, une aide existe au sein du couple.
Être en couple, c’est aussi avoir le palpitant qui s’agite, malgré la routine qui s’installe et les épreuves que la vie continue de déposer sur notre chemin. Ce sont les rires partagés, les private jokes qui sont nées après une soirée à déambuler dans la ville, mais aussi les débats sur la politique, les disputes parfois et les réconciliations, souvent. C’est un éventail de sensations uniques.
En somme, être en couple peut tout à fait être une expérience qui change à jamais la personne, et grave en son cœur des souvenirs intarissables.

Et si on faisait un enfant ?
Le désir de procréer peut être l’une des raisons de se mettre en couple. Mais le couple doit-il se restreindre à cela ?
Suite logique, besoin biologique, désir enfoui depuis l’enfance ? Avoir envie de faire un enfant, de créer la vie est tout à fait naturel. D’autant plus si la relation que l’on partage avec le ou la conjoint(e) est stable. Les hormones travaillent, l’esprit se questionne, et le verdict s’impose : et si on avait un enfant ?
En revanche, se mettre en couple dans l’idée de procréer ne semble jamais une décision judicieuse. Elle risque d’entraîner une grande frustration dans son sillage, et inévitablement, des déceptions. Car avoir un enfant, c’est une étape clé dans une relation, et pour cela, le débat doit s’ouvrir, les deux parties du couple doivent être certaines avant de se lancer. Créer la vie, c’est devoir s’en occuper, la chérir, la protéger ensuite.
Le désir de procréer : plus fort que tout ?
Mais le désir de procréer peut bien se transformer en décision réfléchie, il est possible de trouver des alternatives à la procréation conventionnelle. Pour les couples stériles ou atteint par une maladie génétique qu’ils ne souhaitent pas transmettre à l’enfant, il est tout à fait possible d’entamer une procédure afin de passer par une Procréation Médicalement Assistée (PMA). Si récemment, la PMA a été ouverte aux femmes et couples de femmes en plus des couples hétérosexuels, d’autres solutions étaient possibles en parallèle. C’est le cas de l’Insémination Artificielle par Donneur de sperme (IAD), qui passe notamment par la Fécondation In Vitro (FIV).
Ainsi, dans notre monde qui se meut chaque jour un peu plus, il est tout à fait possible pour une femme célibataire d’avoir un enfant sans être en couple.

Faire un enfant seule : pourquoi ça peut faire peur ?
Mais faire une enfant toute seule ne veut pas dire que la vie sera belle et douce. Il s’agira, comme pour beaucoup de choses, de faire face avec courage et patience aux nouvelles responsabilités qui incombent à une mère. Toutefois, le soutien peut s’établir de la famille ou d’amis, ce qui permettra de l’aide et une certaine stabilité à la mère.
Faire un enfant seule, c’est parfois oublier que l’on est femme aussi, et se perdre dans les couches et les biberons. Demander de l’aide n’est alors pas une preuve de faiblesse, mais un simple besoin éphémère pour un avenir plus serein. Quoiqu’il en soit, il est important de ne jamais reculer malgré les questions, les doutes, et les inquiétudes que peut insuffler la responsabilité d’une vie. Vous êtes forte, vous n’êtes pas seules, et surtout, faîtes-vous confiance. Votre enfant partage votre chair et votre sang, vos valeurs, votre éducation. Ses apprentissages sont les vôtres aussi, et même si parfois vous tâtonnez, vous y parviendrez.

Mais du coup, pourquoi se mettre en couple semble si important ?
Alors, tu fréquentes quelqu’un en ce moment ?, C’est pour quand, le mariage ?, Tu sais, à ton âge, j’avais déjà deux enfants… etc. Ça ? C’est la pression sociale. Le couple, les enfants, et la jolie barrière blanche autour du pavillon. Se mettre en couple est depuis toujours définition de stabilité et d’équilibre. Pour l’entourage, ça signifie que vous êtes heureux, pour la société, que vous êtes dans une situation « normale ». Mais c’est quoi être normal ? Ne vaut-il mieux pas être simplement heureux tel que l’on est, avec ce que l’on a ? Se lancer dans la quête du grand amour parce qu’on en a l’envie, et non pour plaire aux autres, n’est-ce pas une forme de liberté –et non de rébellion ?
Si la peur de la solitude vous étreint parfois, apprenez à la connaître, c’est une jolie amie dont on a tous besoin pour se ressourcer. Si l’idée d’être en couple vous plaît davantage que la personne avec qui vous l’êtes, revoyez vos priorités : les idées ne font pas le bonheur ; mais la bonne personne le peut.
Être en couple ne devrait rien définir sinon les sentiments que vous portez à une personne. Car au final, que vous ayez des enfants ou non, que vous en vouliez ou qu’il en soit hors de question, que vous soyez en couple ou célibataire… L’important, c’est d’être heureux dans votre vie, non ?
To love or not to love… À vous de décider !
-

LE POUVOIR DE L’HYPERSENSIBILITÉ
L’hypersensibilité émotionnelle, comme son nom l’indique, s’agit d’un trait de caractère particulier qu’un individu acquiert dès sa naissance. Si vous vous posez des questions autour de ce sujet, nous avons pris la peine de les répondre à travers ce guide notamment sur comment reconnaitre un hypersensible.
Comment savoir si une personne est hypersensible ?
De prime abord, l’hypersensible est quelqu’un qui se sent submergé par ses émotions. Il est également sensible au bien-être de son entourage. Toutefois, il faut savoir que l’hypersensibilité émotionnelle peut se manifester différemment, étant donné que cela dépend de l’état de l’individu. En général, une personne est hypersensible lorsqu’elle a des difficultés à gérer ses émotions. Elle l’est également lorsqu’elle est sensible aux dires et aux regards des autres, en tout cas, à un certain niveau. En effet, il est réservé et très susceptible car il préfère se ressourcer loin de la foule. L’hypersensible dispose d’un sens de l’observation développé et fait preuve d’une grande empathie. Dans certaines situations, l’hypersensible surréagis et ne sait pas se contenir. En outre, une personne est hypersensible quand :
- Elle a le sens du détail
- Elle est susceptible
- Elle pleure très facilement
- Elle se sent en décalage avec les autres (se sentir différent ou pas normal)
- Elle est plus attentionnée que la moyenne : l’hypersensible aime faire plaisir à son entourage.
- Elle est réservée : l’hypersensible préfère prendre le temps de connaitre et de sentir l’autre avant de s’ouvrir. Sinon, il se renferme sur lui-même et se fait passer pour un timide.
Quelles sont les difficultés que rencontre un hypersensible ?
Il existe plusieurs difficultés liées à l’hypersensibilité. Il faut déjà savoir que lorsqu’une personne est hypersensible, elle a tendance à privilégier un environnement protégé, calme et silencieux. À cet effet, l’hypersensible préfère souvent s’isoler, se forger un zone de confort, à un tel point qu’il a du mal à s’intégrer. La solitude peut également devenir pesante pour lui. Par conséquent, il a souvent des problèmes relationnels. De plus, un hypersensible est souvent stressé étant donné qu’il doit gérer ses émotions pour toutes les situations qui se présentent face à lui. Ainsi, l’hypersensible doit souvent affronter des crises d’angoisses et le stress.
Comment vivre avec l’hypersensibilité ?
Même si les autres vous disent : “ il faut soigner ton hypersensibilité “, sachez que l’hypersensibilité ne peut être soignée. Ce que vous devez faire c’est plutôt d’apprendre à vivre avec votre trait de caractère particulier. Dites-vous qu’il s’agit d’une chose qui vous démarque des autres, et non d’une malédiction. Ainsi, vous devez apprendre à gérer votre hypersensibilité. Comment ? Pour procéder, il faut savoir gérer ses émotions. La gestion de ses émotions passe notamment par le développement personnel, ou la psychothérapie. En effet, vous aurez besoin d’aide extérieur dans le sens où les interactions et les diverses travails de groupes peuvent vous aider considérablement à gérer vos émotions. En outre, il existe plusieurs méthodes comme les Méthodes Quertants qui sont disponibles pour aider un hypersensible à mieux gérer ses émotions, et à vivre pleinement son quotidien.
De mon côté , je suis Charlotte Vallet, hypnothérapeute sur Paris et rédactrice free-lance. Je vous accueille dans mon cabinet du 2 bis Villa Flore 75016 Paris les mardis, jeudis et vendredis. Vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib : https://www.doctolib.fr/hypnotherapeute/paris/charlotte-vallet
Voici un autre article que j’ai écrit sur le thème de la Charge mentale https://www.charlottevallet.fr/la-charge-mentale-le-syndrome-de-la-femme-epuisee/
-

Changer de vie : Et si le rêve devenait réalité
Quitter son job pour devenir prof de plongée dans les Caraïbes ou prof de yoga, ouvrir un gîte ou une ferme écologique à la campagne, aménager un camping-car et faire le tour du monde… Qui n’y a pas pensé un jour ?
Et les statistiques le prouvent. Près de 80 % des Français ressentent, un jour, ce besoin de tout quitter pour recommencer autre chose. Mais combien le font ? Beaucoup, beaucoup moins… À peu près 1 % par an. Ce n’est en effet pas facile de faire ce grand saut…
Je suis bien placée pour vous en parler… puisque je l’ai fait. Certes, je n’ai pas tout quitté pour partir vivre en Afrique… mais j’ai quitté mon petit confort « professionnel », pour repartir de zéro. C’était, à l’époque, devenu indispensable pour moi de redonner du sens à ma vie.
Et je ne le regrette pas, bien au contraire !
Mais effectivement, cette quête du bonheur, ça se mérite… Le chemin de la « liberté » est quelque peu semé d’embûches. Tant de choses se bousculent dans notre esprit ! Alors, pourquoi est-ce si difficile ?
L’envie d’être heureux : une aspiration propre à l’être humain
Comme dit dans l’introduction, nous sommes nombreux (voire de plus en plus nombreux) à exprimer cette envie de changer de vie. En effet, nous aspirons tous à vivre, une vie « heureuse ». Tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Mais… , je ne vous apprends rien : la vie n’est pas un long fleuve tranquille… Si certaines situations peuvent être supportées ou supportables, d’autres peuvent devenir un véritable calvaire. Et lorsque l’on se trouve en porte-à-faux perpétuel avec « qui nous sommes » ou « ce que nous voulons », la vie peut devenir un enfer.
La boule au ventre le dimanche soir car on ne veut plus se lever pour aller au travail… Le sentiment de ne servir à rien… Le sentiment d’être impuissant face à tout ce qui produit autour de nous… Cette société parfois cruelle, souvent injuste… Le sentiment de subir, de n’être qu’un simple spectateur de notre vie…

Et les jours passent, les uns après les autres… Tout ceci engendre une frustration grandissante, laquelle engendre un mal-être, qui peut devenir insupportable pour notre entourage mais surtout pour nous-même, et notre propre santé. Notre petite voix nous dit « bouge-toi, change de vie », mais on ne le fait pas.
Pourquoi est-ce si difficile de changer de vie ?
Trop de peurs nous retiennent
Déjà, et c’est humain, le changement fait peur. Car même si l’on a tendance à se plaindre de notre quotidien, nos petites habitudes nous rassurent. En effet, l’inconnu fait peur car on n’a pas la certitude que nous réussirons à changer de vie. Et c’est ce manque de certitude qui nous empêche de franchir le pas. Eh oui… Changer de vie comporte des risques. Et nous n’avons pas tous le même comportement face à la prise de risques.
Il faut une certaine dose de courage… Car entre « penser les choses, les imaginer, voire fantasmer » et « agir » pour qu’elles se concrétisent, il y a un grand pas à franchir.
Et là, il y a moins de monde au portillon. Mais, là encore, c’est humain. On a tous un petit côté qui nous pousse à « attendre que tout nous tombe du ciel. » On attend le miracle. Eh non ! Rien ne tombe du ciel dans la vie. Il faut toujours se donner les moyens d’atteindre ce que l’on veut. Si on le peut, bien sûr !
Un autre point qui peut freiner aussi un tel projet, c’est le regard des autres. Ce fameux regard des autres. Que vont-ils penser de moi ? Ils vont me prendre pour une inconsciente, une folle ? Et si je me plante ? Je vais être ridicule…
Sachant quand même, que quelque part, certains vous envieront très certainement…
Son propre regard aussi. Si on échoue, on se sentira « nulle ».
Au contraire, il faut se dire que l’on aura eu le courage d’essayer. Courage, que peu ont !
Et accessoirement… ce projet peut aussi impliquer un conjoint, la famille… On culpabilise.
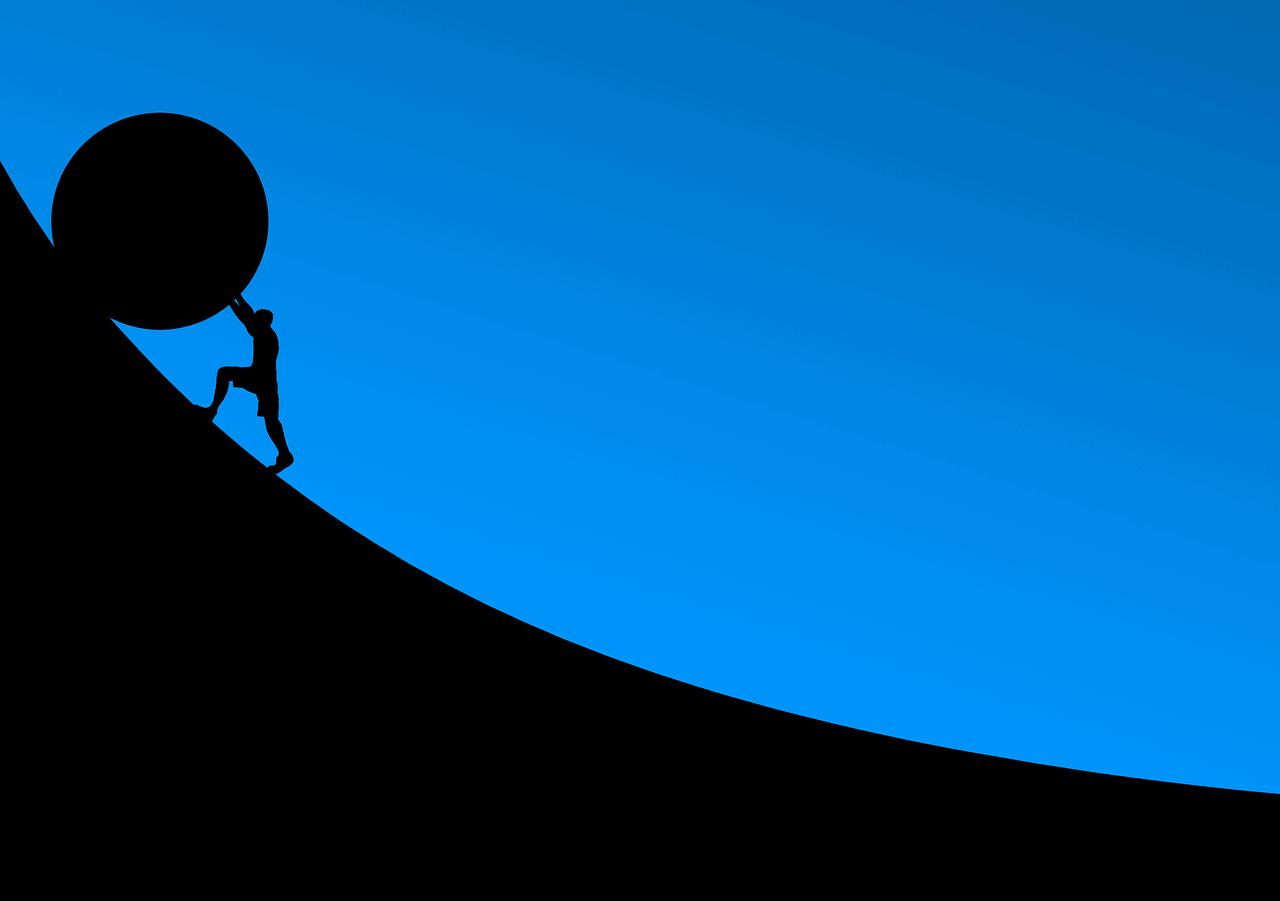
Et si on soignait ces peurs ?
Mais, malgré tout cela, si l’on veut vraiment changer de vie, c’est possible. Dans mes podcasts de la série « combattantes », j’ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui ont osé franchir le pas, et qui aujourd’hui sont heureuses et fières de l’avoir fait. Je vous invite à les écouter, ici, ou ici, si vous cherchez de la motivation.
En effet, il ne faut pas que ce projet reste uniquement dans la tête.
Le plus difficile est de prendre LA décision. Et pour la prendre, il faut bien « se » préparer et bien préparer son projet. Voici quelques pistes pour vous y aider.
Il faut verbaliser et formaliser le projet
Le verbaliser
Oui, il faut en parler. Avec son entourage proche déjà, en tout cas avec des gens en qui l’on a confiance. Et qui porteront un regard objectif et désintéressé.
Ou en parler à un « bon » thérapeute qui saura faire la différence entre une véritable envie de changer, indispensable à notre équilibre, voire à notre santé et un mal-être temporaire. Il saura également percevoir si nous sommes prête à le mettre en œuvre, et donc si nous trouverons la force d’y arriver.
Prendre du temps ou du recul et le formaliser
Ensuite, il faut surtout prendre du temps et formaliser les choses progressivement. Pour ma part, j’ai eu la chance de pouvoir faire break et faire le tour du monde. Mais si vous n’avez pas cette chance, vous pouvez vous fixer quelques mois pour vous y consacrer pleinement. Vous prenez un cahier, et vous écrivez.
- La première étape est, bien sûr, de peser le pour et le contre, c’est le b.a.- ba. Mais si déjà on en arrive là, on sait qu’il y a plus de plus pour que de contre. Mais obligez-vous à les écrire noir sur blanc, au cours du temps.
- Ensuite, il faut dresser la liste (progressivement) de tout ce qu’il faut faire pour changer de vie (plus ou moins longue selon le changement envisagé). Si vous avez déjà un projet de vie en tête, ce sera déjà plus facile. Sinon, cette étape vous demandera un certain temps.
- Envisager, bien sûr, l’aspect financier. À court terme, à moyen terme et à long terme.
- Envisager aussi un plan B ou une solution au cas où vous n’y arrivez pas. Pensez aussi que vous pourrez toujours (ou très souvent) revenir à votre situation actuelle.
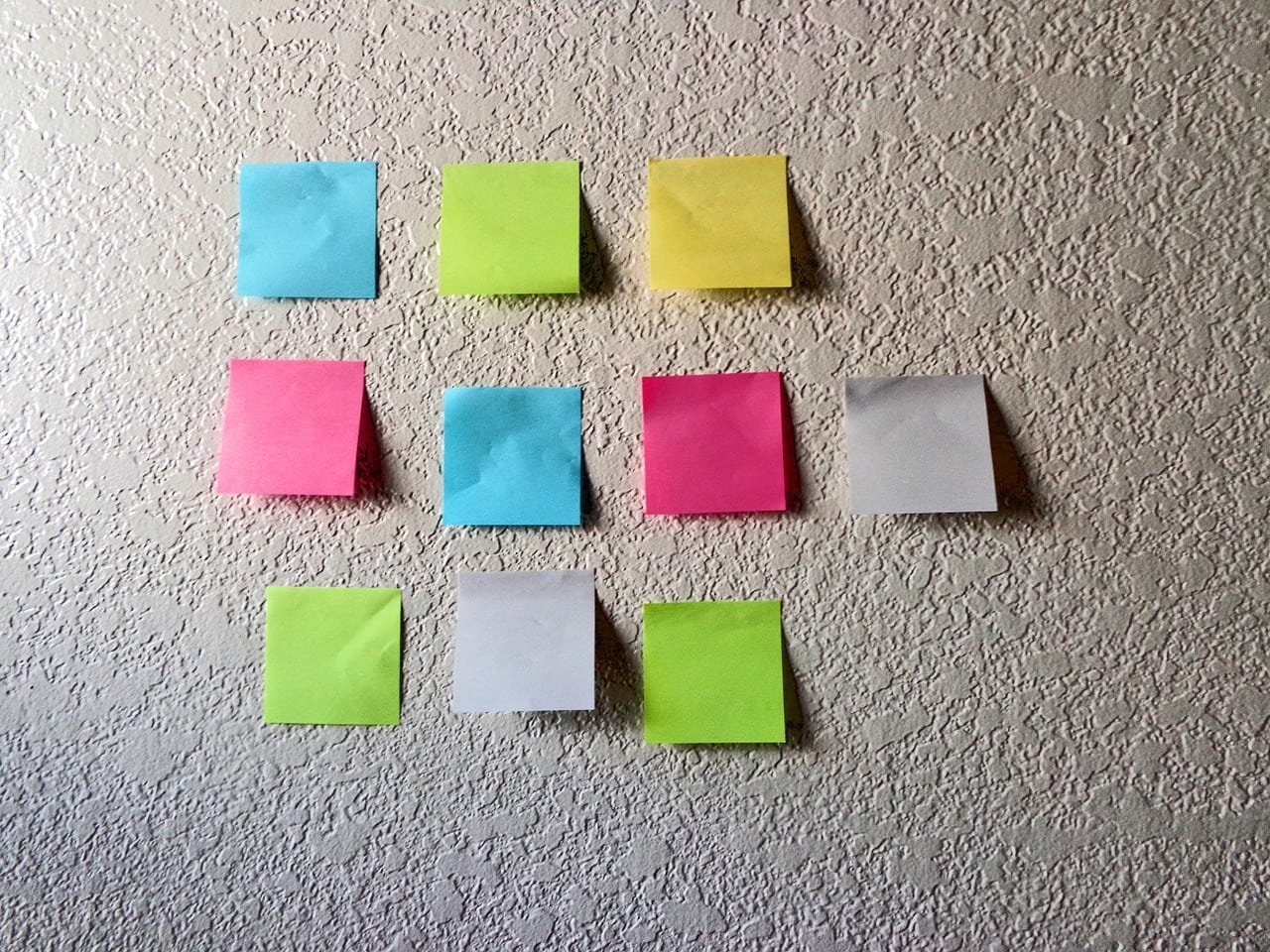
Se préparer au fait que tout ne sera pas facile
Un point important, et non des moindres, qu’il faut tout de même évoquer, c’est que ce ne sera pas tous les jours facile ! Il faut vous préparer au fait que vous passerez par des hauts et des bas. Des phases euphoriques, et des phases de découragement…
Conclusion
Si vous ne supportez plus votre quotidien, si votre moral et votre santé en sont affectés, si la pensée de changer de vie vous traverse régulièrement l’esprit, si vous avez un projet, une envie, je ne peux que vous conseiller de vous mettre au travail… On n’a qu’une vie ! Ne l’oublions jamais.
Charlotte Vallet – Sophrologue et hypnothérapeute à Paris

-

La résilience : est-ce vraiment une arme pour avancer ?
Rupture amoureuse, décès d’un proche, perte d’un emploi, maladie grave, violences physiques ou psychologiques, traumatisme dans l’enfance : personne ne réagit de la même manière face à une épreuve de la vie… Et, il se dit que la résilience aide à « mieux » survivre, et parfois même à vivre.
Mais qu’est-ce que la résilience ? Sommes-nous tous capables d’être résilient ? Et si cela s’apprend, quelles sont les techniques pour y parvenir ? Et si, finalement, nous ne pouvions pas l’être, serions-nous malheureux toute notre vie pour autant ? Difficile de répondre à toutes ces questions… Ayant personnellement appris à être résiliente depuis fort longtemps, je reconnais que la résilience m’a énormément permis d’avancer. Mais parfois, je m’interroge sur les limites de cette redoutable « résilience ».
Qu’est-ce que la résilience ?
Comment survivre au malheur ? Telle est la question à laquelle nous devons répondre si nous avons vécu une situation particulièrement traumatisante.
La résilience est un phénomène psychologique qui consiste, pour un individu affecté par un traumatisme, à prendre acte de l’événement traumatique de manière à ne pas, ou plus, vivre avec ce fléau et à se reconstruire d’une façon socialement acceptable.
Bien plus qu’une aptitude ou une force que l’on a, c’est un rythme à prendre qui permet à une personne de rebondir de manière positive et de se créer un avenir, sinon heureux, au moins satisfaisant.
Le terme, emprunté à la physique, désigne « le retour à l’état initial d’un élément déformé ».
Les psychiatres américains spécialisés dans la petite enfance, ont adopté le mot dans les années 90. Il a ensuite été popularisé en France, par Boris Cyrulnik. Selon ce psychothérapeute, environ une personne sur deux subit un traumatisme au cours de son existence, qu’il s’agisse d’un inceste, d’un viol, de la perte précoce d’un être cher, d’une maladie grave ou d’une guerre ». Comme il le dit dans son ouvrage, la résilience est caractéristique d’une « personnalité blessée mais résistante, souffrante mais heureuse d’espérer quand même ».
La résilience, qui est notre capacité à surmonter les dures épreuves de la vie, est en chacun de nous, mais est plus ou moins présente. Si c’est un réel atout pour avancer et construire sa vie de manière positive malgré les épreuves, encore faut-il savoir la développer… et en connaître ses limites…

Comment développer notre résilience ?
Voici 8 clés pour développer votre résilience :
1- Préparer son kit de survie
Oui, oui. Un « kit de survie » pour faire face aux dures épreuves de la vie. Le principe consiste à faire l’inventaire de tout ce qui nous fait du bien. Même si nous ne pouvons pas tout anticiper, il est nécessaire de bien prendre conscience que la vie n’est pas un long fleuve tranquille, de l’admettre et de s’y préparer. Cette sorte de boîte à outils, que l’on se construit, nous permet d’aller puiser, si besoin, dans ce qui nous réconforte, nous apaise, nous rassure et nous rebooste (voir ses amis, sa famille, aller au cinéma, faire du sport, lire, écrire, etc.) Cette boîte à outils sera d’autant plus accessible au moment voulu qu’elle aura été réfléchie, anticipée.
2- Identifier l’épreuve à affronter et l’accepter
Nier ou « faire l’autruche » face aux épreuves de la vie, ne les fera jamais disparaître. Cela vous mettra au contraire dans un état d’inconfort. Les affronter en les acceptant nous force à réagir de manière adaptée. Mais attention à ne pas confondre acceptation et résignation !
3- Apprendre à réguler nos émotions
Réguler nos émotions, lors d’une épreuve, se déroule en 4 temps :
- On les accueille en conscience
- On les identifie
- On les accepte
- On s’apaise
4- Modifier notre regard vis-à-vis de l’épreuve
Au premier abord, une épreuve est toujours négative. Il faut s’efforcer de la voir autrement, sous plusieurs angles (quand c’est possible bien sûr). Il est nécessaire de prendre conscience qu’elle peut nous permette de changer positivement, d’avancer, de transformer notre vie.
5- Demander de l’aide et aider l’autre
Demander de l’aide à quelqu’un permet de ne pas rester seul face à son problème. Avoir l’écoute de l’autre, demander des conseils aident souvent à surmonter une épreuve. Aider les autres aussi est une bonne thérapie pour relever la tête et passer outre notre souffrance. On décharge l’attention que l’on se porte à soi-même sur une autre personne, ce qui permet de mettre la douleur à distance.
6- Travailler, s’occuper
Pour éviter de ruminer et de sombrer dans la dépression, rien de tel que d’occuper son esprit par le travail, l’écriture, le sport, la méditation, la relaxation, la sophrologie, une activité manuelle etc. Tout est bon pour forcer notre cerveau à faire une pause mais aussi notre corps tout entier. Notre problème prendra alors moins de place et nous permettra de nous apaiser un peu.
7- Bien choisir notre entourage
Dans les dures épreuves que peut réserver la vie, préférez vous entourer de personnes à l’écoute, empathiques et bienveillantes qui vous aideront. Choisissez plutôt de vous entourer de personnes, elles-mêmes résilientes qui sauront trouver les mots pour vous réconforter.
8- Se faire confiance
Autorisez-vous à vous féliciter d’être encore debout malgré l’épreuve. Dites-vous que vous êtes forte et que vous avez réussi à l’affronter malgré la difficulté. Regagner la confiance en soi et l’estime de soi est une étape fondamentale à ne surtout pas négliger !

Et si la résilience avait ses limites ?
Mais lorsque l’on y pense, n’y a-t-il donc pas dans la résilience une forme détournée d’enfouissement de nos émotions ? À vouloir sans cesse les contrôler, ne cherchons-nous pas une façon de les anéantir pour s’en protéger ? Être résilient n’a-t-il pas ses limites ?
La face triomphante et lumineuse de la résilience cache en fait de profondes blessures qui nous engloutissent. Si elle paraît être une capacité à surmonter les épreuves, elle est aussi le symptôme d’une réelle souffrance.
C’est une sorte de réponse de défense face à la tristesse, la colère et le désespoir comme le serait une réponse immunitaire face à un virus. La résilience n’est-elle pas un rempart, conscient ou inconscient, contre des émotions que l’on ne souhaiterait pas affronter ? Ce mécanisme apparaît alors un peu comme un costume de scène que l’on enfile pour jouer un personnage.
En étant résilient, on s’efforce de lutter contre ce que l’on a vécu, contre nos émotions qui nous rendent fragiles. On joue une sorte de pièce de théâtre dans laquelle nous sommes le personnage principal. Et la plupart du temps, nous croyons sincèrement que nous avons surmonté le traumatisme.
C’est dans ce sens que le psychanalyste Serge Tisseron affirme dans son livre « les pièges de la résilience » : « une personne résiliente n’est pas libérée de ses souffrances, mais bien asservie aux mécanismes de refoulement et de compensation, aux schémas de comportement qui lui permirent, jadis, de survivre à un environnement hostile. »
Refoulement, compensation… Oui, on n’est pas vraiment libéré. On remplace quelque chose de négatif par autre chose qui peut également être négatif. Hyperactivité, addiction, obsession, troubles du comportement… la liste n’est pas exhaustive.

Que faire alors ?
S’il y avait un remède miracle, ça se saurait…
On a tous des émotions et sans elles nous serions des robots et non des êtres humains. En effet, toutes nos expériences, entraînent des réponses émotionnelles, elles-mêmes à l’origine de comportements d’adaptation.
Le tout est de savoir ne pas se laisser déborder par un flot d’émotions négatives qui nous conduirait forcément à être malheureux. Les émotions sont nécessaires à notre construction, dans notre vie quotidienne, mais il faut apprendre à les gérer. Il ne faut surtout pas chercher à les enfouir en se disant qu’elles disparaîtront ! C’est faux.
Finalement, réprimer ce que l’on ressent, tenter de supprimer nos émotions ne fonctionne pas. Au contraire, cela peut se révéler parfois plus dangereux pour notre santé que de les affronter.
Notre mental ou psychique a besoin de donner du sens à l’épreuve vécue. À défaut, le stress et le burn-out s’activent en inhibant les fonctions biologiques, physiologiques, endocriniennes et mentales. Notre santé globale est alors affectée…
Il faut sans doute être dans le juste milieu. Prendre conscience de sa fragilité, de ses manques et de ses besoins… De cette prise de conscience découleront certainement différentes pratiques propres à chacun qui nous mèneront à un mieux-être psychologique et physique. Il faut aussi s’exprimer avec sincérité et se demander si finalement on ne vit pas dans le mensonge, à la fois envers les autres, et envers soi-même.
Je finirai par une phrase de Boris Cyrulnik qui a dit : « la résilience c’est l’art de naviguer dans les torrents ». Et n’est pas artiste qui veut.

Charlotte Vallet – Sophrologue et hypnothérapeute à Paris
-
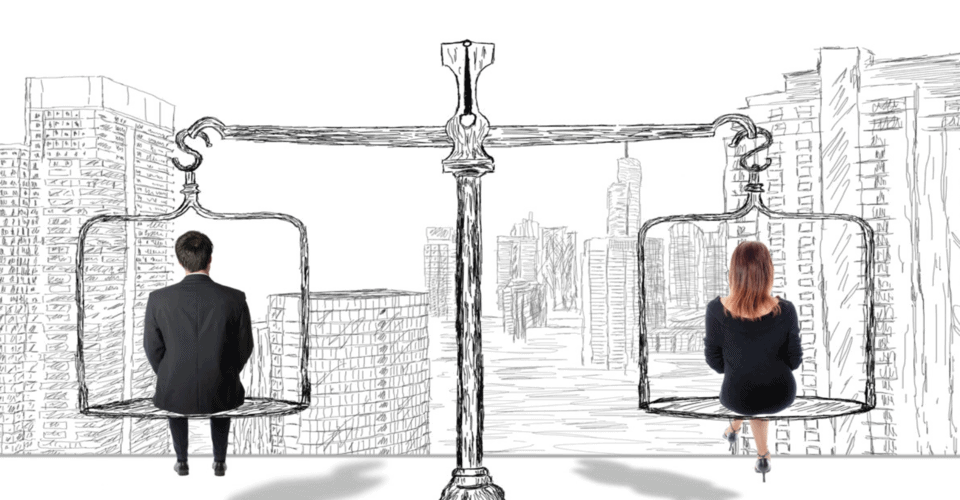
Les inégalités au travail : continuons le combat !
Si l’on entend beaucoup parler de l’égalité hommes/femmes dans le monde du travail, disons-le d’emblée, nous en sommes encore très loin !
Le constat est sans appel…
Certains secteurs et métiers sont encore aujourd’hui toujours réservés à la gent masculine. Et c’est sans parler des inégalités salariales…
Dans cet article, je vais juste tenter de faire le point sur la condition des femmes dans le monde professionnel. Tout d’abord je ferai un petit retour en arrière. Ensuite, j’évoquerai le monde d’aujourd’hui, et ce que nous pouvons espérer dans l’avenir.
Mais qu’appelle-t-on égalité hommes/femmes ?
Quels sont les critères utilisés pour la mesurer ? Il y en a quatre :
- L’obligation d’égalité salariale entre hommes et femmes
- L’interdiction à la discrimination à l’embauche,
- L’obligation d’égalité dans le déroulement de carrière,
- Et enfin l’obligation de parité dans les conseils d’administration.

Quelle était la situation des femmes d’hier ?
Avant 1945, la plupart des femmes étaient professionnellement inactives.
Ce n’est qu’après la fin de la seconde guerre mondiale que le pourcentage de femmes qui travaillent a commencé à augmenter progressivement. Les femmes se divisent alors en deux groupes : celles qui travaillent toute leur vie et celles qui alternent entre vie professionnelle et vie de femme au foyer. C’est à partir des années 70, que l’on observe une continuité de l’activité professionnelle. À partir de cette date, et pour encourager les femmes à s’insérer encore plus dans la vie active, plusieurs lois sont votées. Les principales sont :
- En 1972, est proclamée l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
- En 1983, l’égalité professionnelle
- En 1986, une circulaire qui préconise la féminisation des termes de métiers, grades et une politique volontariste. Le but est de diminuer les discriminations dont sont encore victimes les femmes au travail.
Qu’en est-il, aujourd’hui, de cette volonté à l’égalité hommes/femmes au travail ?
Quel est le constat aujourd’hui ?
Aujourd’hui, et fort heureusement, il est ancré dans les esprits (la plupart) qu’il est normal qu’une femme travaille au même titre qu’un homme. En revanche, force est de constater qu’il existe encore de nombreuses différences.
Déjà, il existe une disparité importante dans la nature des métiers exercés. De nombreux métiers sont quasiment exclusivement féminins (sage-femme, assistante maternelle, aide-soignante, etc.). Certes la situation évolue, mais que c’est lent… !
La présence croissante des femmes dans certains métiers dits « d’hommes »
En effet, les femmes sont de plus en plus présentes dans des métiers auparavant réservés exclusivement aux hommes. Elles ont eu accès au fil du temps à des postes de cadres, d’ingénieurs et aussi aux professions libérales, par exemple. Elles sont aussi de plus en plus représentées comme commerciales, leurs atouts dans les négociations ayant été reconnus. Elles seraient même meilleures négociatrices que les hommes !
Mais certains secteurs et métiers restent exclusivement masculins
Par choix ou par la force des choses
Certains secteurs comme le bâtiment, l’énergie, l’informatique, l’électronique, la mécanique et des métiers physiques comme manutentionnaire, bûcheron, maçon, reconnaissons-le, n’attirent pas les femmes. Ces derniers étant très physiques, voire même « trop », peu de femmes y postulent.
Et dans les autres secteurs ?
Si certaines femmes font le choix de ne pas se diriger vers certains secteurs ou métiers, qu’en est-il des autres ? Bien que les femmes semblent faire leur place dans des métiers jusqu’ici encore très « masculins », le chemin paraît encore long dans certains domaines pourtant « accessibles » comme la politique, l’entrepreunariat et les postes à responsabilité. La « parité hommes/femmes » pour accéder à ses métiers est encore loin d’être une évidence.
Une situation qui s’améliore mais des inégalités qui persistent …
Le plafond de verre
Selon la Banque Mondiale, la France fait partie des six pays du monde où les droits des femmes sont les plus respectés. Dans les faits, c’est beaucoup moins rose !
En effet, malgré une place croissante des femmes dans le monde du travail, elles restent encore largement minoritaires aux postes de décisions (cadres, entrepreneurs, politiques…). Il existe, en effet, ce que l’on appelle le « plafond de verre » ou encore « glass ceiling » qui entrave leur carrière. Cette expression, apparue aux États-Unis à la fin des années 1970, décrit l’ensemble des obstacles que rencontrent les femmes dans leur chemin pour accéder à des postes à responsabilités ou plus généralement dans des postes plus élevés dans la hiérarchie professionnelle. Je vous conseille la lecture de cet excellent article si vous voulez en savoir plus : https://www.scienceshumaines.com/peut-on-en-finir-avec-le-plafond-de-verre_fr_22408.html.

Pire encore, nombreuses sont celles qui ont été confrontées à ce que l’on appelle « la promotion canapé »… C’est-à-dire qu’elles ont dû « coucher » pour bénéficier d’une évolution. Même si ce sujet est plutôt tabou, il n’en reste pas moins une triste réalité pour un bon nombre de femmes encore aujourd’hui.
Les inégalités salariales
Et lorsqu’elles arrivent à gravir les échelons reste encore le problème de l’inégalité salariale. En effet, à postes égaux, trop de femmes restent encore moins payées que les hommes. En 2019, d’après le collectif féministe « Les Glorieuses », les Françaises ont commencé à travailler “bénévolement” le mardi 5 novembre 2019.
Quelques données pour décrypter ces inégalités :
- 17,4%, c’est le pourcentage de différence entre ce que gagne une femme et un homme à temps plein sur une année.
- 21%, c’est le pourcentage d’écart qui existe entre les hommes et les femmes pour un poste de cadre équivalent.
- 8,4%, c’est le taux représentant des inégalités de salaire liées aux discriminations ou aux stéréotypes, qui peuvent bloquer l’avancement salarial des travailleuses.
Même si des lois ont été mises en place ces dernières années et que des efforts sont réalisés, ne pouvons-nous pas faire plus en faveur d’une égalité encore meilleure entre les hommes et les femmes au travail ?

Qu’en sera-t-il demain ?
La priorité semble être donnée à l’abolition des inégalités salariales.
« Avant la fin du quinquennat, les femmes seront aussi bien payées que les hommes dans les entreprises », selon les mots de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, mardi 23 octobre 2018. Elle a ajouté qu’à partir du 1er janvier 2019, les sociétés de plus de 50 salariés où des inégalités salariales entre femmes et hommes auront été constatées, disposeront de trois ans pour agir. En faveur de l’égalité salariale. Si cette loi n’est pas respectée, une sanction financière équivalente à 1% de leur chiffre d’affaires leur sera appliquée.
« Dans cinq ans, il faut que l’on ait réglé ce problème qui est une honte et qui est mauvais pour les femmes et pour l’économie”, a-t-elle annoncé.
A priori, c’est l’inspection du travail qui doit réaliser des contrôles… 7 000 contrôles étaient prévus dans les entreprises de plus de 1 000 salariés en 2019. Ont-ils été menés ? Et quid des sanctions… et des entreprises plus petites qui sont les plus nombreuses ?
Alors, oui, il y a des progrès, mais que c’est lent ! Surtout lorsque l’on est directement concernée en tant que femme…
Mais, essayons de voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide et démarrons l’année pleines d’enthousiasme. Continuons à nous battre pour une meilleure égalité et pour l’abolition des différentes inégalités (salaire, discrimination à l’embauche, sexisme etc.). Le combat n’est pas terminé et je suis sûre qu’il ne sera pas vain !
Charlotte Vallet – Sophrologue et hypnothérapeute à Paris

-

S’aimer : c’est avant tout accepter ses défauts autant que ses qualités
Je suis nulle, je ne suis pas capable de…, je suis trop ceci, pas assez cela ! Avez-vous remarqué que l’on passe plus de temps à focuser sur nos défauts plutôt que sur nos qualités ? Qui se lève le matin, en se disant : waouh ! Que je suis quelqu’un de bien ! Mis à part quelques narcissiques, nous avons tous tendance à nous dévaloriser plutôt qu’à nous valoriser.
Pourtant inverser cette tendance vaut le coup d’y réfléchir ! Car à force de ne se focaliser que sur ses défauts, on ne profite pas de grand-chose en fait. Voire pire, ça peut nous miner.
S’aimer soi-même n’est pourtant pas vraiment différent que d’aimer quelqu’un d’autre. Quand on aime une personne, c’est bien sûr pour ses qualités, mais tant que l’amour est là, on accepte aussi ses défauts. Alors pourquoi n’est-ce pas la même chose pour soi-même ?
Et sauf preuve du contraire, nul n’est parfait. Tout le monde a des défauts. Cela fait partie de la personnalité de chacun. Y compris de soi-même. Il faut faire avec.
Alors comment faire pour que nos propres défauts ne nous rendent malheureux (ou malheureuse) ? Comment les accepter ?
La première étape : identifier nos défauts et le type de défauts
Accepter ses défauts, c’est avant tout bien les identifier. Ici, je parlerai plus de défauts liés à la personnalité. « Les défauts » dits physiques relèvent très souvent de nos critères sociétaux… Et là, on pourrait aussi en parler des heures. C’est pourquoi, ici, j’ai choisi d’aborder, dans un souci de clarté, les défauts en lien avec notre personnalité.
Parmi les nombreux traits de caractère qui définissent une personne, il y a plusieurs catégories de défauts :
- Ceux qui nous pourrissent la vie, ou celle de notre entourage, et qu’il faut donc corriger (radin, égoïste, jaloux…).
- Et il y a ceux qui font partie intégrante de notre personnalité, et peut-être de notre charme (exubérant, timide…)
Inutile de les masquer, acceptons-les, comme on les accepte chez autrui.

Ensuite, une fois identifié(s), il faut essayer de le(les) corriger
Dans la première catégorie, celle des défauts qui empoisonnent la vie, on peut donc citer la jalousie, par exemple. Il s’agit d’un sentiment interne, violent, destructeur. Non seulement il faut savoir le reconnaître, mais il est nécessaire de travailler sur soi pour s’en défaire.
Pourquoi est-on ainsi ? Pourquoi toujours comparer sa situation à celles des autres ? Est-ce leur vie que nous vivons ? Pourquoi pense-t-on que ce que possède l’autre le rend meilleur ou plus heureux ? Pourquoi ne pas se concentrer sur ce que l’on détient soi-même et que les autres n’ont pas ?
Cela ne se règle bien sûr pas en une journée. Il s’agit d’un processus assez long qui demande patience et persévérance. Vous pouvez, pour ce faire, essayer d’en parler avec un professionnel, ou chercher les causes via l’hypnose. N’hésitez pas à me contacter si vous en souffrez ! C’est mon travail…
Car, une fois le travail accompli, vous vous sentirez soulagé, libéré, mieux avec vous-même et donc mieux avec les autres.
Ce type de défaut a toujours une cause. Et dès lors, qu’elle est identifiée, que l’on en parle, il existe des solutions pour la traiter.
Faites de vos défauts un atout
Dans la deuxième catégorie de défauts, celle des défauts qui font partie intégrante de nous, Il est également possible, bien sûr, de les « traiter », mais peut-être est-il plus intéressant de les maîtriser.
Prenons l’exemple de la timidité. On conseille souvent aux gens timides de se mettre à faire du théâtre, de se glisser dans la peau d’un personnage, ce qui permet de s’oublier soi-même et donc de laisser libre court à son expression. On propose aussi aux timides de se « mettre en danger », de sortir de leur zone de confort en prenant la parole en public.
À apprendre à surpasser ses hésitations, à ne pas paniquer au premier bafouillage.
Et c’est là que les timides peuvent alors s’apercevoir combien leur auditoire porte sur leur prestation un regard beaucoup moins sévère que celui qu’ils portent eux-mêmes sur eux.
Mais, ce n’est pas pour autant qu’il faut anéantir à jamais sa timidité. Celle-ci fait partie de vous, et votre entourage vous apprécie également pour cela. Pour votre réserve, votre pudeur, votre façon de ne jamais parler pour ne rien dire. Il ne s’agit pas de se défaire de votre timidité, mais de jouer avec elle, de la prendre à contre-pied, et surtout d’en faire un atout.
Sachez par exemple que la quasi-totalité des grands chanteurs, musiciens et acteurs de théâtre sont tenaillés par le trac quand ils doivent monter sur scène. Mais c’est un défaut qui les stimule, car ils l’ont accepté. Ils ne peuvent d’ailleurs même plus s’en passer.

Mes défauts sont aussi des qualités
Accepter ses défauts, c’est aussi reconnaître qu’ils vous donnent des qualités. Essayez de visualiser et de formaliser autrement vos défauts ! Exemples :
- Vous êtes têtu(e) ? Non : vous être opiniâtre, déterminé(e).
- Vous êtes prétentieux ? Non : Vous faites preuve d’assurance.
- Vous êtes trouillard(e) ? Non : vous êtes prudent(e).
- Vous êtes radin(e) ? Non : vous dépensez l’argent à bon escient.
- Vous êtes exigeant(e), perfectionniste ? Non : Vous aimez surtout le travail bien fait.
C’est comme pour un entretien d’embauche où les candidats qui se sont préparés à la question-piège classique : « Quels sont vos trois principaux défauts ? », transforment systématiquement leurs défauts comme une force pour le poste convoité.
Alors, listez vos défauts et transformez-les en des mots positifs. Vous serez surpris !

Accepter les critiques et les compliments
Mais il est vrai que ce n’est pas si simple. Surtout lorsque des critiques nous parviennent des autres. Ah… Le regard des autres…
Eh bien, sachez que reconnaître ses défauts, puis les accepter permet aussi d’anticiper le fait de se vexer suite à une critique. En effet, il peut arriver que de manière inattendue, un proche, un collègue, un employeur nous reproche un trait de caractère.
S’il s’agit d’un défaut que nous avons déjà identifié, sur lequel nous avons travaillé, en l’acceptant ou en le corrigeant, on accepte plus facilement la critique.
S’il s’agit d’un reproche que l’on ne nous a jamais fait jusqu’alors, alors il convient de prendre note de l’information, de l’analyser calmement et ensuite d’y travailler.
Vous vous apercevrez qu’accepter la critique vous rend beaucoup plus zen.
C’est d’ailleurs tout aussi vrai pour un compliment. Il faut savoir l’accepter avec lucidité. Ne pas le rejeter, si on le juge excessif au premier abord. L’analyser et l’accepter comme tel, c’est-à-dire le considérer légitime, ne pas ressentir le fameux syndrome de l’imposteur.
Alors… Et si vous tentiez de relever le défi ?
Vous n’êtes pas parfaite et alors ? Êtes-vous pour autant moins bien qu’un(e) autre ?
Non.
Y a-t-il parmi les huit milliards d’humains dans le monde ne serait-ce qu’une seule personne qui soit parfaite ?
Aucune.
Avoir un défaut n’est pas une faiblesse. L’accepter vous rend plus fort. Et surtout plus zen. Alors, posez-vous quelques minutes. Faites le point sur « vos défauts », faites le tri aussi, et prenez-les en main. Vous verrez que vous y gagnerez énormément surtout sur l’amour que vous vous portez, amour qui est essentiel pour avancer.
Charlotte Vallet – Sophrologue et hypnothérapeute à Paris
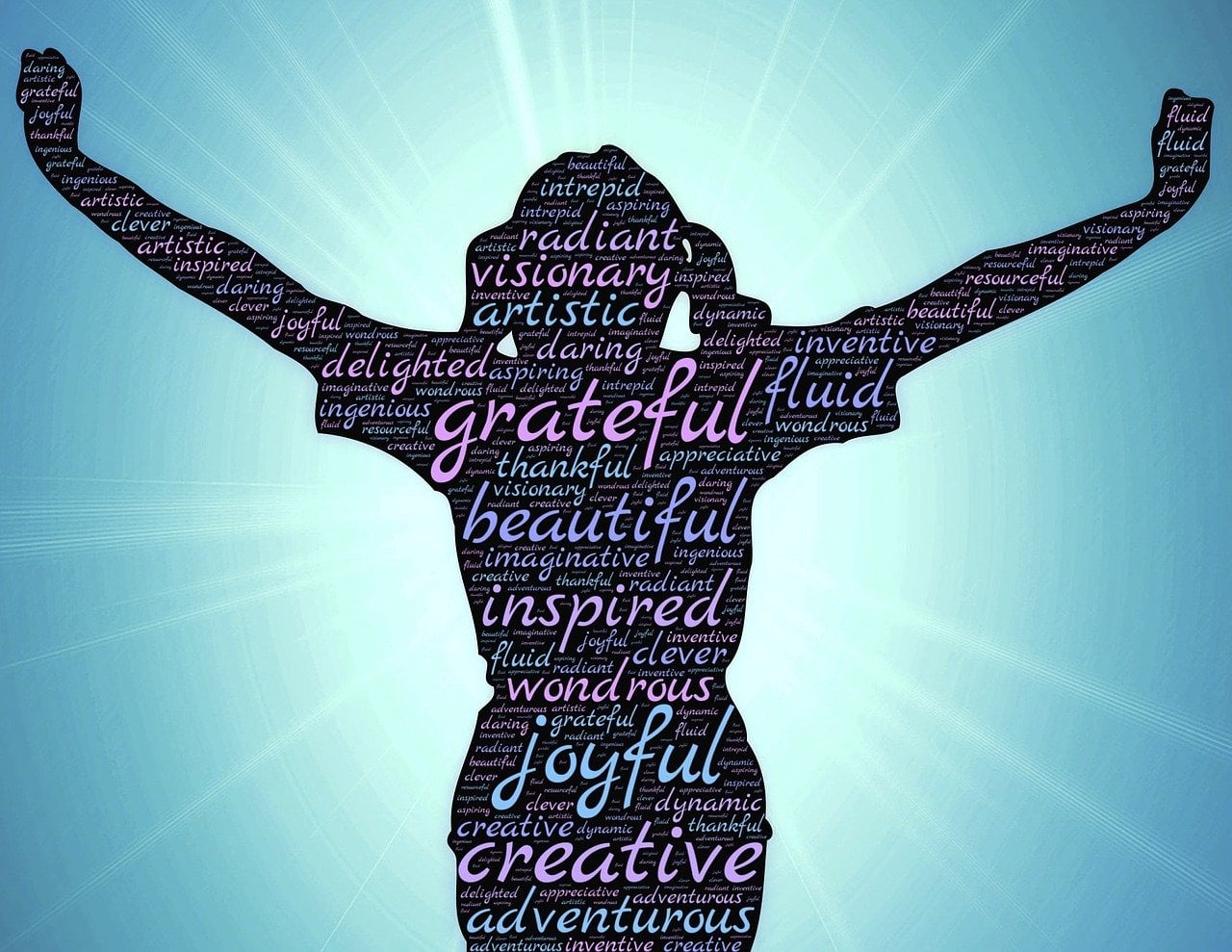
-

Les femmes se remettent-elles plus en question que les hommes ?
Libérée, délivrée… Désolée, si je vous mets cet air en tête pour toute la journée… mais c’est en écoutant ce refrain que je me suis dit : les femmes sont tout de même devenues de véritables battantes. Et cette liberté, cette délivrance, elles ne tombent pas du Ciel.
Un grand nombre de femmes dénoncent de plus en plus leurs difficultés et ne se contentent plus de subir, mais elles cherchent comment s’en sortir, comment les résoudre.
On dit souvent que les femmes se posent trop de questions, qu’elles se remettent plus en question… plus que les hommes ? Est-ce un problème ?
Car se remettre en question et s’interroger sur soi-même sont des démarches saines et même salutaires. L’introspection donne à chacun (et chacune) d’entre nous des atouts psychologiques qui permettent de nous libérer de certitudes parfois trop ancrées, et aussi de trouver une issue pour sortir des moments difficiles.
Et curieusement, il semble que les femmes soient plus enclines que les hommes à pratiquer cette remise en question. L’introspection serait donc une activité essentiellement féminine. Est-ce une simple impression ? Pas si sûr.
La remise en question s’accorde au féminin
Nous pouvons le vérifier chaque jour dans notre entourage : les femmes se posent globalement plus de questions que les hommes. Sur le sens qu’elles donnent à leur vie, sur les raisons de leurs passions amoureuses, sur les ambiguïtés qui naissent de leurs relations, sur leur rôle de mère parfaite ou d’épouse idéale… la liste est loin d’être exhaustive (rires).
Sommes-nous les seules à nous poser ces questions existentielles ? Les hommes ne s’en posent-ils aucune ?
Dans les faits, il est fort probable que femmes et hommes se posent autant de questions au cours de leur existence.
Mais on a culturellement appris aux hommes à ne pas exprimer leurs émotions, à masquer ce qui serait considéré comme « une faiblesse ». Les questions existentielles sont ainsi souvent refoulées par pur « virilisme » dans une activité annexe (le travail, le sport, le jeu…) qui occupe le « temps de cerveau disponible ».
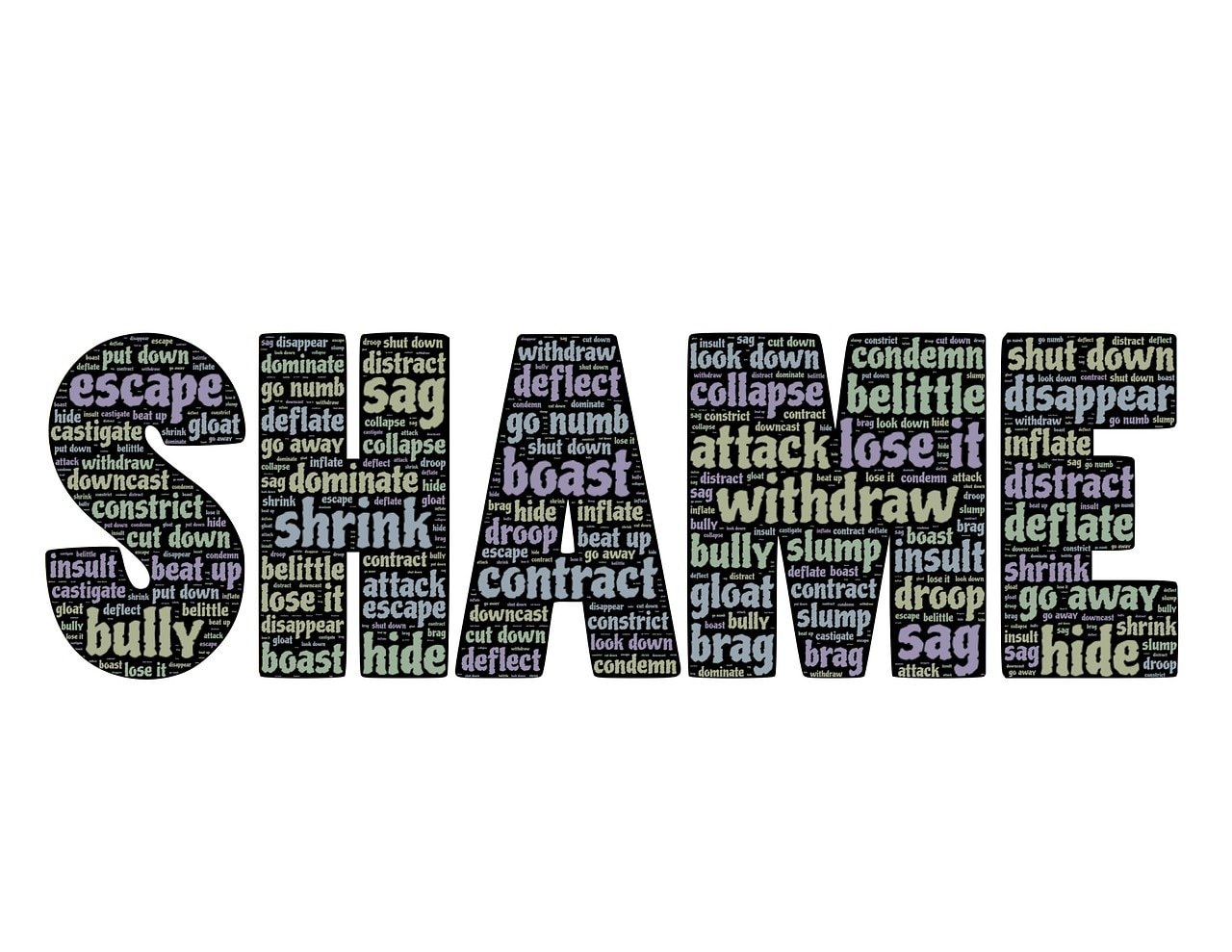
Les femmes, au contraire, expriment plus volontiers leurs émotions, leurs craintes, leurs interrogations. Elles y sont « autorisées ». Ce qui laisse en effet à penser que la remise en question s’accorde au féminin.
Un questionnement permanent
La femme se pose mille questions. Elle a constamment besoin de faire le point. Elle se considère plus terre à terre, plus proche des contingences de la vie quotidienne. Une femme est globalement plus inquiète pour sa santé ou celle de ses proches, pour son avenir, pour l’image qu’elle donne d’elle-même. Elle s’inquiète aussi beaucoup pour son entourage, pour ses enfants et leur potentiel, pour son mari et sa réussite, pour la famille et les amis…
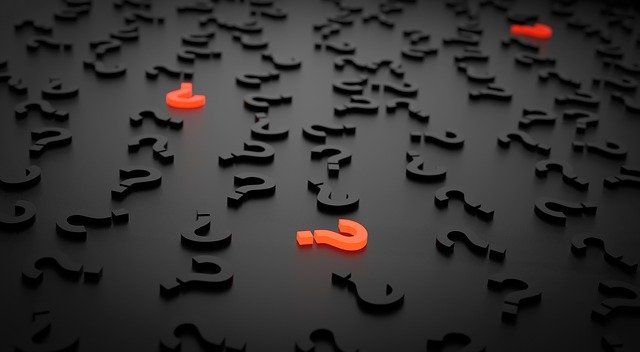
Et lorsqu’elle est amoureuse, la femme s’interroge encore plus. Sur l’engagement de son conjoint dans cette relation… sur sa capacité à vraiment aimer. Elle décortique, pèse le pour et le contre, traque les axes d’améliorations, évalue les hypothèses… tandis que l’élu de son cœur (s’il est masculin) se contente de vivre sa passion au jour le jour, le sourire béat. Il ne se posera des questions que le jour où il commencera à avoir des doutes sur sa compagne, lorsque la relation commencera à se dégrader.
C’est souvent salutaire mais pas toujours sauf si…
Dans le cerveau d’une femme, l’intellect et les émotions sont moins compartimentés que dans celui d’un homme. Son analyse d’une situation diffère ainsi de celle de son compagnon. Là où lui classe rapidement le dossier, elle cherche encore et toujours à comprendre, à expliquer, à émettre des hypothèses, à remettre en cause. Son questionnement est permanent.
Mais attention… Une femme qui se montre trop réceptive aux pensées négatives, et qui est dépassée par tous ces questionnements multiples, peut vite sombrer dans la déprime. La femme se trouve ainsi plus exposée qu’un homme aux périodes d’anxiété et à la dépression. Son éveil permanent l’empêche de se construire une carapace aussi imperméable aux émotions que celle de l’homme.
Les femmes ont donc un besoin plus fort de réfléchir à leur situation. J’ai déjà évoqué dans un article précédent le problème de la charge mentale (le syndrôme de la femme épuisée) dont sont sujettes de nombreuses femmes. Celles-ci font de la bonne tenue de leur foyer une mission à laquelle elles ne peuvent déroger. Je proposais comme principal « remède » un changement de comportement vis-à-vis du conjoint mais aussi de soi-même. Or ce changement, très profond, souvent difficile, nécessite une vraie remise en question.
Et la bonne nouvelle, c’est qu’elles y parviennent de plus en plus ! Elles osent affronter leurs peurs, entre autres.

Ainsi les femmes sont plus disposées que leurs compagnons masculins à réaliser les changements qu’elles estiment nécessaires. Là où l’homme cherchera le plus souvent un compromis, la femme n’hésitera pas à modifier radicalement son comportement, ses habitudes, son cadre de vie. Elle envisagera ainsi plus rapidement une séparation, par exemple.
Mais très souvent, ce processus n’est obtenu qu’après une thérapie plus ou moins longue.
Le recours aux thérapies
La femme, c’est un fait, a besoin de rêver, de se nourrir d’émotions (quitte à se laisser parfois (souvent même) envahir par des émotions négatives). Et ce besoin, elle l’exprime couramment. Auprès de son compagnon, de ses amis, de sa famille. Et si elle ne trouve ni écoute, ni solution, elle se tourne plus volontiers vers un spécialiste.
Les études démontrent que 70 % des personnes qui consultent un psychothérapeute sont des femmes. Moi-même, sophrologue et hypnothérapeute, j’ai une patientèle qui est composée à 80% de femmes.
Pourquoi une minorité d’hommes ? Les hommes rechigneraient-ils à bousculer leurs convictions ?
- Oui… pas tous mais une majorité.
Un homme a-t-il plus peur d’être confronté à des vérités qu’il n’accepterait pas ?
- Oui… pas tous mais une majorité.
Ou peut-être plus simplement estime-t-il, suite à notre système éducatif, que consulter un thérapeute n’est pas une démarche “normale”, qu’elle relève une faiblesse, voire un psychisme défaillant.
Le problème est bien là, à mon avis…

Conclusion
Alors oui : la femme se remet plus souvent en question que les hommes. Elle s’interroge constamment sur le sens de ses actions, de ses relations, de sa vie.
Elle est plus curieuse d’elle-même que peut l’être un homme « naturellement ». Et franchit plus rapidement la porte lorsqu’il s’agit d’essayer les thérapies alternatives et la médecine douce qui peuvent l’accompagner dans sa démarche.
S’interroger sur soi, c’est chercher à vivre pleinement sa vie. Il faut juste apprendre à ne pas se laisser parasiter par les sentiments négatifs et destructeurs. Et très certainement faire comprendre aux hommes qui intériorisent toutes leurs émotions, qu’ils devraient essayer, eux aussi, de se remettre en question. De mon point de vue, lequel je pense est largement partagé, ce serait plutôt un signe de courage que de faiblesse.
Et pour aller encore plus loin… on peut même penser que cela réduirait considérablement les problèmes de violence…
À bon entendeur…
Charlotte Vallet – Sophrologue et Hypnothérapeute à Paris
-

La charge mentale : le syndrome de la femme épuisée
À peine réveillée, votre esprit est déjà en suractivité et passe en revue tout ce que vous avez à faire dans la journée ? Penser à aller chercher les enfants au sport, prévoir les courses pour le dîner (et pour celui de demain où vous avez invité quelques amis). Passer au pressing chercher les chemises de votre conjoint, aller à la pharmacie pour prendre le sirop pour Antoine, téléphoner au vétérinaire pour le vaccin de minou, envoyer le paiement de vos impôts, etc. etc. etc. etc. etc.
Ah j’oubliais. Et bien sûr, aller travailler !
Vivement le week-end durant lequel vous pourrez prendre le temps de faire les machines à laver, repasser, le ménage et vous occuper un peu plus des devoirs de vos enfants !
Et votre conjoint ? Il fait quoi ? Beh… il travaille !?! Mais sûrement plus, plus tard, plus loin ? Voilà ce que nous entendons systématiquement.
Notre société a beau évoluer dans le sens de l’égalité homme-femme, la bonne tenue d’un foyer reste, dans nos mentalités, même au 21e siècle, l’affaire des femmes. Et dans une société qui évolue en mode accéléré, il est donc normal que les femmes finissent par s’épuiser… Pourtant, on parle de plus en plus du partage des tâches…

Le partage des tâches… où en est-on vraiment ?
Il faut reconnaître que de plus en plus d’hommes participent à la vie quotidienne. Pourtant les femmes demeurent encore les impliquées dans la tenue du foyer.
Les femmes seraient-elles donc conditionnées pour se sentir obligées d’être de parfaites épouses, mères et d’irréprochables maîtresses de maison ? Oui, c’est une réalité. Il semble d’ailleurs que même dans un couple où le partage des tâches est avéré, l’épouse reste la plus inquiète des deux dans la bonne gestion des actes de la vie quotidienne.
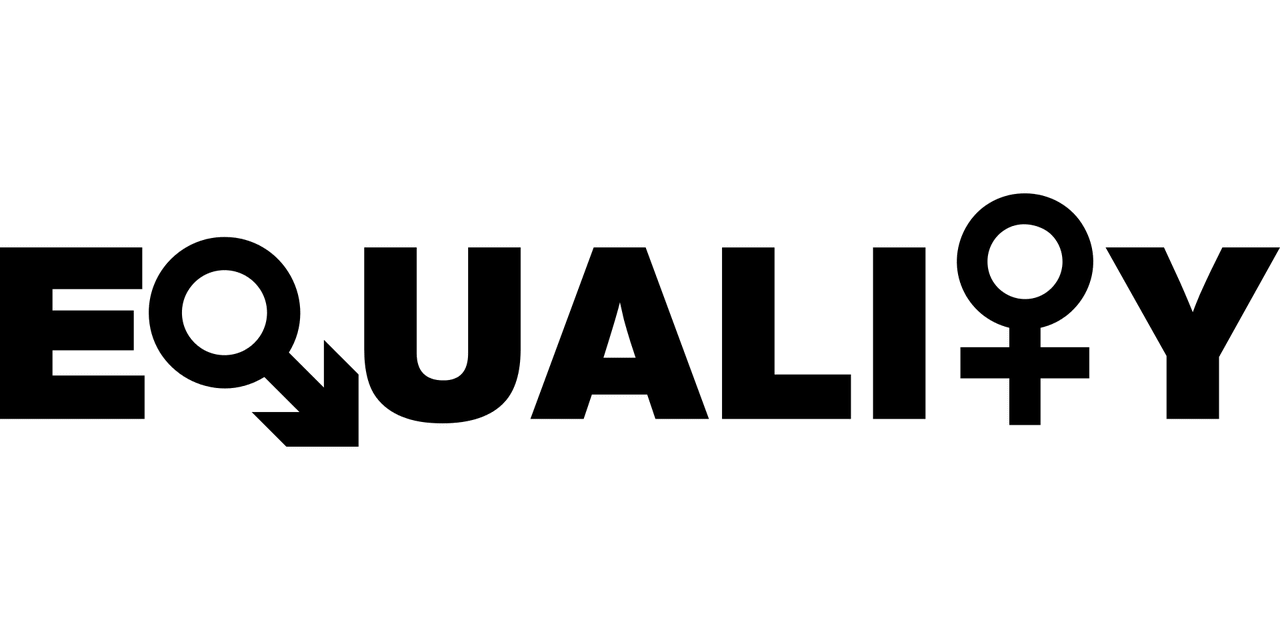
Mais avant tout, le partage des tâches est-il aujourd’hui une réalité ?
Des études menées en 1985 révélaient que les femmes en France étaient chargées de 69% des tâches ménagères du foyer, et à 80% de l’éducation des enfants. 25 ans plus tard, les mêmes études démontrent un net progrès sur le plan parental (71%) mais une très infime progression sur le plan des tâches ménagères (64%).
Il reste donc du chemin à faire pour atteindre un parfait 50/50. Les hommes ont beau s’efforcer de faire la part qui leur revient, les femmes restent sujettes à ce qu’on appelle aujourd’hui la charge mentale. Mais qu’est-ce que la charge mentale ?
Qu’est-ce que la “charge mentale” ?
C’est une théorie développée par une chercheuse canadienne, Nicole Brais. La compagne, se met plus de pression que son conjoint dans le bon ordonnancement du foyer. Elle doit « penser à tout ». Même lorsque monsieur fait, madame se sent obliger de superviser, de vérifier la bonne exécution des tâches. Celles du conjoint, des enfants, mais aussi de la femme de ménage alors que les services de celle-ci ont été demandés pour éviter le problème.
Cette charge est d’autant plus stressante de nos jours que les femmes ont désormais un emploi. Au stress du travail s’ajoute donc celui de la maison, ce qui alimente un épuisement mental très élevé. Nicole Brais, la chercheuse canadienne, insiste beaucoup sur une petite phrase malheureuse qui survient lors d’une situation que connaissent beaucoup de couples.
Madame, au four et au moulin, oublie le fer sur la table à repasser ou le lait sur le feu. Monsieur croit alors venir la consoler en lui adressant un malheureux « Pourquoi tu ne me demandes pas de t’aider ? ».
La phrase qui fait souvent exploser une femme. En quelques mots, le conjoint admet considérer que c’est la femme qui est la responsable des tâches ménagères. Consciemment ou non, les hommes n’interviennent pas tant que les femmes ne leur auront pas spécifiquement assigné à une mission.
Ainsi dans chaque foyer, il y a un membre victime de charge mentale, et c’est quasiment toujours la femme. Celle-ci prend donc le leadership du foyer sur les tâches ménagères, les courses, l’éducation des enfants tout en assumant un métier exigeant et en essayant même de se dégager du temps pour une vie sociale.

Comment en finir avec la charge mentale ?
Ne pas trop se réjouir d’être une bonne ménagère !
Il faut d’abord faire admettre aux hommes qu’ils ont un rôle à jouer. Mais il faut également que les femmes comprennent que leur attitude peut engendrer ces comportements inégaux. Souvent, l’investissement remarquable des femmes reçoit l’approbation passive des hommes. Beaucoup de femmes semblent alors s’épanouir dans ce rôle ! Mais jusqu’à quand ? Jusqu’à… l’épuisement…
Ne pas être systématiquement reconnaissante
Lorsqu’un homme prend l’initiative de faire la vaisselle (par exemple), la femme approuve souvent la démarche et adresse un remerciement qui confirmerait le caractère « exceptionnel » de la situation. Alors qu’elle devrait faire comme si de rien n’était, ne pas habituer son conjoint à des remerciements à chaque effort réalisé. C’est normal !
En finir avec le besoin de tout contrôler et le besoin que tout soit parfait
Il y a aussi le syndrome de « l’inspectrice des travaux finis », ce moment (que l’on a évoqué plus haut) ou la femme vérifie si le travail de son conjoint a été bien fait. Un irrépressible besoin de contrôler qui, finalement, déresponsabilise celui qui l’a fait. C’est encore pire quand on reproche systématiquement à son conjoint qu’il s’est encore trompé de marque ou de produit quand il revient des courses, ou que décidément il n’est pas doué pour telle ou telle tâche. Avec au bout du compte l’expression qu’il faut pourtant éviter à tout prix “Laisse, je vais faire…”.
Un amas de clichés ? Certes, le trait de mes exemples est quelque peu grossi, mais ce sont des situations que vivent réellement, avec plus de nuances, de nombreux couples. La solution est souvent d’inviter le conjoint à faire sa part. Non pas en lui assignant des tâches d’autorité, mais en lui laissant implicitement l’espace des tâches à réaliser. Laisser traîner des choses. Le laisser s’en occuper et, surtout accepter qu’il s’en occupe à sa façon. Une démarche qui ne se fera pas du jour au lendemain, et qui peut même générer quelques tensions. Mais on sait que les choses ne peuvent que s’aplanir et s’améliorer dans le dialogue et le respect mutuel.

Casser les clichés et changer notre attitude
Il est donc important de briser la figure un peu vieillotte de la maîtresse de maison. Casser le cliché selon lequel monsieur rentre à la maison pour se reposer, après une longue journée de travail. Aujourd’hui un homme n’est plus le seul à assurer les revenus du foyer. L’épouse du XXIe siècle à un job, il arrive même qu’elle soit mieux payée que son conjoint, qu’elle exerce un métier beaucoup plus exigeant ! L’époque n’exige plus qu’elle soit la wonder-woman du foyer.
Plus facile à écrire qu’à faire. Nous sommes tous (toutes) un peu conditionné(e)s par l’image que donnaient nos parents, cette espèce d’harmonie du couple qui semblait émaner de la maman « multitâches » et du papa moins concerné. Une harmonie pourtant fort trompeuse… car on en voit aujourd’hui les dégâts… Mais c’est à nous désormais de changer les choses et nos propres comportements !
Charlotte Vallet – Sophrologue et Hypnothérapeute à Paris
-

L’intuition féminine, un mythe ou une réalité ?
« Tiens, ça fait longtemps que je n’ai pas eu de nouvelles de Juliette » Et quelques secondes plus tard, le téléphone sonne, et c’est Juliette ! « Ce mec n’est pas fait pour toi. Je le sens », vous a dit une amie. Et en effet, il n’était pas bon pour vous !
Eh oui, c’est comme si certaines (certains ?) d’entre nous possédaient un don… celui de prévoir les choses. Mais paraît-il que ce don, appelons-le tout de suite « intuition », est typiquement attribué à la gent féminine.
En effet, on parle souvent « d’intuition féminine ». Voici donc un avantage que nous possédons sur les hommes ! Mais, les hommes n’en ont-ils vraiment pas ? Sommes-nous les seules, nous les femmes, à posséder cette faculté ? D’ailleurs l’intuition, est-ce que ça existe vraiment ?
Mais tout d’abord, qu’est-ce que l’intuition ?
On emploie le terme d’intuition lorsqu’un ressenti se révèle exact, lorsqu’une hypothèse spontanée se transforme en réalité, lorsque l’on a le sentiment de déjà bien connaître un domaine alors qu’on le découvre.
Avoir une intuition, c’est souvent deviner au premier abord si une personne est digne de confiance, c’est savoir quel est le bon chemin alors qu’aucun panneau ne le confirme. C’est aussi ressentir que quelque chose ne va pas, ou même parfois qu’il va se passer quelque chose.
Contrairement à l’instinct, qui est un comportement inscrit dans nos gènes, dans notre disque dur, l’intuition se base sur la sensibilité, l’éducation, le vécu, sur une somme de données sauvegardées dans notre mémoire vive. C’est cette somme d’expériences, de souvenirs, souvent nichés dans l’inconscient, qui nous permet une analyse très rapide d’une situation, avec un temps de calcul infinitésimal. D’où mon analogie à l’informatique.

L’intuition serait-elle exclusivement féminine ?
Mais pourquoi parle-t-on d’intuition spécifiquement féminine ? Serait-ce un genre d’intuition propre au sexe féminin, qu’aucun homme sur terre n’aurait connu ?
Peut-être que la sensibilité des femmes est plus exacerbée que chez les hommes, ce qui permettrait de ressentir ou de pressentir des choses ? Écoutons notre entourage.
“Un jour, mon petit ami devait prendre la route. Je ne sais pas pourquoi, je voulais l’empêcher de prendre le volant, quelque chose n’allait pas, c’était indéfinissable. Une heure après, il a été victime d’un accident. Il s’en est sorti avec une jambe cassée, mais j’avais eu ce pressentiment, cette intuition”. Nathalie a gardé ce souvenir, cette révélation de l’intuition.
Mais est-ce proprement féminin ? “Je pense que ça se produit surtout quand tu connais bien une personne, que tu as des sentiments très forts pour elle. Et peut-être aussi une sensibilité à fleur de peau.”
L’intuition féminine, ce sont peut-être les hommes qui en parlent le mieux. Kévin, 34 ans : “J’étais revenu d’un séjour à l’étranger. Je retrouve mon épouse à l’aéroport. Elle est d’abord très chaleureuse puis rapidement elle devient bizarre. Arrivé à la maison, elle m’accuse de l’avoir trompée pendant mon voyage. Ce qui, j’ai honte de l’avouer, n’était pas faux. Mais comment a-t-elle pu le deviner ? Il a peut-être suffi d’un tic, d’un regard fuyant, d’un sourire forcé. Allez savoir.
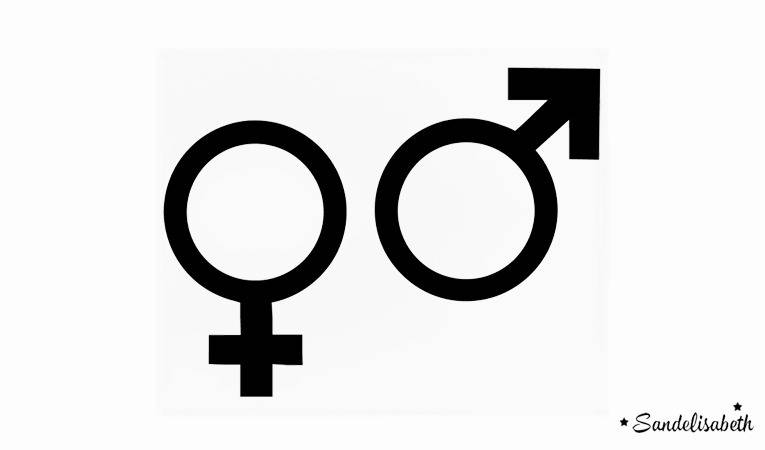
On accorde également à la femme beaucoup plus d’empathie qu’à l’homme. Question d’éducation, de culture. La femme étant, reconnaissons-le, plus à l’écoute de son interlocuteur, elle devine par expérience certaines choses. C’est notamment le cas avec les enfants. Assignée le plus souvent à son éducation, la femme perçoit provenant d’un enfant des signes que l’homme ne ressent pas. On évoque dans ce cas une notion d’instinct maternel, un sujet qui fait autant débat que l’intuition féminine.
Bref, nous pouvons conclure ce paragraphe, en affirmant qu’il existe un lien entre sensibilité, écoute, concentration et intuition. Ne vous vexez pas messieurs, certains d’entre vous le sont (sensibles, et si c’est votre cas, vous devez très certainement, tout comme nous, être dotés d’intuition.
Acquis ou inné ?
Du côté des opposants à la féminité de l’intuition, les arguments ne manquent pas. L’intuition serait humaine et n’aurait pas de sexe. Elle serait seulement due à la sensibilité de la personne, à son vécu, ses expériences, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme.
Certaines personnes, hommes et femmes confondus, voient même dans cette notion d’intuition féminine quelques relents de sexisme. Depuis l’aube de l’humanité, on attribue l’intelligence, la logique cartésienne, le rationnel aux messieurs, et aux dames l’émotion, l’intuition, la sensibilité. On apprend très tôt aux garçons à réprimer leurs émotions (“on ne pleure pas quand on est un homme”) alors que les jeunes filles sont plus souvent invitées à exprimer leur ressenti, leurs douleurs, leurs craintes.
Ainsi la femme serait-elle plus disposée à écouter son intuition, contrairement à l’homme.
Alors nous pouvons conclure sans prendre trop de risques que l’intuition est plutôt acquise qu’innée.

Et la science dans tout ça ?
On trouve donc difficilement des éléments tangibles qui nous prouvent que l’intuition serait avant tout féminine, du moins inhérente à l’inné plutôt qu’à l’acquis. Même la science s’est penchée sur le problème. Des travaux très sérieux ont démontré que l’homme est plus enclin à faire fonctionner l’hémisphère gauche du cerveau, celle où réside la logique et la raison. Alors que les femmes utiliseraient équitablement les deux parties, dont celle de droite qui gère les émotions et l’imagination.
La plupart des expériences réalisées sur des panels d’hommes et de femmes au sujet de l’intuition ont donné des résultats très mitigés. Aucune étude n’a donné de chiffres démontrant une incontestable féminité de l’intuition.
Mais on peut se poser une question plus générale : qu’est-ce que la science et sa logique primaire peuvent comprendre à l’intuition, une chose qui dépasse les esprits les plus cartésiens ?
Alors ? Féminine or not féminine ?
On peut donc conclure que l’intuition féminine est une réalité. Il ne s’agit pas d’une sorte de don reçu à la naissance, mais bien d’une capacité que l’on acquiert au cours de la vie, où la femme est finalement plus libre d’exprimer ses émotions, son empathie, ses ressentis. Une sorte de sixième sens que la population masculine aurait perdu et rejeté par convention.
Alors, mesdemoiselles, mesdames, sachez utiliser votre intuition, comme il se doit !
Charlotte Vallet, Sophrologue et hypnothérapeute à Paris
-

Comment éviter le tiraillement des émotions ?
Si nous accueillons toujours avec plaisir les émotions positives telles que la joie, l’amour ou la sérénité, ces émotions sont souvent intimement liées à des émotions contraires telles que la peur, l’anxiété, la tristesse. Ce n’est parfois pas facile à vivre. Alors, comment gérer cette tyrannie des émotions qui s’entremêlent ? Surtout qu’en plus, nous pouvons avoir peur de notre peur, être en colère contre notre jalousie, etc. Avoir honte de notre tristesse. Le comble peut-être étant d’avoir peur d’être heureux… ou de se complaire à être malheureux ?
Mais, pouvons-nous réellement éviter ce combat incessant de nos sentiments contraires ? D’ailleurs, c’est quoi une émotion au fait ? Et que faire ? Lisez cet article et vous aurez peut-être des réponses à vos questions… Je l’espère !
Qu’est-ce qu’une émotion ?
Avant de pouvoir mieux comprendre ce qu’il se passe en nous, il faudrait déjà savoir qui elle est, et apprendre à reconnaître une émotion, vous ne pensez pas ? Alors installez-vous confortablement, et faites une brève rencontre avec l’émotion (théorique bien sûr !)
Alors, qu’est-ce qu’une émotion ? C’est une réaction physiologique du corps à une pensée ou à un évènement extérieur. C’est une énergie qui se crée au sein de notre esprit par la conjonction de différentes causes et conditions. Son intensité, sa force et son importance sont indéniablement rattachées au vécu de chacun. En effet, personne, face à des circonstances similaires, ne ressentira les mêmes choses, ne vivra les mêmes émotions.
Mais alors quelles sont ces émotions ? On recense 4 émotions de base desquelles découlent toutes les autres :
- La peur (la méfiance, le doute, le scepticisme, la prudence, la susceptibilité, etc.)
- La tristesse (la peine, la nostalgie, l’empathie, etc.)
- La colère (la fierté, la générosité, le dédain, l’agressivité, etc.)
- La joie (la surprise, l’enthousiasme, l’euphorie, la propension au bavardage, etc.)

Nos émotions, notre moteur ?
On pense souvent que seul un robot est dépourvu d’émotions ! Qu’il est impossible pour un être humain de n’avoir aucune émotion. Sauf que si, c’est possible. 15 % de la population serait atteinte d’alexithymie. Aléxithy quoi ? Oui, oui, vous avez bien lu, Alexithymie. On connaît tous quelqu’un de notre entourage un peu « taciturne », « renfermé » qui exprime peu ou pas ses émotions. Mais ce « silence des émotions » veut-il forcément dire qu’elles n’existent pas ? Pas vraiment. Cette affectation résulte en fait d’une connexion déficiente entre les centres cérébraux de l’émotion et ceux où elle est représentée de façon consciente. Si la personne ne semble pas pouvoir les identifier, lorsque des paramètres physiologiques sont mesurés, il est constaté que des émotions sont bien présentes. Cette personne ne peut juste pas les exprimer car il ne les perçoit pas. Étrange… je vous l’accorde.
Et en ce qui concerne les autres alors ? Pour les 85 % restants, les émotions sont, cette fois-ci, bien ressenties, voire parfois trop ! Mais même si elles sont parfois douloureuses, elles restent néanmoins nécessaires dans notre vie. En effet, ces dernières alimentent notre sensibilité, enrichissent notre personnalité, nous permettent de créer et d’entrer en communication avec les autres. Malgré tout, nous savons tous qu’elles peuvent être terriblement dévastatrices, porteuses de peurs, d’angoisses et de tristesse.
Certains s’évertuent à enfouir ou à refouler leurs émotions, mais c’est un peu comme reculer pour mieux sauter. L’émotion ne disparaît pas, et souvent elle risque de resurgir de manière encore plus violente avec des comportements excessifs.
Inhérentes à notre personnalité, fondamentales pour notre bonheur et notre équilibre, vouloir les éradiquer ne rime à rien. Elles sont nos petits guides dont les messages sont à décoder, à déchiffrer pour orienter nos choix de vie. Alors, tentons plutôt de les identifier, d’apprendre à vivre avec elles, et de les gérer quand elles s’entrechoquent et nous submergent.

Bien vivre avec nos émotions, c’est possible
Bien qu’elles soient parfois envahissantes et qu’elles nous font vivre l’ascenseur émotionnel, nous pouvons bien vivre avec elles, si nous savons comment les dompter et leur laisser la place qu’elles méritent, ni plus ni moins !
Et c’est bien là que se trouve toute la difficulté.
Comment gérer ce tiraillement entre elles ? Un coup la joie, puis la tristesse, ou la peur et du stress… Cette potion explosive nous menace à chaque instant. Et je pense que vous ne me direz pas le contraire, n’est-ce pas ?
En effet, qui n’a pas connu cette colère qui monte, qui monte et qui explose dans un flot de réactions violentes qu’on ne sait plus gérer et qui sont souvent totalement inappropriées à la situation ?
Ou alors au niveau professionnel, la peur de ne pas avoir de clients lorsque l’on lance sa propre activité mais aussi l’angoisse de ne pas savoir gérer la situation dès qu’ils arrivent. Moi, je vous le dis, lorsque l’on monte sa propre activité, le mélange des émotions contraires est notre compagnon quotidien ! La joie d’avoir un client, la peur de manquer de temps ou de ne pas être à la hauteur… La fierté de progresser, l’angoisse que ça ne dure pas… etc.
Et du côté de notre vie intime, les émotions ne sont pas en reste non plus ! C’est le moins que l’on puisse dire. Qui n’a pas ressenti cette angoisse de ne pas trouver de conjoint avec qui partager sa vie ? Et une fois qu’on le trouve, voilà, on est heureux mais rapidement une nouvelle angoisse nous envahit : celle de le perdre.
À écouter les femmes enceintes, la joie de l’être et l’angoisse concernant le développement du bébé et l’accouchement…
Ce ne sont que quelques exemples, une infime partie de toutes les circonstances de la vie quotidienne qui peuvent nous mettent dans tous nos états émotionnels…
Et nous comprenons donc aisément que le Tsunami peut vite nous noyer ! Mais alors comment faire concrètement pour gérer ses émotions sans se laisser emporter, sans qu’elles nous submergent ? J’utilise le mot « gérer » et pas « contrôler » car comme vous l’aurez compris, contrôler ses émotions est un combat vain. Il s’agit plutôt de se laisser traverser par elles sans souffrir. Pas de panique, j’espère arriver à votre rescousse avec quelques méthodes, thérapies et astuces.

Quelques méthodes pour vous aider
La méditation
À la recherche d’une paix intérieure profonde et surtout de l’apaisement de votre psychisme malmené par vos émotions, la méditation est, en autre, une bonne manière de vous aider. Elle est simple et peut se pratiquer à toute heure et dans n’importe quel endroit, à condition qu’on sache la pratiquer soi-même, bien sûr ! On choisit un lieu que nous aimons, on prend une posture confortable, on tente de lâcher prise et … c’est tout ! On se déconnecte avec soi et ce qui nous entoure et on se relâche, sans s’endormir évidemment ! Et on laisse cet état de bien-être nous envahir et pourquoi pas chasser nos mauvaises pensées, les émotions qui débordent.
La sophrologie
Grâce à la sophrologie et aux différents exercices de respiration et de relaxation qu’elle exige, je peux vous en parler puisque c’est mon métier. La sophrologie permet de conduire progressivement un patient vers une meilleure gestion de ses émotions afin de gagner en sérénité. Une séance réussie, c’est : une respiration maîtrisée, un relâchement musculaire et une vision plus positive du quotidien. À renouveler aussi souvent que l’on en ressent le besoin.
Le yoga
Adopté par de plus en plus de Français et dans le monde en général, on ne parle même plus des multiples effets positifs que cette technique a sur notre corps et notre mental. En effet, mêlant, méthodes de respiration, relaxation profonde, méditation et postures, elle permet un réel bien-être au quotidien.
Le sport
Pratiquer de l’exercice physique permet d’évacuer le stress, la pression et toutes les mauvaises pensées qui nous envahissent. Préférez la marche, même rapide, car celle-ci ne vous excitera pas et vous permettra de rester connecté à vous-même.
Cette liste n’étant pas exhaustive, tout ce qui pourra apaiser vos troubles et vous aider à aller bien, est bienvenu et pourra bien évidemment être combiné aux autres techniques pour un effet encore plus efficace.
Conclusion
Afin de conclure sur une note positive, oui, nous sommes tous à un moment ou à un autre de notre vie, envahis par nos émotions, les bonnes et les moins bonnes, et souvent les deux en même temps, et il n’y a rien d’anormal à cela !
Cela dit, lorsque c’est le raz-de-marée, et que nous ne savons plus comment les gérer, notre quotidien peut vite se transformer en cauchemar et nous faire carrément exploser ! Mais tout problème à sa solution, essayez de trouver la méthode qui vous convient le mieux. Nous n’avons qu’une seule vie et qu’un seul corps pour la vivre. Alors prenons-en soin !
Charlotte Vallet – Sophrologue et Hypnothérapeute à Paris
-

Comment accepter son passé et en faire une force ?
Je suis Charlotte Vallet, coach spécialisée en émancipation féminine à Paris, et aujourd’hui, je souhaite parler du passé et de son pouvoir de transformation.
Mon parcours de vie n’a pas toujours été facile. J’ai vécu des épreuves difficiles, telles que l’enfance en foyer, l’abandon et l’humiliation. Mais aujourd’hui, à 34 ans, je ressens une paix intérieure profonde et une guérison émotionnelle que la petite fille en moi n’aurait jamais imaginée. C’est une transformation incroyable !
En tant que coach pour femmes à Paris, j’accompagne les femmes à surmonter leurs blessures passées, à se libérer du poids du passé et à retrouver leur confiance en soi. Si tu cherches à guérir des blessures émotionnelles, à retrouver ton équilibre et à t’émanciper de tes peurs, je suis là pour t’aider à transformer ta vie.
« Laissons au passé ce qui appartient au passé », plus facile à dire qu’à faire ! Si nous cherchons tous à « passer à autre chose », « enfouir » ou encore carrément « oublier », il n’est pas rare que le passé resurgisse de temps en temps dans notre quotidien, voire même un peu trop souvent pour certains ! Et ce retour en arrière est rarement positif. Une séparation, un conflit avec un proche, une maladie, un traumatisme grave, trop de souvenirs peuvent nous envahir au quotidien et sont sources d’angoisses, de peurs et de stress. Ne pas accepter notre passé nous empêche d’être heureux et d’avancer. Pour pouvoir vivre l’instant présent sereinement, il faut accepter son passé, apprendre à pardonner, déculpabiliser, et lâcher prise. Plus facile à dire qu’à faire, me direz-vous ? Oui ! C’est vrai. Mais un moyen d’y parvenir est de le transformer en autre chose ! En quelque chose qui nous fait grandir. Et si l’on pouvait en faire une force ?
Et si je pouvais devenir une « super moi » grâce à mon histoire personnelle aussi chaotique et douloureuse qu’elle soit ?
Un passé douloureux : le poids des regrets et l’envie d’oublier
Maladie, échecs, ruptures, expériences traumatisantes qui se transforment en cauchemars… Nous ne réagissons pas tous de la même manière face à des souvenirs douloureux.
Il y a ceux qui vont vivre dans le regret permanent et ceux qui mettent tout au placard et qui balancent la clé !
Les premiers, éternels nostalgiques, se passent en boucle le même refrain : « si j’avais su », ou « j’aurais dû » avec cet espoir de pouvoir peut-être changer quelque chose du passé voire de le reconstruire totalement.
Les seconds, eux, enfouissent pour mieux oublier. « Faire l’autruche », comme si rien n’avait existé. Mais cette stratégie, ou plutôt ce comportement, n’aboutit qu’à l’inverse de l’effet escompté. Plus on concentre son attention sur un souvenir dans le but de l’oublier, plus il va revenir en force, malgré nous. Eh oui ! En voulant effacer un souvenir, en réalité, nous le renforçons ! Il faut donc changer notre état d’esprit pour vivre une nouvelle vie. Mettre un terme aux regrets et à la culpabilité. Le passé n’est pas que cette part d’ombre dans notre vie qu’on lui attribue souvent ! Il peut aussi être une force, un moteur pour avancer, pour réussir à bâtir notre avenir.

Et si nous pouvions faire de notre passé une force ?
Si le passé ne rimait pas forcément avec négativité ? En général, 6 personnes sur 10 se raccrochent aux aspects négatifs de leur passé et cela finit indéniablement par faire partie de leur personnalité. Mais cela veut aussi dire que 6 personnes sur 10 subissent un quotidien lourd des maux du passé qu’ils portent. Constat assez triste non ?
N’avons-nous pas une mauvaise perception de notre passé ? Pouvons-nous le voir autrement ? Est-il possible qu’il puisse nous donner la force d’avancer encore plus loin ? Peut-il être un booster plutôt qu’un boulet ? Eh bien moi, je serais tentée de répondre : pourquoi pas ?
Nous avons tous un passé, plus ou moins chahuté, plus ou moins douloureux, et nous devons tous avancer. Alors prenons le temps d’apprendre à vivre avec lui et surtout grâce à lui. Faisons de ce passé un allié pour affronter le présent et le futur et non pas un ennemi ! Acceptons ses mauvais côtés, ses cabosses, ses blessures et tentons de le voir différemment.
Et si nous pouvions l’aimer après tout ? Il n’a certainement pas que des défauts ! Il est aussi fait de merveilleux moments comme les moments entre amis, notre évolution personnelle et professionnelle, de bons souvenirs en famille, et tous les petits bonheurs qui rythment notre quotidien.
Alors pourquoi ce ne sont pas ces souvenirs qui nous accompagnent aujourd’hui ? Pourquoi devons-nous nous infliger cette lutte permanente contre nos démons du passé ? Existe-t-il une ou des solutions pour s’apaiser et faire la paix avec notre passé ? Pouvons-nous juste vivre l’instant présent ? Lâcher prise ? Et si oui, comment faire ?
Voir le passé autrement, des solutions pour y parvenir…
Il n’y a aucun remède miracle pour guérir de nos blessures du passé. Mais il est possible de les laisser se refermer, ne plus souffrir et avancer. Certes, quelques cicatrices resteront, mais ce sont elles, d’une certaine manière, qui font ce que nous sommes et ce que nous deviendrons. Vivre l’instant présent n’est pas chose aisée, mais on peut y arriver ! Pierre Geluck, lui, avait sa propre méthode et a dit un jour : « Je bois pour oublier. Mais j’ai tellement bu que je ne me rappelle plus ce que je dois oublier ». Évidemment, inutile de préciser que cette méthode n’est pas celle qu’il faut choisir ! Si plusieurs techniques, méthodes, astuces existent pour se détacher des mauvaises ondes de son passé, savoir tourner la page dépend tout de même de notre force de caractère, de l’intensité des évènements vécus et de la capacité à gérer nos émotions. Nous ne sommes pas tous égaux face à notre passé. Le but étant pour chacun de voir son passé autrement pour mieux vivre le présent.
Dans un processus de deuil d’un passé douloureux, il y a trois étapes fondamentales :
Tout d’abord, il faut le comprendre, puis gérer les émotions qu’il nous renvoie et se tourner vers l’avenir.
Comprendre son passé
Le charme du passé, ne serait-il pas justement qu’il soit le passé ? Ne serait-il pas finalement surtout une idée, une image qui n’existe que dans nos mémoires ? A priori, il ne serait plus vraiment réel, plutôt abstrait même. Mais alors comment une chose irréelle peut-elle tenir les ficelles de notre réalité actuelle, en la déformant et en nous faisant souffrir ? Réponse : nos émotions. Eh oui, ce que l’on croit revivre quand on se tourne vers le passé, ce n’est pas l’évènement mais les émotions qui lui sont rattachées, celles que l’on a ressenties auparavant. Et c’est en grande partie à cause d’elles que nous souffrons du poids du passé.
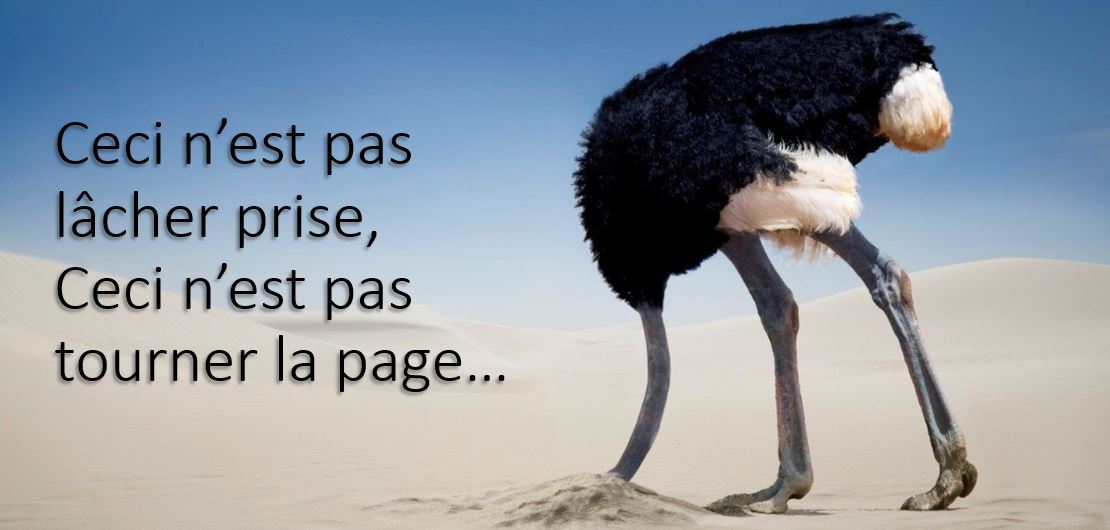
Mais alors comment gérer ce trop-plein d’émotions ?
Autant vous dire tout de suite, il existe autant de solutions, astuces, méthodes que de personnes qui en cherchent ! Ce qui veut dire que chacun doit trouver sa/ses techniques pour ne plus souffrir. Et croyez-moi, plus on les combine, mieux c’est !
Voici quelques exemples :
- L’écriture
- La thérapie (seul(e), en couple, en famille…)
- Le sport
- Le yoga
- La méditation de pleine conscience
- Le coaching
- L’hypnose
- Le breathwork
- Les soins énergétiques
- Le magnétisme
- Le chamanisme
J’ai rédigé un eBook exceptionnel présentant mes 100 thérapeutes d’exception à Paris (énergéticiens, magnétiseurs, spécialistes EMDR, masseurs, etc.), prêts à vous aider à vous émanciper du passé, à surmonter des blocages émotionnels et à retrouver l’équilibre intérieur. Cet ebook est en ce moment en promotion au tarif de 21 euros ) la place de 29 euros.
Cette liste étant, bien évidemment, non exhaustive, à vous de trouver ce qui vous conviendra le mieux, ce qui vous aidera à avancer. Gardez en tête qu’il faut vous libérez de toutes les mauvaises émotions du passé qui vous envahissent en essayant, pourquoi pas, de les remplacer par des positives, celles qui vont vous booster, vous faire avancer.
N’hésitez pas me contacter… !
Tourné(e)s vers le futur !
Et maintenant que l’on a, plus ou moins, géré ce fameux passé, en route vers le futur… On décolle nos yeux du rétroviseur et on appuie sur la pédale ! Je sais, encore une étape difficile. En effet, si nous tentons souvent d’enfouir les souvenirs du passé, nous angoissons aussi de ce qui va nous arriver dans le futur…
Et si, être « coincé(e)s dans le présent était la meilleure chose qui nous arrivait ? Vivre l’instant présent, en pleine conscience… !

Faire de notre passé une force c’est possible, la preuve…
Si les mots ne suffisent pas toujours à convaincre, les exemples concrets oui ! Et il en existe beaucoup autour de nous.
Prenons celui d’un chanteur bien connu, Andréa Bocelli. En 1970, il devient aveugle suite à la réception dans l’œil d’un ballon de football. C’est à ce moment-là que sa passion pour le chant a pris ton son sens. Il y a en effet puisé toute sa force et a réussi à devenir le ténor lyrique que nous connaissons tous aujourd’hui en faisant de cette tragédie le booster de sa vie.
Prenons, à présent, un tout autre exemple. Celui de Flavie Flamant, violée par David Hamilton dans son enfance. Si certaines femmes ne réussiront jamais à s’en remettre, elle a décidé d’en faire une force, une rage qu’elle a mise au service de l’écriture dans son livre « la consolation ». Réel exutoire pour elle, et prise de conscience pour d’autres femmes, sa parole libérée sur ce sujet est le symbole de cette lutte contre le passé qui hante, le passé qui détruit et celui d’une lutte pour être heureuse malgré les blessures encore douloureuses.
Dernier exemple et non des moindres, Théo Curin, 18 ans, quadri-amputé à l’âge de 6 ans après une méningite foudroyante. Aujourd’hui vice-champion du monde de natation paralympique et égérie d’une grande marque de cosmétique pour Homme, est le parfait exemple de cette force que les épreuves du passé peuvent nous donner.
Si eux y arrivent, nous le pouvons aussi !
J’ai rédigé un eBook exceptionnel présentant mes 100 thérapeutes d’exception à Paris (énergéticiens, magnétiseurs, spécialistes EMDR, masseurs, etc.), prêts à vous aider à vous émanciper du passé, à surmonter des blocages émotionnels et à retrouver l’équilibre intérieur. Cet ebook est en ce moment en promotion au tarif de 21 euros ) la place de 29 euros. PROFITEZ-EN !
Conclusion
Nous ne pouvons ni effacer ni changer le passé, c’est un fait, mais rien ni personne ne nous oblige à le traîner comme un boulet toute notre vie ! Alors, il est peut-être temps de dire stop à cette souffrance et de profiter de tout ce que peut nous offrir l’instant présent. Bien que cela puisse être compliqué pour certains, le lâcher-prise est une étape essentielle dans notre quête du bonheur. Et si la tâche vous paraît colossale, n’hésitez pas à faire appel à une tierce personne pour vous aider ! Nous méritons tous de trouver cette paix intérieure, ce bien-être qui nous permet de réaliser nos projets et de profiter de toutes les merveilleuses choses que nous offre la vie !
Charlotte Vallet – Coach, spécialisée en émancipation féminine sur Paris – Si tu veux aller plus loin, je te propose un appel téléphonique pour connaitre tes besoins.
-

Le sexe gouverne-t-il le monde ?
Dominique Strauss Kahn, Harvey Weinstein, Silvio Berlusconi, Bill Cosby, Karim Benzema, Le Père Preynat … Qui n’a pas suivi ces affaires ou au moins entendu ces noms dans les médias ? Leur point commun : le scandale sexuel. Depuis plusieurs années les révélations de frasques sexuelles ne cessent d’être divulguées dans la presse et à la télévision et sont presque devenues « habituelles » … malheureusement ! Politiques, réalisateurs, acteurs, sportifs, prêtres… Tous les domaines sont touchés par les dérives sexuelles. Du Show-Biz à l’Église, de la simple tromperie au viol en passant par la pédophilie, ne serions-nous pas totalement égarés sur le chemin du plaisir sexuel ? Pourquoi cet acte, à la base si naturel et jouissif, est-il devenu, pour certains, une arme de destruction massive ? Pourquoi a-t-on transformé ce moment de partage et d’intimité en coucherie animale et barbare ? Quelle image positive pouvons-nous garder du sexe à l’heure de tous ces scandales qui éclatent et défilent sur tous nos écrans ? Est-il encore possible de le voir comme un acte de partage et d’amour entre deux partenaires consentants ? Le romantisme a-t-il encore sa place dans un monde où les films pornographiques se regardent comme une série TV ? Et qu’en est-il du sexe dans le milieu professionnel ? Le fameux « balance ton porc » anciennement appelé « promotion canapé » montre que nous ne sommes pas dans la fiction, mais dans une réalité bien réelle… si je peux dire cela comme ça… !
Le sexe, un acte de reproduction, d’amour qui peut devenir une arme…
L’acte sexuel est depuis la nuit des temps, chez les hommes comme chez les animaux, un acte naturel de reproduction. Mais chez les hommes, plus qu’un simple besoin primaire, il représente aussi un moment de partage, de plaisir avec l’être aimé. Cette attirance physique qui existe entre deux personnes fait naître en elles un désir profond, charnel qui se traduit par l’acte sexuel mais aussi toute la tendresse qui l’entoure. Extraordinaire pulsion de vie qui nous traverse, la relation sexuelle relie le bien-être du corps et les attentes de l’esprit, nos appétences naturelles au plaisir et nos besoin culturels d’harmonie et de respect. Elle est un essentiel de la vie. Le couple amoureux étant le premier sujet de préoccupation des Français.

Mais cette vision romantique voire idyllique de l’acte sexuel est-elle vraiment celle qui prime aujourd’hui ? N’est-elle pas entachée par tous ces scandales sexuels qui polluent nos écrans et la presse ? N’est-il pas devenu un « outil » pour arriver à ses fins voire même une arme ? La réalité n’est-elle pas beaucoup plus sombre qu’on veut le croire ?
Balance ton porc… : la « promotion canapé » enfin dénoncée…
Malheureusement, coucher pour réussir professionnellement n’est pas une fiction. Cette pratique est bien plus répandue qu’on peut le penser. Si pour la plupart d’entre nous un entretien voué à nous confier de nouvelles responsabilités ou une promotion sont un échange avec notre supérieur, pour d’autres celui-ci peut prendre une toute autre tournure … Si l’évolution dans une entreprise est théoriquement liée à nos compétences et notre expérience, en pratique, ce n’est pas toujours le cas. En effet, certains patrons ne se basent pas, tout à fait, sur les mêmes critères, si vous voyez ce que je veux dire ! Faut-il alors payer de son corps pour réussir ? Pour certains oui !
Selon le sexothérapeute Alain Héril « Compétition, consommation et performance, qui sont les fondements de notre économie, revêtent plusieurs formes dans notre société, et le sexe peut être une d’entre elles. Notamment dans les entreprises qui fonctionnent sur le principe tacite de “la fin justifie les moyens”. » Il ajoute que l’entreprise est un monde dans lequel chacun est l’objet de l’autre, régi par la notion de plus-value. Cette pratique serait alors banale, répandue et acceptée par tous ? Non, loin de là. Si certains y trouvent leur compte, d’autres au contraire en subissent les conséquences qui peuvent être dramatiques.

En effet, si elle peut être consentie parfois, elle est souvent contrainte. Cela peut se traduire par du chantage, la personne ne sera alors promue que si elle répond aux avances, ou pire par du harcèlement au quotidien. Pratique beaucoup trop utilisée aujourd’hui dans nos entreprises, certaines femmes osent parler pour la dénoncer. Mais qu’en est-il de celles qui se taisent et vivent ce calvaire tous les jours au travail ? Doit-on laisser le sexe prendre la place des conventions d’entreprises sans rien faire comme on respecterait les règles d’un jeu ?
Ne soyons pas non plus trop catégorique. Certaines femmes savent aussi parfaitement user de leurs atouts… si je puis dire… pour grimper les échelons !
Aussi, si l’acte sexuel est utilisé comme un outil de chantage en entreprise, il peut aussi devenir une réelle arme de destruction massive répandue grâce, ou plutôt « à cause », d’Internet et de ses nombreux sites de streaming et réseaux sociaux. Il est, en effet, très simple aujourd’hui d’avoir accès au « sexe ». Tellement simple, que même des mineurs peuvent, sans aucune difficulté, regarder des films pornographiques réservés normalement aux personnes majeures.
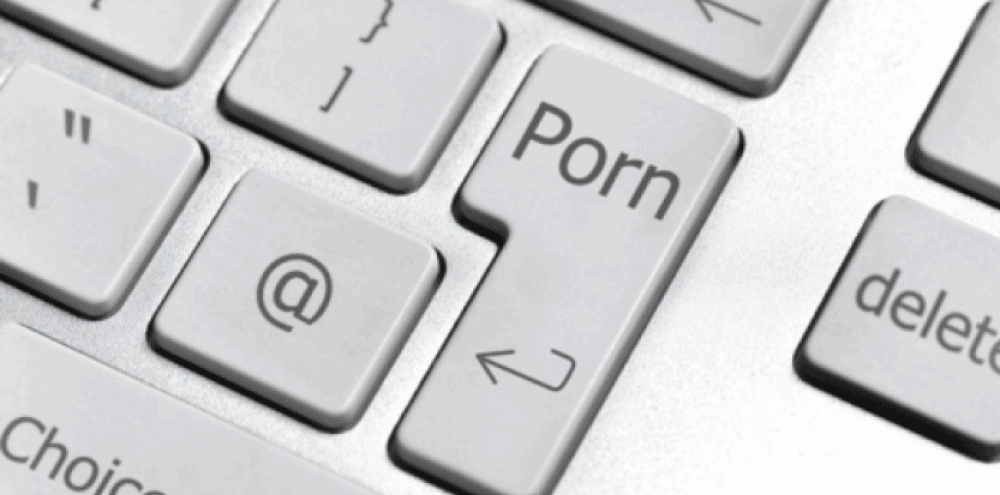
Le sexe sur Internet : un puits sans fond qui peut mener au drame
Streaming, sites de rencontres, réseaux sociaux, autant de terrains de chasse pour les addicts au sexe mais aussi pour les pédophiles et agresseurs sexuels. Disons-le d’emblée, l’industrie du sexe est l’une des industries les plus florissantes au niveau mondial !
Et c’est là que se trouve le réel danger d’Internet ! Ce dernier est devenu un dangereux facilitateur pour les personnes dépendantes et un « free space » pour les prédateurs. Véritable mine d’or, le Net regorge de vidéos pornographiques gratuites mais aussi de proies faciles confortablement installées derrière leur écran tchattant sur des sites de rencontres ou sur les réseaux sociaux. Comment être sûr(e) que je parle avec la bonne personne ? A-t-elle mis sa vraie photo ? Dois-je accepter le rdv ? Est-il possible que ce soit un traquenard ? Qui ne se pose pas ces questions aujourd’hui après les multiples histoires tragiques recensées dans les médias ? Comment peut-on échanger en toute confiance sur internet sans avoir cette peur du prédateur qui nous guette via son écran ? Comment les parents peuvent-ils laisser sereinement leurs ados naviguer sur internet alors que nous sommes matraqués par les publicités pornographiques et que nous avons un accès illimité aux vidéos ? Dans une société traumatisée par les scandales sexuels, de pédophilie ou de viol, peut-on encore avoir confiance en l’Homme ?

Lorsque l’on perd le contrôle…
La relation contrainte au sexe et à la pornographie est reconnue comme une addiction sans drogue parmi les plus destructrices pour les individus. Tabou, elle est souvent déniée par ceux qui en souffrent. Si nous traitons souvent ces personnes « d’obsédés sexuels », eux préfèrent se qualifier « d’addicts à l’amour », c’est quand même plus chic… n’est-ce pas ? Les médecins nomment cela le « donjuanisme » : un besoin irrépressible de séduire et de coucher avec le plus grand nombre de femmes possible, d’accumuler les conquêtes sans vraiment en ressentir du plaisir. Jugée comme la toxicomanie sans produit, l’addiction sexuelle est prise aujourd’hui très au sérieux en raison des dégâts qu’elle cause aux individus et des risques de dérapage qu’elle comporte. Mais alors que le sexe est un besoin primaire de l’espèce humaine au même titre que la nourriture, comment évaluer le « trop-de-sexe ? » Les addictologues précisent qu’il y a une pathologie de perte de contrôle lorsque la fréquence de l’acte sexuel est excessive et non contrôlée et qu’elle a des conséquences négatives pour la personne et son entourage. On comprend aisément qu’il est difficile d’évaluer le nombre de malades du sexe dans notre société actuelle. En effet, comment faire la part des choses entre les simples « papillons » qui profitent de leur célibat pour tchatter sur les sites de rencontres et regarder des films pornographiques de temps en temps et les réels malades « addicts au sexe » ? La frontière est tellement mince qu’une consommation effrénée de pornographie en ligne, ou cybersexe, pousse souvent les adeptes de ce « e-porno » vers l’addiction.
À noter également, que le rapport au sexe est également différent entre un homme et une femme ! J’espère vous en parler dans un prochain article…
Victimes ou agresseurs, des aides existent
Que l’on soit victime du sexe ou addicts, de nombreuses aides existent pour vous aider à vous en sortir. D’un côté comme de l’autre, il ne faut pas se murer dans le silence mais appeler au secours pour retrouver le chemin d’une vie plus apaisée et plus saine.
Pour les victimes, il existe des aides nationales :
- Le CFCV (Collectif Féministe Contre le Viol)
- Viols Femmes Informations
- Associations régionales/locales
Pour les pour les personnes dites « addicts »,
- Les centres d’addictologie pour les dépendants sexuels
- Les hôpitaux
- Les associations régionales/locales

Conclusion
Si le sexe ne gouverne pas le monde mais bien les hommes, ces mêmes hommes utilisent parfois leur sexe pour dicter leurs lois ! Arme puissante et parfois dévastatrice, le sexe est devenu aujourd’hui un outil comme un autre pour arriver à ses fins. Simple plaisir à assouvir, il est devenu pour certains une réelle addiction à soigner. Le prédateur, difficile à trouver dans cette jungle qu’est notre société, voit son terrain de jeu s’étendre à l’infini avec Internet et l’accès illimité aux vidéos pornographiques, sites de rencontres et réseaux sociaux en tous genres. Et c’est bien là le problème ! Trop banalisé, nous sommes tous devenus de probables victimes aussi bien au travail, dans la rue ou, plus incroyable encore, bien installés au chaud dans notre canapé derrière nos écrans… Alors, je ne sais pas s’il est trop tard ou pas, mais faisons en sorte, qu’à titre personnel, le sexe reste avant tout un réel moment de complicité et de plaisir ! Et si vous êtes une victime, n’hésitez pas à me contacter…
Charlotte Vallet – Sophrologue et hypnothérapeute à Paris

-

Mieux vaut-il être seul(e) que mal accompagné(e) ?
« Mieux vaut être seul que mal accompagné » disait Pierre Gringoire au XVe siècle… Qui ne connaît pas ce proverbe ? Nous l’avons tous prononcé au moins une fois dans notre vie à une amie pour la réconforter après une rupture non ? Mais le pensons-nous vraiment ? Car en y réfléchissant c’est tout de même plus facile à dire qu’à faire. Si cet adage paraît d’une logique implacable à la première lecture, dans les faits, tout est plus compliqué. En effet, une question me vient à l’esprit : comment est-il possible de savoir si nous sommes bien ou mal accompagnés ? Car, si j’utilise une autre expression pour expliquer mon interrogation, je pourrais dire que nous savons tous que « L’amour rend aveugle », non ? Et s’il n’y a plus d’amour, l’ego, le confort ou la peur de la solitude peuvent nous entraîner dans une forme de déni, et nous faire croire que nous sommes bien accompagné. Alors si en effet, pour les autres, c’est facile de leur dire qu’il vaut mieux être seul que mal accompagné, pour ce qui nous concerne n’avons-nous pas tendance à faire l’autruche quand ça nous arrange ? D’autant que certains affirment haut et fort que la solitude peut être néfaste. Alors que faire ?
La solitude, pourquoi peut-elle être néfaste ?
Que nous ayons ou non le tempérament d’un solitaire ne change rien à l’affaire : être seul trop longtemps n’est pas bon ni pour le moral ni pour notre santé. En effet, comme nous l’explique le neurobiologiste Philippe Vernier, à la tête de l’Institut des neurosciences de Paris-Saclay, « l’espèce humaine est éminemment sociale et bon nombre de nos fonctions cognitives sont dévolues aux interactions avec ceux que nous rencontrons, nos proches, nos amis, nos collègues … ». Analyser ce que dit l’autre, l’écouter, imaginer ses intentions, tout un travail cognitif qui serait bon pour notre santé mentale.
La solitude, en revanche, tend à nous focaliser sur le côté négatif de l’autre et plus on reste seul longtemps plus cette tendance va s’installer, au point même, peut-être, de ne plus pouvoir se socialiser du tout. Mais ce n’est pas la seule conséquence. En effet, la solitude, à long terme, entraîne un repli sur soi, une perte de confiance et un regard négatif sur soi-même. Elle augmente aussi les hormones du stress, la tension artérielle, diminue les défenses immunitaires, crée des troubles du sommeil, ou pire, nous mène vers la dépression. Car avouons-le, notre société porte un regard très méfiant sur les solitaires, ce qui leur renvoie une image dégradée d’eux-mêmes. Sans compter tous les messages qui nous sont transmis dans le but de nous dire que vivre entouré est bénéfique pour notre équilibre psychique et pour notre bien-être.

À deux, c’est donc toujours mieux ?
L’amour, le partage, la complicité, la tendresse … Qui ne rêve pas de cette idylle parfaite avec son/sa conjoint(e) ? S’endormir à deux, aller au restaurant, voyager, se remémorer des souvenirs en regardant les albums photos… Autant de petites choses du quotidien qu’il est beau et plaisant de partager avec sa moitié.
Et c’est cet amour simple, sage, entier qui nous enrichit et qui rend notre vie plus censée, complète et édifiante. Mais toutes les histoires ne se passent pas toujours comme un conte de fées. Le romantisme, la passion, le soutien… Force est de constater que ça ne dure pas toute une vie… Certains ont en effet la chance de s’unir dans l’amour et de partager cette magnifique aventure jusqu’à la fin. Mais, reconnaissons que c’est de moins en moins vrai. Alors que faire lorsque tout n’est pas (ou plus) si « rose » ? Que faire lorsque notre histoire bat de l’aile ? Que faire lorsque l’on est accompagné d’une personne toxique ?
Lorsque nous avons l’impression d’avoir tout donné pour sauver notre couple ou lorsque l’on ouvre les yeux sur la personne qui nous accompagne et qu’elle ne nous correspond pas (ou plus), n’est-ce pas le moment de dire STOP ? Bien que difficile et douloureuse parfois, une rupture n’est-elle pas plus bénéfique qu’une mauvaise relation, triste, illogique voire parfois destructrice.
Pourquoi restons-nous parfois dans des relations qui nous nuisent ?
Je pense que nous serons tous d’accord pour affirmer que toutes les relations de couple ne sont pas bonnes à vivre. Qu’elles soient justes banales, tristes, sans réel attachement ou au contraire illogiques, nocives voire perverses et destructrices, certaines relations ne valent pas le coup d’être vécues ou pire doivent être fuies à tout prix ! Mais alors pourquoi restons-nous parfois des années avec cette même personne qui ne nous correspond apparemment pas ? Parce que l’amour rend aveugle, me répondrez-vous. Oui, mais pas seulement ! Il y a plusieurs raisons qui retiennent une personne à se conforter dans une relation médiocre : le besoin être reconnu, le sentiment de sécurité, la peur de la solitude … Si la vie en couple peut être compliquée, certains, par confort, la préféreront au célibat pour de multiples raisons.

Le besoin de reconnaissance
Ne me dites pas que vous ne ressentez pas un immense plaisir à savoir que vous êtes le centre du monde pour autre personne ? On est d’accord… Parce que nous vivons en communauté depuis notre naissance, parce que l’autre fait partie de notre vie, nous avons tous un besoin de reconnaissance. Et c’est à travers les yeux de l’autre que nous pouvons combler ce besoin. Mais aussi grâce à ses gestes, ses mots, ses actions du quotidien. Aimer et recevoir cet amour en retour renforce l’estime que nous avons de nous-même. Nous avons besoin de reconnaissance pour nous sentir appréciés, utiles, dignes d’intérêt, dignes d’exister tout simplement ! Mais attention à la dépendance…
Le sentiment de sécurité
Vivre à deux, partager les tâches quotidiennes, les dépenses, les projets mais aussi les peines et les difficultés peuvent procurer un sentiment de sécurité pour beaucoup d’entre nous. En effet, nous ne sommes pas seuls pour affronter notre quotidien et tous ses tracas et imprévus, ouf ! Lorsque nous avons une maison à rembourser, les factures à payer, une famille à nourrir, être à deux peut s’avérer très sécurisant. Deux salaires valent mieux qu’un non… Si la peur du manque d’argent est l’une des raisons principales pour laquelle certains couples restent ensemble, elle n’est pas la seule. Le conjoint se révèle être une béquille nécessaire lorsqu’on se sent faible psychologiquement et physiquement. Il nous aide à traverser les baisses de moral, les problèmes au travail, la maladie… C’est un soutien qui peut être indispensable. Et c’est pour toutes ces raisons que la vie à deux nous sécurise et que nous avons tant de mal à la quitter.
La peur de la solitude
C’est pour ce besoin de reconnaissance et de sécurité au quotidien que nous avons peur de la solitude. Cette peur peut être si intense que beaucoup font le choix de rester en couple même si la relation amoureuse n’est pas, ou plus bénéfique. Devoir déménager, n’avoir plus personne à attendre le soir pour partager les moments de la journée, devoir assumer les dépenses du quotidien seul, ne plus partager de moments intimes et tendres… Quelle horreur ! Certaines personnes sont tellement terrifiées face à cette montagne qu’elles ne préfèrent même pas essayer de la grimper. Elles préfèrent, consciemment ou inconsciemment rester en couple plutôt que se retrouver seules. Car disons-le, il faut du courage pour quitter l’autre et se retrouver seul et oser envisager de TOUT recommencer.
Mais si l’amour ou l’ego rendent si « aveugle », est-il possible que nous ne puissions pas nous rendre compte qu’une relation soit nocive pour nous ? Et si le choix de rester en couple était seulement dû au fait que nous ne voyons pas la situation telle qu’elle est réellement ? Et lorsque nous ouvrons enfin les yeux sur cette réalité décevante n’est-il parfois pas trop tard ?

Courage, fuyons ! La solitude aussi du bon
Ok, le célibat, ce n’est pas toujours drôle ! Mais n’a-t-il pas aussi ses avantages ? Lorsqu’une relation amoureuse devient chaotique et destructrice, croyez-moi, il vaut mieux prendre ses cliques et ses claques et partir. Pour les sceptiques, lisez bien ce qui suit car les raisons de préférer un peu de solitude quotidienne sont nombreuses :
- Se retrouver seul permet de faire le bilan sur notre relation passée et de lister ce que l’on ne veut plus à l’avenir. On se recentre sur soi, et sur ce que l’on veut vraiment
- Se laisser du temps pour profiter de la vie, se faire du bien quand on veut et avec qui on veut
- Sortir avec ses amis plus souvent, rencontrer de nouvelles personnes et pourquoi pas un nouveau chéri !
- Vivre de nouvelles expériences. Et oui, le célibat peut être le moment de tester de nouvelles choses ou de faire toutes les choses que l’on n’a pas pu faire.
- Sortir du cercle vicieux de « l’habitude de vivre en couple » qui nous retient à l’autre et qui ne procure plus aucun plaisir
- Ne plus vivre dans le mensonge. Être honnête avec l’autre et avec soi et oser affronter la situation : notre relation ne vaut plus d’être vécue
- Se quitter avant de se déchirer ou de tomber en dépression
- Retrouver de la liberté, sa liberté
- Retrouver de la confiance en soi en réalisant des tâches que l’on n’imaginait même pas pouvoir faire
- Retrouver de l’estime de soi souvent dégradée lorsqu’une relation bat de l’aile
- …

Conclusion
Si d’après la médecine et la sociologie, la solitude est néfaste pour notre santé à long terme, ce qui est sûrement vrai, une relation amoureuse qui déchante peut l’être tout autant. Si l’amour nous donne des ailes, il peut aussi nous rendre dépendant au point, parfois, de nous faire sombrer vers la dépression.
Alors seuls ou mal accompagnés ? Eh bien, il semblerait que la réponse ne soit pas SI évidente que cela… Nous sommes tous uniques et donc tous différents. Nous n’avons pas les mêmes envies, les mêmes objectifs, la même façon de voir la vie et de vivre nos histoires d’amour. Si pour certains il est facile de tout stopper et de vivre seuls, pour d’autres, cette situation paraît inenvisageable tellement la peur et les angoisses les envahissent. Et finalement, il y a ceux qui ne se rendent pas compte que leur couple n’est plus ce qu’il était, aveuglés par l’amour ou par l’habitude.
Alors juste un mot pour conclure : faites le meilleur choix pour vous et votre bien-être ! Ouvrez les yeux sur la situation et écoutez ce que vous dit la petite voix qui est en vous.
Charlotte Vallet – Sophrologue et Hypnothérapeute à Paris

-

L’échec est-il nécessaire pour réussir ?
« L’échec est le fondement de la réussite » a dit un jour le sage chinois Lao-Tseu. Et si c’était vrai ? Et si nous devions échouer avant de connaître le succès ?
Pour pouvoir répondre à ces questions, je me suis quand même interrogée sur la définition du mot « échec ». Qu’est-ce que l’échec ? Ce que j’ai pu constater, en faisant mes recherches, c’est déjà qu’il existe une réelle différence dans la perception de l’échec en France et dans les pays Anglo-saxons. Si en France l’échec est une défaite voire une honte, dans les pays anglo-saxons, il est un élément à part entière du parcours vers la réussite voire nécessaire pour réussir. Si les Français ont plutôt tendance à cacher ces « ratages », les Américains, eux, en font les acteurs principaux de leur « story telling » !
Mais alors, faut-il avoir une considération négative de l’échec à la française ou au contraire, prendre cela comme un enrichissement ? Est-ce que nous devons lier les 2 termes ou les dissocier ? L’échec est-il fatal ? Faut-il avoir peur d’échouer ? L’échec invalide-t-il un projet ? Faut-il rater pour réussir ? Comment vit-on l’échec ?
L’échec : une même définition pour tout le monde ?
Charles Pépin, auteur des « Vertus de l’échec » définit l’échec comme « une erreur doublée d’un sentiment de défaite. Certaines erreurs peuvent être rectifiées sans nous affecter plus que ça. D’autres nous terrassent car nous y avons joué une part de nous-mêmes, liée à ce que Freud appelait l’idéal du moi : c’est notre valeur même qui est remise en question. Ce qui nous accable, c’est le fait de confondre notre personne avec notre ratage, plutôt que de l’observer comme un fait à analyser, comme l’occasion d’un apprentissage. »
En France, une (très) mauvaise perception de l’échec
Si nous avons si peur de l’échec en France, c’est que ce dernier est plutôt mal perçu, et ce, depuis notre plus tendre enfance. En effet, nous sommes, dès le plus jeune âge, valorisés lorsque nous respectons les règles et les consignes données par nos parents ou le système éducatif, ce qui laisse peu de place à l’erreur. Tout au long de notre parcours scolaire, les erreurs sont la base de notre notation, chaque faute faisant dégringoler notre note finale. Il est donc clair que le système éducatif français tend à comparer les personnes et leur travail selon le nombre d’erreurs qu’ils ont faites et non à ce qu’ils ont appris de ces erreurs. Et chacun retrouvera le même mode de fonctionnement plus tard dans le monde du travail et de l’entrepreunariat. En France, celui qui échoue est donc celui qui aurait mal fait son job ou qui n’aurait pas respecté les consignes et cet échec serait donc synonyme de défaite pour celui qui le vit. L’expérience est donc vécue comme une honte, et la confiance en cette personne tend à diminuer. Rare est la place pour une seconde chance !
Mais si l’échec en France rime avec défaite et est donc mal vécu pour la plupart d’entre nous, en est-il de même partout ? Eh bien non !

Une vision différente de l’échec dans les pays scandinaves et anglo-saxons
Dans ces pays, à l’inverse du modèle français, on prône la culture de l’échec. En effet, il est davantage valorisé et est totalement inhérent à l’aventure humaine. Il est signe d’audace, de persévérance et de volonté d’entreprendre. Il permet de prendre de meilleures décisions ou de les ajuster. Cette valorisation des échecs permet d’ôter une partie de « peur » qui y est souvent associée. Ce n’est donc pas un cercle vicieux mais bien un cercle vertueux qui s’instaure, la défaite n’étant plus source d’erreur et de fatalité mais une source d’enrichissement pour les projets futurs. De nombreux exemples de réussites américaines le démontrent. Rappelons rapidement le parcours de Steve Jobs qui illustre parfaitement cette vision. Après quelques années à la tête de cette grande entreprise Apple, qui est la sienne, il a été renvoyé. Loin de se décourager, il rachète Pixar et en fait l’un des piliers du cinéma d’animations. Puis il reviendra finalement chez Apple qui deviendra la première marque mondiale. Morale de cette histoire : il ne faut jamais baisser les bras suite à un échec mais plutôt en faire une force pour atteindre son objectif avec succès.
Selon Freud, quand on échoue, on comprend mieux comment on peut réussir. Ainsi, le succès est pavé d’échecs. L’idée que le succès soit possible sans jamais échouer est absurde. Il est impossible d’arriver directement au succès, la réussite passe par l’action et donc par l’échec. Ces deux termes seraient donc totalement liés, indissociables. L’un n’irait donc pas sans l’autre. Mais est-ce réellement le cas pour tout le monde ? Et si nous n’arrivions pas à nous relever suite à un échec ? Avons-nous tous la force, la motivation, et les outils nécessaires pour rebondir ? Ne peut-il pas être fatal parfois ?
Avons-nous tous la capacité à nous relever suite à un échec ?
Bien sûr ! Comme un enfant qui tombe lors de son apprentissage de la marche, nous pouvons apprendre à nous relever suite à un échec. Certains vont avoir besoin de plus de temps que d’autres, voire même besoin d’une aide extérieure …
Mais il ne faut pas prendre ce problème à la légère…
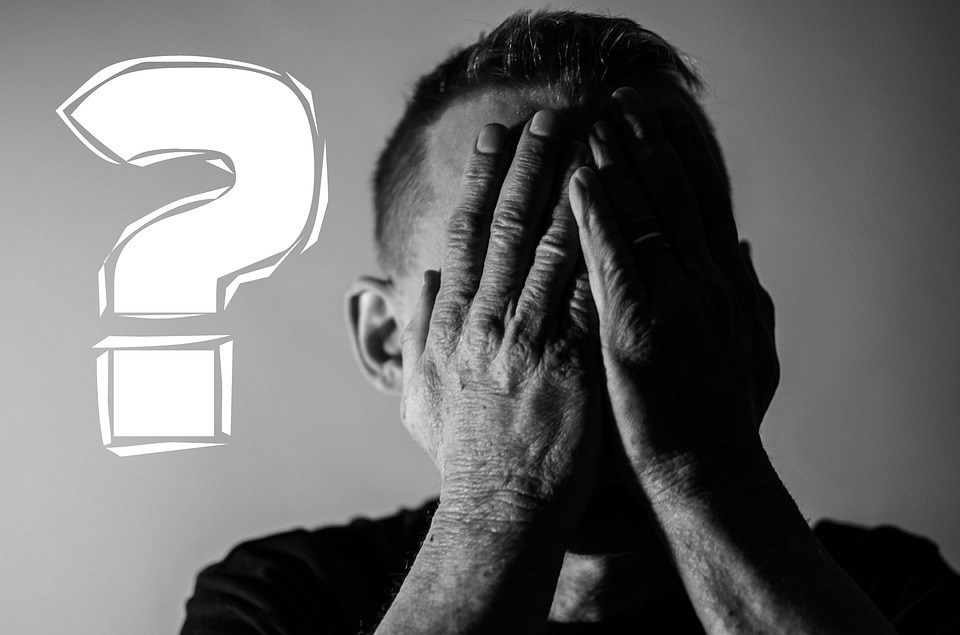
Sommes-nous réellement TOUS capables de surmonter les échecs ?
Comme toujours, tout n’est pas blanc ou noir ! Si la plupart des gens réussissent à se remettre de leurs échecs et à avancer, certains, en revanche, sont plus durement affectés. Un échec, perçu différemment par chacun d’entre nous, a donc des conséquences plus ou moins graves.
Quelles sont-elles ?
- Une incapacité à faire de nouveaux projets par peur d’échouer
- Une incapacité à retrouver confiance en soi au travail ou dans son couple
- Une maladie physique
- Une maladie psychologique ou psychiatrique
- Et, dans les cas les plus dramatiques, certaines personnes ne peuvent plus affronter la vie et se suicident.
Alors, il est primordial de savoir où l’on se situe, et de trouver la manière pour rebondir.

Quelques pistes…
Les principales étapes nécessaires pour repartir plus fort vers le succès:
- Accepter l’échec
- Prendre du recul
- Se questionner sur les raisons de l’échec
- Corriger
Ce n’est que lorsque vous trouverez les causes que vous pourrez rebondir et aller de l’avant sans réitérer les mêmes erreurs et réussir à atteindre votre but.
Voici une liste non exhaustive de questions auxquelles vous pourriez tenter de répondre, s’il s’agit d’un projet professionnel :
- Qu’est-ce qui a provoqué cet échec ?
- Suis-je entièrement responsable ?
- À quel moment ai-je perdu le contrôle ? Pourquoi ?
- Ai-je bien fait de m’engager dans ce projet ?
- Ai-je manqué d’outils pour réussir ?
- Ai-je manqué de motivation ? Pourquoi ?
S’il s’agit d’un échec personnel :
- Quelle est ma part de responsabilité ?
- Quelles erreurs ai-je faites et pourquoi ?
- Comment ne pas les reproduire ?
- Que dois-je changer ?
Quelle que soit la situation donc le problème, il faut en trouver la cause (la vraie). Seule la cause vous permet de trouver la solution. Pour celles et ceux que cela intéresse, je vous conseille fortement la méthode des 5 pourquoi.
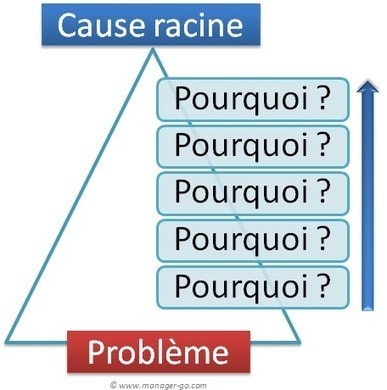
Et si cette introspection ne suffit pas à vous donner toutes les clés pour repartir plus fort vers le succès, vous pouvez très bien associer cet exercice à une aide extérieure. Vous pourriez, par exemple, suivre une thérapie pour livrer votre ressenti sur cette expérience douloureuse et reprendre confiance en vous. Mais aussi, pratiquer une activité comme le yoga, la sophrologie ou encore la méditation pour vous permettre de « lâcher-prise », de vous recentrer sur vous et de vous détendre.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à me contacter !
Conclusion
Il semblerait que la réponse à la question « l’échec est-il nécessaire pour réussir ? » soit bien plus complexe qu’un simple « oui » ou « non ». Notre vision de l’échec étant différente d’une personne à l’autre et aussi d’une population à une autre, il serait judicieux de dire que nous apprenons tous les jours de nos expériences. Elles nous enrichissent, nous renforcent, nous donnent des leçons qui vont nous permettre d’évoluer et d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés (personnels et professionnels). Selon notre degré d’acceptation de l’échec, ce dernier pourra nous booster pour avancer ou au contraire nous affaiblir. Mais il n’est pas fatal ! Accepter et rebondir s’apprend ! Et ce qui est important, n’est-ce pas le chemin parcouru pour arriver à destination ?
Je finirai par une phrase de Charles Pépin qui a dit : « Qui n’a jamais connu l’échec a raté sa vie ». Alors tombez, relevez-vous et tombez encore jusqu’à ce que votre objectif soit atteint. Faites de votre vie un perpétuel apprentissage, et de vos projets une joie au quotidien !
Charlotte Vallet – Sophrologue et hypnothérapeute à Paris

-

Comment vaincre la peur du rejet de l’autre ?
« J’ai peur qu’on ne m’aime pas », « Je n’y arriverai pas », « Il ne restera jamais avec moi », « Je suis nulle » Autant de phrases qui tournent en boucle dans la tête de ceux qui ont peur d’être rejetés et qui les paralysent chaque jour un peu plus, que ce soit dans leur vie professionnelle et personnelle.
Les raisons sont multiples et trouvent souvent leur origine dans des traumatismes durant l’enfance. Les conséquences : un manque d’estime de soi, de confiance, un besoin d’exister à travers l’autre, une hypersensibilité… Et dans notre société du paraître, où plaire aux autres est presque une obligation, ce phénomène a tendance à s’amplifier. Certains en arrivent même à perdre leur personnalité, leur identité. C’est alors un cercle vicieux ! Car on ne peut pas plaire à tout le monde. Et plus on veut plaire, plus on se confronte au rejet de l’autre.
D’où vient cette peur du rejet de l’autre ?
Pour la majorité d’entre nous, nous naissons entourés de nos parents. Puis, au fur et à mesure que nous grandissons, le cercle s’élargit : professeurs, amis, collègues, simples connaissances… Nous parcourons donc la vie avec ces « autres » qui forment notre propre société. Nous devons donc « vivre » avec l’autre, avancer avec lui, elle, eux… proches de nous ou parfait(e) inconnu(e)…`
Et si, pour certains, cette vie en communauté n’est pas un problème, voire plutôt une chance, pour d’autres, ce schéma est plus compliqué. Pourquoi ? À cause de certains ressentis qui les rongent : la peur ne pas être conforme à ce que l’autre attend, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être apprécié, la peur de la solitude, la peur d’être rejeté par les autres…
Cette peur trouve, le plus souvent, son origine au moment de l’enfance. En effet, un enfant abandonné ou délaissé par ses parents aura plus de chance de développer cette peur en grandissant. Les enfants humiliés, battus grandiront également avec un manque de confiance en eux, un sentiment d’infériorité qui pourront entraîner de nombreux troubles dans leurs rapports avec les autres. Mais sans même aller si loin, une autorité excessive conduit quasiment tout le temps un enfant à se construire dans la peur.
Le sentiment de rejet ou d’abandon peut donc naître très tôt et avoir de nombreuses répercussions plus tard sur nos relations avec les autres. Mais ce sentiment peut aussi se développer dans notre vie d’adulte, suite à un traumatisme ou à un évènement particulier (trahison, divorce, licenciement…).

Comment cette peur se manifeste-elle ?
Une personne qui vit avec cette peur du rejet au quotidien créée, malgré elle, des barrières à son bonheur qui peuvent être nombreuses et non sans conséquences… En voici une liste non exhaustive :
- Ne pas savoir prendre de décisions sans l’avis des autres
- Être hypersensible
- Éprouver un besoin permanent de plaire
- Développer de la jalousie
- Culpabiliser très souvent et très facilement
- Ne jamais exprimer sa propre opinion et/ou ajuster son opinion en fonction de celles des autres
- Vivre constamment dans l’angoisse et l’anxiété
- Procrastiner
- Développer des complexes qui nuisent dans tous les domaines de la vie
- Donner à outrance pour espérer recevoir
- Ne jamais demander de l’aide pour ne pas déranger quitte à tout faire soi-même ou à ne rien faire
- Chercher en permanence l’approbation des autres pour se sentir en sécurité
- Agir contre sa propre volonté
- Se laisser entraîner dans des situations à risques
- …
Résultats : une vie à vivre en porte-à-faux, un mal-être permanent et surtout obtenir l’inverse de ce qui est recherché. Car à force de vouloir plaire à tout le monde, on ne plaît plus à personne. Un véritable cercle vicieux… Alors comment s’en sortir ?

Mais, si l’on veut, on peut sortir de ce cercle vicieux
À chaque problème sa solution ! Si vous souffrez de cette peur qui vous pollue depuis des années et que vous souhaitez enfin vous en libérer, bonne nouvelle, il existe des solutions. Nul besoin d’aller les chercher bien loin, elles sont en nous. Eh oui ! Mais pour se sortir de cette situation de mal-être, il va falloir faire un peu de travail sur soi.
Les buts :
- Retrouver l’estime de soi
- Retrouver l’estime des autres
Afin de réussir à atteindre ces objectifs, plusieurs exercices peuvent vous aider. Exercices personnels ou en groupe, ils peuvent être combinés pour une meilleure efficacité.
Mais tout d’abord, penchons-nous sur l’histoire de Jia Jang, un jeune entrepreneur chinois. Intelligent, bosseur et obstiné, il n’a cessé de travailler dur pour réussir. Il s’est marié, a été engagé dans une grande entreprise aux États-Unis. Une réussite personnelle et professionnelle. Mais malgré tout cela, il était toujours déprimé. Pourquoi ? Il rêvait de monter son entreprise mais il était incapable de sortir de son confort de salarié et de prendre des risques. La peur de l’insécurité et surtout celle du rejet le paralysaient. C’est pourquoi, un jour, il décide de se confronter à ses peurs et se donne 100 jours pour les vaincre. Le meilleur moyen selon lui : se confronter chaque jour à des situations au cours desquelles il est susceptible d’essuyer des refus. Au bout des 100 jours, il s’aperçoit en fait, qu’il a eu plus d’accords que de refus ! Suite à cette expérience, il donne des directions pour prendre de l’assurance et oser :
- Accepter que le rejet fait partie de nous. C’est une réaction humaine face à l’inconnu
- Avant de battre en retraite face au NON, il faut demander à notre interlocuteur les raisons de ce refus. Analyser les motivations du refus et étudier ce qui peut être modifié
- Ne pas se priver de la liberté de demander par peur du « NON » et du jugement de l’autre. Si nous n’osons pas demander, nous ne risquons pas d’avoir de « NON », certes, mais nous ne risquons pas non plus le succès.
- Ne pas faire d’une mauvaise relation avec l’autre une généralité mais une expérience pour avancer.
- Prendre conscience que chaque personne est unique avec ses qualités, ses défauts et ses expériences.
- Prendre du recul sur le jugement, les critiques des autres à votre égard.

Et plus simplement :
- Il faut identifier l’origine de la peur et avoir conscience de la façon dont elle se manifeste. Pardonner, lorsque c’est possible, à ceux qui sont à l’origine de cette peur, en se disant qu’ils agissaient sûrement pour notre bien. Sinon, il faut décider d’affronter la réalité.
- Il faut se forcer à faire des choses nouvelles qui boostent notre confiance en nous.
- Il ne faut pas hésiter à demander de l’aide et à se confier.
- Il faut assumer sa sensibilité et apprendre à accepter la critique. Ou plutôt apprendre à la comprendre.
- Il faut se dire que tout le monde éprouve des peurs. Si ce n’est que certains arrivent mieux à les cacher d’autres (ou les expriment différemment).
- Il faut ne plus avoir peur que l’on vous dise NON, et soi-même oser dire NON. Essayez, vous verrez… vous serez surpris du résultat.
- Il faut aussi et surtout accepter d’être le maître de son destin. Ne pas se laisser dominer et comprendre que la différence est plutôt une force. Beaucoup sont dans le mimétisme d’un parent par exemple, de peur de le décevoir. Mais si vous ne décevez pas une personne… vous êtes perçu par TOUS les autres comme quelqu’un n’ayant aucune personnalité.
- Et surtout, il faut se rendre compte que lorsque l’on a pas d’estime de soi, on ne peut pas obtenir l’estime des autres.
Aussi pour réussir à s’en sortir, une première étape consiste à identifier la cause et à concrétiser les conséquences. Pour ce faire, des techniques telles que la sophrologie ou l’hypnose peuvent être des solutions particulièrement efficaces. Ensuite, en parallèle, le yoga ou la méditation peuvent venir apaiser les angoisses, l’anxiété, et à être en meilleure harmonie avec ce que nous sommes et ce que nous voulons au plus profond de nous-même.
Sophrologue et hypnothérapeute à Paris, n’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en discuter.
Conclusion
La peur du rejet de l’autre est un véritable handicap et un véritable cauchemar au quotidien. Soit on la subit… soit on essaye de la combattre. Une chose est sûre, la combattre permet de retrouver de la confiance, de l’estime de soi et surtout l’estime des autres. Et finalement, n’est-ce pas le but recherché ?

Charlotte Vallet
Hypnothérapeute et Sophrologue à PARIS
-

Le ventre, notre deuxième cerveau
« Avoir des papillons dans le ventre », « J’ai l’estomac noué », « On va voir ce qu’il a dans le ventre », ou encore « ça me prend les tripes », autant d’expressions qui traduisent un lien entre nos émotions et notre ventre. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le ventre est un véritable « deuxième cerveau ».
Cette hypothèse a été pour la première fois émise, en 1998, par Michael D. Gershon, professeur à l’université de Columbia à New York, auteur de « The second brain ». Il déclarait alors qu’« avec ses substances psychoactives endogènes, le ventre a le pouvoir de donner naissance à du découragement ou de l’enthousiasme, de l’impuissance ou du plaisir, de la dépression ou de l’accomplissement. »
Mais alors y aurait-il des neurones dans notre ventre ? De la matière grise ? Pouvons-nous réfléchir avec notre ventre ? Est-il le moteur de certaines de nos actions ?
Lorsque j’ai décidé de vous parler de ce sujet, une multitude de questions m’ont envahie. J’imagine (et j’espère) que vous aussi. Alors découvrons tout de suite ce qui se cache derrière cette étrange découverte…
De quoi est fait notre ventre ?
Situé au centre de notre corps, il est à lui seul « un véritable substrat anatomique » explique le Professeur Neunlist. En fait, les parois de nos intestins seraient tapissées de millions de neurones et chargées de neurotransmetteurs et fabriqueraient à elles seules 95 % de la sérotonine, la fameuse hormone du bonheur. Étonnant n’est-ce pas ? Et ce n’est pas tout. Elles renfermeraient également les deux tiers de notre système immunitaire ainsi que notre microbiote intestinal plus connu sous le nom de « flore intestinale ». En effet, notre tube digestif abrite près de cent mille milliards de bactéries, nécessaires à notre bonne santé et qui peuvent modifier nos comportements.
Qui l’eut cru ? Mais alors qu’est-ce que ça veut dire ? Notre ventre, nos émotions et les réactions psychiques et physiques de notre organisme sont-ils liés ? Eh bien, oui !

Notre ventre, l’origine de nombreuses maladies…
Notre stress, notre fatigue, nos angoisses et les autres maux de notre vie quotidienne se trouvent bien logés dans notre deuxième cerveau. Je m’explique.
Le nerf vague, se trouvant dans notre ventre, permet une communication permanente entre le cerveau et le système nerveux entérique (notre ventre) et notamment celle de nos émotions. Par exemple, le stress ressentit par notre système nerveux entérique agit directement sur notre muqueuse intestinale, agissant ainsi sur la quantité de sérotonine sécrétée, neurotransmetteur impliqué dans une multitude de troubles (anxiété, agressivité, stress, sommeil…). Notre microbiote intestinal influe alors sur notre cerveau. Tous deux sont donc très connectés. Mais alors comment ce lien se traduit-il ? Notre tube digestif est-il à l’origine de maladies psychiatriques, par exemple ? Eh bien là encore, je réponds oui. Cela paraît étonnant et pourtant… De nombreuses recherches et études scientifiques ont été menées ces dernières années et ont pu démontrer que ce fameux deuxième cerveau est en lien très étroit, pour ne pas dire le point de départ de maladies psychiatriques (type dépression) et neuropsychiatriques (type autisme) par exemple.
Un autre exemple, fort intéressant, est celui qui concerne la maladie de Parkinson. Des médecins du CHU de Nantes furent les premiers à affirmer que cette maladie peut être diagnostiquée par une biopsie intestinale.
Et si l’on mangeait « mieux » pour se protéger ?
Si notre ventre, lieu où transite notre alimentation, est aussi le lieu où naissent certaines maladies, n’est-il pas alors possible de les guérir grâce à ce l’on ingère ? Si nous mangeons mieux, que se passe-t-il ? Et que veut dire : manger mieux ?
Nous connaissons aujourd’hui la relation qui existe entre l’alimentation et les maladies cardiaques, l’obésité et le diabète. Ce que nous consommons pourrait également avoir des conséquences sur le cerveau. En effet, une alimentation mauvaise pour la santé pourrait augmenter le risque de maladies psychiatriques et neurologiques telles que dépression et démence, alors que des aliments bons pour la santé pourraient en protéger.
Le régime méditerranéen à l’honneur
Une étude publiée en 2009 dans Archives of General Psychiatry a montré que le risque d’avoir une dépression pouvait être diminué jusqu’à 30 % chez les personnes qui suivent un régime méditerranéen. Mais alors de quoi est constitué ce fameux régime ? Il est davantage riche en fruits, légumes, noix, céréales complètes, poisson et graisses non saturées (retrouvées dans l’huile d’olive et autres huiles végétales) que le nôtre et comporte moins de viande rouge et produits laitiers. Il a été prouvé que l’huile d’olive permet de diminuer l’apparition de troubles cognitifs ou de maladies comme l’Alzheimer, par exemple. Quel est donc son pouvoir magique ? Tout comme les poissons dits « gras » et l’avocat, elle serait porteuse de bonnes graisses nécessaires au bon fonctionnement de notre cerveau. Avez-vous déjà entendu parler d’Oméga 3 ? Oui, j’en suis sûre ! Eh bien voilà l’un des secrets d’une bonne santé. Ces acides gras protègent notre cerveau et sont les garants de notre bien-être. Alors n’attendons pas, mettons-nous au régime méditerranéen dès maintenant, « nos cerveaux » ne s’en porteront que mieux !
Les autres conseils
Mais si ce régime est l’un des remèdes, il ne peut être le seul. Pour être efficace, il doit être accompagné d’autres changements ou efforts de notre part : ne pas boire trop d’alcool, ne pas boire plus de 400 ml de boissons stimulantes comme le café, pratiquer une activité physique régulière, etc. Autant de choses à faire et à ne pas faire pour trouver un équilibre quotidien sain pour notre corps.
La méditation, l’hypnose, la sophrologie et le yoga
Et si ces pratiques transformaient notre cerveau et amélioraient notre santé ? Eh bien oui. Associées à une bonne alimentation, pratiquées quotidiennement, elles sont notre allié bien-être.
Pour Fabrice Midal, philosophe et fondateur de l’École occidentale de méditation, la méditation a un effet sur la pression artérielle, l’immunité, la fatigue mais aussi l’anxiété, l’insomnie et les addictions alimentaires. Elle permet de redevenir présent avec tout son corps. Nous ne sommes plus dans le « faire » mais dans « l’être ». C’est une respiration sans consigne, sans risque d’échouer. Nous « lâchons prise », et en ce sens, nous faisons du bien à notre organisme. Selon quelques chiffres, cette pratique réduirait de 50 % le risque de rechute en dépression. Aussi, 20 minutes de méditation par jour suffiraient à faire baisser l’anxiété de 40 %.
L’hypnose, quant à elle, serait efficace pour soulager les douleurs aiguës et chroniques et pour le traitement de la dépression et des addictions. C’est une véritable médecine corps-esprit qui traite chaque patient dans toutes ses composantes. C’est pourquoi, beaucoup de centres antidouleurs et hôpitaux y ont recours aujourd’hui.
La sophrologie, elle aussi, va au-delà de la simple recherche de détente corporelle. Plus qu’un banal exercice de relaxation par la respiration, elle propose des outils pour agir, pour se transformer. En jouant sur les organes et la circulation sanguine, elle permet de maintenir notre corps en bonne santé. Le travail se fait au niveau corporel, émotionnel et mental. Et pour faire le rapprochement avec notre système nerveux (cerveau et deuxième cerveau), elle entraîne le renforcement de nos connexions neuronales.
Et le yoga alors ? Le yoga est aussi un très bon exemple qu’une pratique régulière peut influer sur nos systèmes nerveux. Certaines postures ont des effets stimulants qui nous font du bien. Certaines ont un effet apaisant, d’autres procurent de l’énergie en produisant de la dopamine, et d’autres encore réduisent notre stress en diminuant le taux de cortisol. Cette technique rejoint donc les autres dans la recherche du bien-être et dans la lutte contre de nombreuses maladies ou troubles cognitifs.
Vous souhaitez plus d’informations ? Exerçant à la fois la sophrologie et l’hypnothérapie à Paris, je vous répondrai avec grand plaisir. Consultez ma page professionnelle pour me contacter.

Conclusion
La clé de la guérison d’une multitude de pathologies pourrait donc se trouver dans notre ventre ? Eh bien, aussi dingue que cela puisse paraître, énormément d’études démontrent que c’est bien le cas. Il est alors urgent de prendre soin de nos intestins et de notre tube digestif en général. Pour cela, une bonne alimentation et la pratique de quelques activités telles que la sophrologie, la méditation, le yoga, et bien d’autres encore sont nécessaires. Alors : Avez-vous bien « digéré » ces informations 🙂 ?
Charlotte Vallet
Hypnothérapeute et Sophrologue à Paris
-

Et si rire faisait du bien à notre corps…
Une bonne blague, un film drôle… Et on éclate de rire ! Tout le monde a déjà connu ces bons moments, enfin je l’espère… Néanmoins, quelques chiffres démontrent que nous ne rions pas assez. Si un enfant rit en moyenne 300 à 400 fois par jour, l’adulte lui ne rirait qu’une vingtaine de fois. Et les études à ce sujet tendent à montrer que nous rions de moins en moins : 19 minutes en 1939, 6 minutes en 1983 et moins d’une minute aujourd’hui. Et pire encore, environ 7 % des Français avouent ne jamais rire du tout ! Des rythmes de vie stressants et des conventions sociales pesantes induisent une pression généralisée (carrière professionnelle, compétitivité, rendement, etc.) laissant malheureusement peu de place à de franches rigolades entre amis !
Et pourtant, lorsque nous rions, nous n’en avons pas toujours conscience, mais nous ressentons une sensation de bien-être, de détente, de relâchement… Nous nous sentons bien tout simplement. Pas seulement parce que nous sommes entre amis ou en famille autour d’une bonne tablée, bien que cela y participe bien évidemment, mais surtout parce que le rire a de réels effets sur notre corps.
Et croyez-moi, ils sont nombreux et surtout très bénéfiques. Vous vous demandez sûrement pourquoi ? Eh bien, je me suis posé la même question que vous et je vais essayer de vous répondre.
Mais tout d’abord, qu’est-ce que le rire ?
Pascale Poinsot-Lesterle a dit : « Savoir rire est un art, un art du lâcher-prise qui permet instantanément de prendre de l’altitude face aux aléas de la vie ».
Si nous nous référons à la stricte définition, le rire est un comportement réflexe, donc incontrôlable, de notre corps qui exprime souvent la joie, le bonheur. J’ai choisi le mot « souvent » car parfois le rire peut être nerveux, contraire à l’expression de la joie. Nous avons tous en tête une personne qui se met à rire alors que la situation ne s’y prête pas du tout. Ou alors, un « Jean qui rit, Jean qui pleure ». Le rire exprimerait donc simplement des émotions !
Comme disait Goethe : « Le rire et les pleurs sont cousins ». En effet, qui n’a pas pleuré lors d’un évènement heureux important, ou à l’annonce d’une bonne surprise, ou tout simplement à la suite d’un fou rire ? Nous pouvons donc également pleurer de joie.
Le rire serait déclenché par l’humour, le chatouillement ou par l’effet boule de neige, en voyant quelqu’un rire en face de nous. Comme le bâillement, le rire est très communicatif.
Ce réflexe est donc une réaction physique d’une multitude de causes.

Quels sont ses bienfaits sur notre corps ?
Rire aurait de nombreux bienfaits sur notre corps. Vrai remède ou pratique tendance ? Je vous dis tout, ou presque ! Selon la gélotologie, ou science du rire, (à ne pas confondre avec gérontologie !) la liste de toutes ses vertus serait longue et non exhaustive. Voyons-en l’essentiel.
Le rire, une technique respiratoire proche du yoga !
Rire, forcé ou non, permettrait une réelle détente respiratoire et musculaire. Vous me répondrez sûrement que lorsque vous éclatez de rire c’est plutôt la sensation d’étouffement que nous ressentons ! Oui au début… Mais le corps s’adapte. En effet, les bronches vont s’ouvrir et la respiration s’allonger, ce qui va permettre 4 fois plus d’échanges respiratoires. L’inspiration est plus profonde, et l’expiration plus intense. Nous augmentons donc notre réserve d’air.
Nos éclats de rire pourraient alors nettoyer nos voies respiratoires mais aussi prévenir de certaines maladies respiratoires comme l’emphysème voire stopper des crises d’asthme.
Le rire, un super digestif !
Pour les adeptes du « digeo » ou de la « pisse mémé », voici une autre méthode pour les fins de repas difficiles : la grosse « marrade » ! Eh oui, rire permettrait de renforcer la digestion. Lorsque nous rions, nos muscles abdominaux se contractent et ce phénomène entraînerait le brassage de notre tube digestif en profondeur, lieu où s’élabore la nutrition de l’organisme. Ainsi l’estomac, le côlon, l’intestin grêle, ou encore le duodénum… sont massés, et notre digestion optimalisée. Ceci explique aussi pourquoi le rire lutte contre la constipation. Bonne nouvelle ! Stoppons nos prises de médicaments et marrons-nous !

Le rire : un puissant antidouleur
Selon une étude, 60 % des consultations médicales seraient liées à la douleur. Et si nous pouvions l’atténuer en rigolant ? C’est prouvé, le rire est tout aussi efficace d’un doliprane. Voici en effet, les 3 mécanismes de l’action du rire sur la douleur :
- Il agit comme un placébo en détournant notre attention. En effet, rire nous change les idées et agit sur notre perception de la douleur en l’atténuant.
- Il permet de détendre nos muscles. Le rire permet de réduire la contracture musculaire, et cette tension qui crée la douleur ou l’amplifie.
- Il augmente notre production d’endorphines, hormones jouant le rôle de morphine et de catécholamines (adrénaline et noradrénaline) qui ont un rôle important sur le processus inflammatoire.
Le rire, un anti-stress naturel
Économique, efficace et naturel, le rire est le « super » remède au stress. Il est la conséquence de plusieurs stimuli externes qui engendrent des réactions hormonales et nerveuses en cascade dans notre organisme. Si le stress peut parfois être positif et agir comme un booster, pour atteindre un objectif important, par exemple, il peut aussi être très néfaste. Perçu comme le « mal du siècle », le stress, nous le savons aujourd’hui, est à l’origine de beaucoup de pathologies physiques (cancers, infarctus, hypertension artérielle…), psychiques (fatigue, trouble du sommeil, dépression…) et psychiatriques (schizophrénie).
Grâce au rire, notre cœur tend à ralentir, les vaisseaux se relâchent et nos muscles se détendent : le combo parfait pour réduire notre état de stress et ainsi éviter les maladies les plus graves. Aussi, les sécrétions d’endorphines qu’il provoque permettent l’apaisement de notre corps réduisant considérablement l’excès d’adrénaline et de cortisol générés par le stress.
La liste des bienfaits du rire est, je le répète, non exhaustive. En effet, il aurait aussi des effets bénéfiques sur notre sommeil, notre système immunitaire, notre sexualité et dans bien d’autres domaines encore…

La thérapie par le rire ça existe !
Aussi étonnant que cela puisse paraître, la thérapie par le rire existe, et elle est même plutôt réputée.
On dénombre aujourd’hui près d’un millier de centres de bien-être en France qui proposent un cours de « yoga du rire » basé sur des exercices pour apprendre à rire sans raison en stimulant sa capacité à rire pour se relaxer, libérer ses inhibitions et développer une attitude positive envers la vie.
De nombreuses associations se développent également, créant des « groupes du rire », des lieux exclusivement réservés aux fous rires et à la bonne humeur communicative. Alors ne perdons pas de temps et inscrivons-nous ! Le seul risque que nous prenons est de rire, rire et rire encore…
Conclusion
Pour conclure, je vous dirais tout simplement : essayez de provoquer des situations propices au rire, et marrez-vous ! Riez encore et encore, et votre corps vous dira merci. Faites le stock de blagues, remplissez votre bibliothèque de comédies, sortez avec des gens drôles et positifs, et si cela ne suffit pas, inscrivez-vous à des cours de rire ! Votre bien-être psychique et physique s’accroîtra. Alors pourquoi s’en priver ? Mieux vaut une bonne dose de rire quotidienne qu’une bonne ordonnance, non ?
Charlotte Vallet
Hypnothérapeute et Sophrologue à PARIS
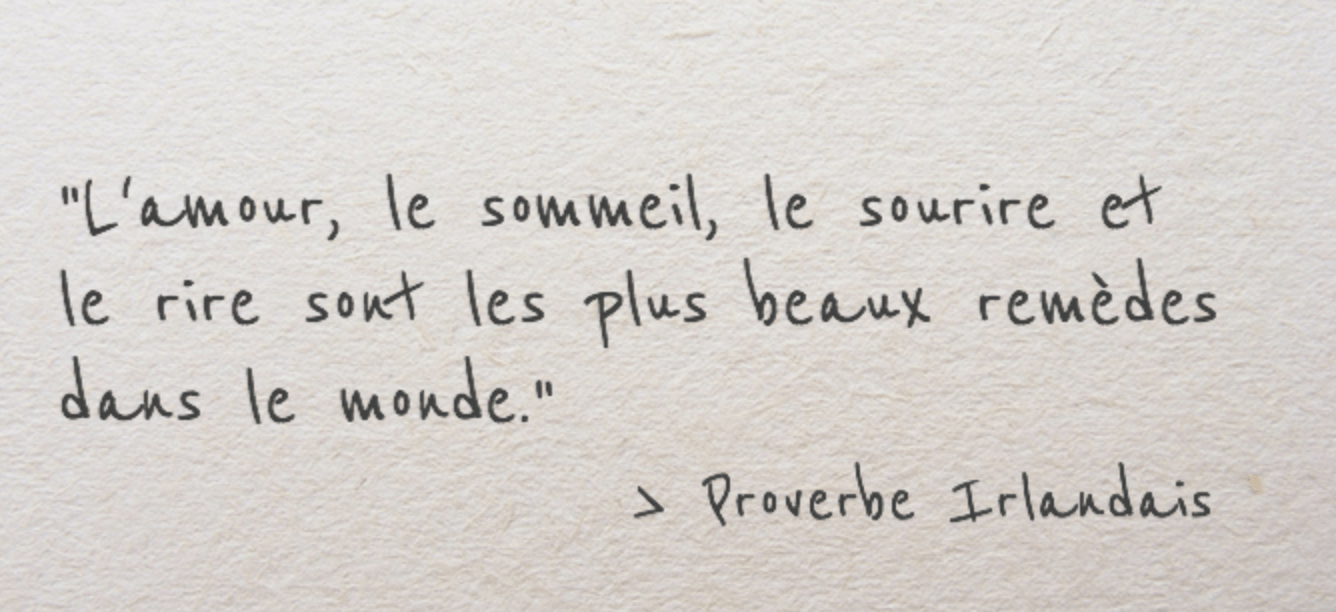
-
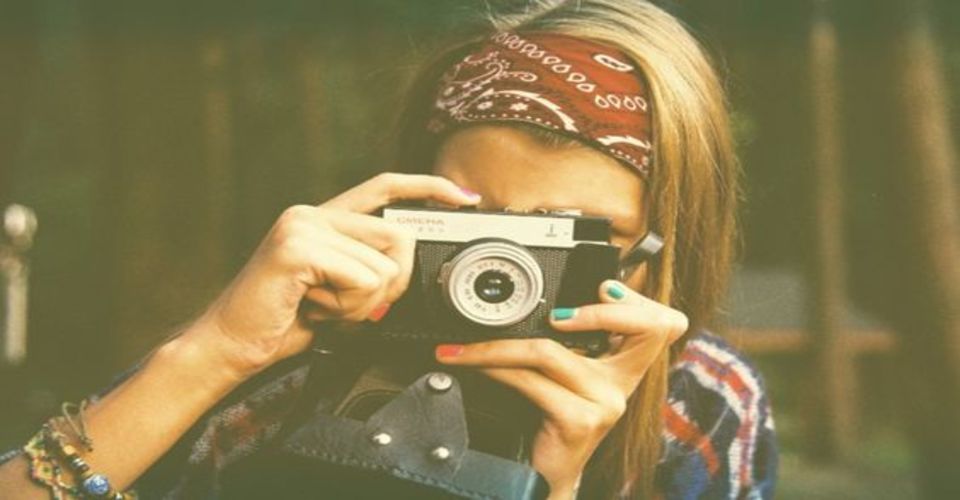
Se libérer du poids de la famille
L’intrusion excessive d’une mère, d’un père ou des deux… L’abandon d’une mère, d’un père ou les deux… La tristesse, la colère, les rancunes… Les secrets, les non-dits… Autant de choses que nous accumulons dans notre sac à dos d’enfant qui peut alors devenir très lourd à porter. Comme un boulet qui s’accroche à nous et que nous traînons de plus en plus difficilement jusqu’à l’âge adulte, voire toute une vie. C’est pourquoi il faut qu’arrive un jour, « ce jour », où naît en nous cette envie de nous en libérer !
Que nous le voulions ou non, nous sommes tous largement influencés par notre enfance, qui a constitué le terrain vierge sur lequel nos premières expériences ont laissé des empreintes profondes. Ces influences initiales, bienveillantes ou intelligentes, maladroites ou médiocres, parfois traumatisantes constituent le bagage psychique fondamental avec lequel nous affrontons tous, un jour ou l’autre, la complexité de la vie d’adulte.
Nous la subissons ou nous la choisissons. Mais y sommes-nous alors bien préparés ? Pouvons-nous nous dégager du poids de notre histoire familiale ou restons-nous éternellement tributaires de nos racines ? Pourquoi est-ce si difficile, et comment y parvenir ?

Quand le poids de la famille nous étouffe
Le poids de la famille : Quèsaco ?
Jacques Salomé a dit : « Les temps de l’enfance sont déposés en nous pour toujours. Ils forment la trame inusable de nos existences tissées de rencontres magiques ou toxiques, de séparations nécessaires, inévitables, imposées ou choisies, de rêves innombrables, de projets féconds et de quelques réalisations. »
En effet, derrière chaque adulte, se cachent un enfant et une famille avec laquelle il a grandi. Chaque famille à son histoire et celle-ci peut parfois peser lourd, très lourd ! À tel point que l’envol de l’enfant vers l’âge adulte se fait difficilement.
Parents omniprésents, étouffants, intrusifs ou directifs. Anxieux, angoissées, craintifs ou infantilisants. Rejetants, dénigrants ou culpabilisants. Idéalisés et imposants. Déficients, infantiles, démissionnaires ou démunis. Séducteurs. Dépressifs, paumés, engloutis par leurs propres problèmes. Violents. Pervers, ou tout simplement absents.
Autant de cas de figure qui peuvent créer un déséquilibre chez l’enfant et devenir un réel frein pour se construire. Un frein qui se transformera très vite en un véritable poids si l’on ne réussit pas à se détacher de cette « emprise familiale ».

Les conséquences
Petites misères, grandes douleurs, le poids d’une enfance non digérée est souvent une bombe à retardement avec ses conséquences plus ou moins graves sur le présent.
Les relations devenues fusionnelles ou au contraire distantes entre nous et nos parents, nos frères et sœurs, nos amis ont très souvent des répercussions sur notre psychique, notre corps, nos relations personnelles et professionnelles, sur notre quotidien tout simplement.
« Je culpabilise de lui avoir dit non », « je suis peut-être allée trop loin », « elle/il m’étouffe », « elle/il n’est jamais là quand j’ai besoin d’elle/de lui « … On a tous, un jour, pu prononcer ces phrases ou les penser et la liste est bien sûr non exhaustive ! La culpabilité, le manque de confiance en soi, le manque d’autonomie, la dépendance sont autant de troubles psychiques qui font entrave à notre sérénité et que nous devons apprendre à combattre pour avancer sereinement sur le chemin de la vie.
Et si pour certains les conséquences sont minimes ou peu importantes, elles peuvent en revanche être dramatiques pour d’autres. En effet, si les relations sont trop toxiques, si les blessures sont trop profondes et la souffrance énorme, les effets sur nous peuvent être désastreux. Un nombre important de maladies peuvent se déclarer à la suite de ce mal qui nous a rongé pendant trop d’années. Certaines personnes développent des maladies psychiatriques (troubles obsessionnels, addiction, névroses, bipolarité sévère, maladies chroniques, schizophrénie…) ou des maladies comme le cancer, par exemple. Une rancune qui nous asphyxie, un manque d’amour (ou plutôt un amour mal distribué), beaucoup de stress accumulé et c’est la cocotte-minute qui explose un jour ou l’autre !
Afin d’éviter tout ça, prenons le taureau par les cornes et vite ! Décidons une fois pour toutes de dire stop à cette aliénation nocive et choisissons de guérir enfin de tous ces mots/maux !
Comment en guérir ?
Guérir de ses blessures d’enfance est une nécessité pour tendre vers la paix intérieure. Mais, on attend trop souvent un déclic pour changer, pour se décider enfin à prendre notre vie en main. Un déclic… Ah ! Que ce serait agréable de se réveiller un beau jour et de sentir que sans effort, nous réussissons à mettre en place des comportements plus justes, qui nous amènent à une vraie libération. « La nuit porte conseil », « À chaque jour suffit sa peine », « Demain est un autre jour », nous ne manquons pas de petits proverbes, compris dans un sens rétréci, et qui nous poussent à ne rien faire, à attendre que cela vienne tout seul ! La vie distribue des opportunités et des obstacles de façon aléatoire, et voir sa chance passer, nécessite au moins d’ouvrir les yeux et d’avoir décidé que le prochain train, on le prendra ! Mais pour cela, il faut vraiment le vouloir.
Se libérer de ce poids familial peut en effet être un long chemin semé d’embûches qu’il est pourtant nécessaire d’emprunter si l’on veut y parvenir ! Et comme tout processus de changement, cela s’apprend. Ouf !
Si l’on se sent suffisamment prêt : en solo
Les étapes à franchir pour se libérer de l’emprise familiale
Déjà tout au long du parcours, il faudra garder en tête deux choses :
- Se libérer ne veut pas dire ne plus les aimer.
- Reprendre sa « réelle » autonomie, s’émanciper, c’est dur, parfois long mais ça vaut le coup !
On y va !
- Prendre conscience de notre héritage psychique. C’est un fait, cet héritage est là et nous devons le prendre en compte.
- Dialoguer en toute franchise avec l’enfant que nous étions hier.
- Tourner une bonne fois pour toutes la page de l’enfance.
- Rendre à César ce qui est à César. Nous ne devons pas tout porter sur nos épaules, ni rejeter toute la faute sur le ou les parents. Car on a aussi notre part de responsabilité. Dans le cas d’une relation fusionnelle, c’est aussi une solution de facilité que de se laisser porter par la relation
- Trouver sa place.
- Dans le cas d’une relation toxique, couper définitivement le cordon avec la ou les personnes avec qui nous entretenons cette relation.
- Pardonner si l’on peut/doit mais pas n’importe comment.
- Se réconcilier, si c’est ce que nous souhaitons.
Et si ça ne suffit pas : on se fait aider
Ces étapes, reconnaissons-le, sont difficiles à passer. Même avec beaucoup de volonté, il est difficile de s’en sortir seul. Alors, n’oubliez pas que les médecines douces peuvent vous aider. Notamment l’hypnose, la méditation ou encore la sophrologie. Elles permettent toutes les trois de se recentrer sur soi-même, de prendre conscience de l’environnement dans lequel nous sommes, grâce à une connexion profonde entre le conscient et l’inconscient ou tout simplement par des exercices de relaxation et de respiration profonde. Leurs bienfaits ne sont plus à prouver, à vous de les tester.
Exerçant à Paris, je suis à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ! N’hésitez pas à me contacter en MP ou à consulter ma page Facebook.
Conclusion
Finalement, pour nous libérer des peines de notre enfance, de cette empreinte voire emprise familiale, pour trouver la force de construire la vie que nous souhaitons et choisir notre activité, nos amis, nos amours, nous avons à mûrir quelque temps et à faire des efforts pour nous extraire de nos enfermements. C’est grâce à ces efforts et la patience qu’ils exigent, que nous comprenons, que nous nous renforçons, que nous décidons, que nous agissons. C’est par ce combat acharné que nous pourrons enfin nous délivrer, devenir nous-même et être enfin en paix.
Charlotte Vallet – Coach spécialisée en émancipation féminine
-

Le pardon : un pansement sur nos blessures émotionnelles
Non ! Jamais, je ne lui (leur) pardonnerai ! On a eu si mal, et parfois on a encore si mal, qu’il est souvent inenvisageable de pardonner. Avouons même, que l’on est plutôt dans un esprit de vengeance que dans un esprit de pardon…
Pourtant, c’est une erreur. Car lorsque l’on a été blessé, la blessure ne peut se refermer que si on la soigne. Et souvent la vengeance ne fait que l’aggraver. Le seul moyen de guérir est d’apprendre à pardonner.
Contrairement à ce que l’on pense, pardonner n’est pas un acte de faiblesse. Le pardon est une réelle faculté. Il permet d’abandonner nos rancunes, de changer notre regard sur celui qui nous a fait du mal, et surtout de nous apaiser et de nous libérer. Mais qu’est-ce que le pardon ? Et comment faire ?

Je n’ai jamais réussi à pardonner. Certes, mais ce n’est pas sans conséquences
Il nous est, à tous, arrivé un jour, et après avoir subi « quelques » traumatismes, de nous fâcher (restons poli…) avec quelqu’un : une amie, un petit ami, ses parents… Et ici, je ne parle pas d’une « petite dispute », mais de quelque chose de sérieux ayant conduit à une rupture plutôt violente, par exemple. S’en suit, au niveau émotionnel, tout un tas de réactions : révolte, colère, tristesse, désarroi, voire souvent une déprime…
Progressivement, une rancune profonde s’installe en nous, rancune consciente ou inconsciente qui, d’une part nuit à notre bonheur sur des périodes plus ou moins longues, et d’autre part peut aussi avoir des conséquences sur notre propre comportement. De surcroît, on passe beaucoup de temps à ruminer. Et ruminer, c’est une véritable source de stress et de mal-être dont il faut se débarrasser.
Mais attention, je ne dis pas que le pardon est la panacée ! Car si de nombreuses blessures peuvent être soignées par le pardon, tout n’est pas toujours pardonnable. Toutes les blessures peuvent-elles se refermer ? À cette question, pas de réponse par oui ou par non ! C’est à chacun de nous d’en juger. Mais si vous choisissez la voie du pardon, j’espère vous donner dans cet article quelques pistes pour y parvenir…
Mais pardonner, ça consiste en quoi ?
Nous pensons souvent que pardonner est une façon d’excuser ou d’oublier le mal fait. FAUX !
Nous pensons aussi que pardonner veut forcément dire : se réconcilier. Encore FAUX !
Le pardon, ce n’est donc pas « s’excuser ». Ce n’est pas non plus oublier, ou même se réconcilier.
Pardonner, c’est être capable d’abandonner la rancune qui nous ronge pour retrouver la paix avec nous-même. C’est la clé pour nous libérer de toutes les pensées négatives qui nous envahissent et nous obsèdent : une sorte de pansement émotionnel qui nous permet de ne pas nous autodétruire par le stress du ressentiment.
Mais comment y parvenir ?
Parfois, se mettre à la place de l’autre peut suffire
Essayons d’abandonner notre rancune et mettons-nous à la place de l’autre au moment où il nous a fait du mal. Peut-être avait-il(elle) des problèmes personnels ou professionnels. Le but, ici, est d’essayer de comprendre ce qui pourrait expliquer son geste, ses faiblesses, sa zone de vulnérabilité. Il faut également essayer de se remémorer les bons moments passés ensemble et décider de passer l’éponge. Plus facile à dire qu’à faire, me direz-vous ! Mais en faisant ces efforts, nous permettons à notre cerveau de réévaluer, en quelque sorte, l’événement traumatisant en des termes plus positifs. C’est un moyen de changer notre regard sur la situation afin que cette rancune toxique qui nous grignote, se transforme et commence à disparaître.

Et si on n’y parvient pas, pardonner ça s’apprend !
Vous l’avez compris, il n’y a pas de baguette magique. Le processus ne s’enclenche pas aussi vite pour tout le monde. En effet, certaines personnes le mettent en place spontanément et d’autres avec beaucoup plus de difficultés. Mais rien n’est perdu, nous pouvons tous apprendre à pardonner et y arriver. Nous pouvons comparer ce processus à un entraînement sportif. Vous serez sûrement d’accord avec moi : il faut de la volonté et beaucoup de travail pour atteindre la première place du podium. Eh bien, ces deux qualités sont aussi nécessaires pour atteindre le pardon.
Alors, place à l’exercice et aux techniques pour atteindre notre objectif.
Le processus du pardon, un petit exercice
Pour accompagner toutes les personnes qui souhaitent emprunter le chemin du pardon, le centre Greater Good de l’université de Californie, à Berkeley a mis au point des exercices inspirés des dernières découvertes en neurosciences et en psychologie. Voici un exemple d’exercice conçu par le Dr Fred Luskin de l’université de Stanford.
Cet exercice (résumé) comporte huit étapes :
- Étape 1 : Avoir une vision claire du mal qui nous a été fait et être capable d’exprimer précisément pourquoi nous avons été blessé.
- Étape 2 : Se faire la promesse d’aller mieux ; le pardon étant une démarche que l’on fait avant tout pour nous-même.
- Étape 3 : Garder à l’esprit que pardonner ne veut pas dire se réconcilier.
- Étape 4 : Se rendre compte que ce que l’on ressent n’est pas la conséquence de l’offense qui nous a été faite mais de nos propres pensées.
- Étape 5 : Pratiquer des exercices antistress dès que l’on se sent envahi par des pensées négatives.
- Étape 6 : Faire le choix de ne pas attendre des autres ce qu’ils sont incapables de nous donner.
- Étape 7 : Avoir une vision positive de la vie tournée vers l’avenir plutôt que nous focaliser sur nos sentiments négatifs liés au passé.
- Étape 8 : Vous êtes en mesure de pardonner !

La méditation, une technique vers le pardon…
La méditation fait partie des techniques qui peuvent aider dans ce processus long et intime qu’est le pardon. Elle permet de développer de la matière grise dans une zone bien précise de notre cortex, ce qui nous confère une capacité plus importante à imaginer les pensées des autres, et nous permet donc de pardonner plus facilement.
Et rassurez-vous, contrairement à ce que beaucoup pensent, méditer n’est pas se vider ! Ce n’est pas non plus, ne plus rien ressentir, bien au contraire.
La méditation, ce n’est pas « être autrement » mais c’est « être posé ». C’est prendre conscience de chaque partie de son corps dans son environnement, au sens large du terme. Elle permet de nous rapprocher de nous-même, de réaliser pleinement ce que nous sommes et de l’accepter.
Et comme toute pratique la méditation s’apprend !

… mais aussi l’hypnose et la sophrologie
Ces deux autres techniques, toutes aussi bénéfiques que la méditation, nous permettent de nous libérer de ces poids dont nous sommes lestés et qui nous empêchent de vivre en paix !
En ce qui concerne l’hypnose, le but est de mettre le patient dans un état hypnotique qui permet d’accéder à son inconscient. Le thérapeute, via un dialogue, induit une modification de l’état de conscience. Son rôle est ensuite de soutenir l’imaginaire, pour aider le patient à trouver lui-même les ressources qu’il possède et qui peuvent l’aider à guérir de ses souffrances.
La sophrologie, autre technique, vise à amplifier la sérénité et le mieux-être. La sophrologie repose sur des techniques de relaxation et d’activation du corps et de l’esprit. Elle amène les individus à travailler sur leurs propres valeurs et à mieux se connaître. Et ainsi à trouver les solutions qui leur correspondent.
Sophrologue et hypnothérapeute à Paris, je suis en mesure d’en parler et de vous aider. N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en discuter.
Conclusion
Pardonner, quand c’est possible : c’est possible ! Mais ça peut être long. Il faut en avoir conscience lorsque l’on décide d’entrer dans ce processus. Avec de la volonté et du travail, nous pouvons tous y arriver, et nous libérer enfin de toute cette rancune et cette colère qui nous envahissent au quotidien. Pardonner nous rend donc plus heureux, lesté de ce poids, débarrassé de ce mal qui nous ronge. C’est donc encore plus qu’un pansement sur nos blessures émotionnelles ! C’est guérir.
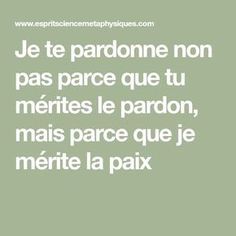
Charlotte Vallet
Hypnotherapeute et Sophrologue sur PARIS
-

Comment réussir à lâcher prise ?
Lâcher prise ! Voilà encore un concept très à la mode… et qui peut sembler étrange lorsque l’on est élevé dans un monde dominé par le diktat de la compétition et de la performance. On nous inculque pendant toute notre enfance et adolescence qu’il faut « être ainsi et pas comme ça », « être le meilleur », « être quasiment parfait » « faire le mieux possible », et j’en passe et des meilleures… Et voilà qu’arrivés à l’âge adulte, on nous rabâche, « sois plus zen », « relativise », « vis au jour le jour », il faut « lâcher prise »…
Quel paradoxe !
Soit le meilleur, mais soit zen ! Avouez que c’est antinomique. D’autant que le monde dans lequel nous évoluons ne semble pas se diriger vers de la zénitude… La pression existe bel et bien, et à mon avis, elle ne fera que s’amplifier. Et malheureusement, elle engendre tout un tas de phénomènes qui nous sont néfastes. Parmi eux, la peur. Nous sommes très tôt confrontés à la peur. Peur de ne pas plaire à nos parents, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être aimé, peur de manquer… et petit à petit, nous développons des systèmes d’autodéfense qui se traduisent par des comportements plus ou moins extrêmes selon les individus : besoin de perfectionnisme, besoin de contrôle, obsession, addiction… qui eux-mêmes engendrent angoisse, stress, mal-être, dépression et maladies graves. C’est un cercle infernal.
Et en effet, le seul moyen de se sortir de ce cercle vicieux est d’apprendre à lâcher prise. Disons-le d’emblée, ce n’est pas si facile.

Qu’est-ce que le lâcher-prise ?
D’après le Larousse : le lâcher-prise est le « moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise. »
Autrement dit, d’après cette définition, la cause de certains maux est liée au désir de maîtrise. Certes… c’est bien vrai ! Mais le mot le plus important dans cette définition, c’est « libération ».
En effet, le lâcher-prise, c’est se libérer d’un état d’angoisse quasi permanent lié à un état d’effervescence mentale que l’on ne maîtrise pas non plus. L’objectif est donc d’apprendre à se détacher « temporairement » de cet état, de souffler, et comme nous allons le voir, de vivre !
À qui s’adresse le lâcher-prise ?
- À ceux qui se posent sans cesse des questions sur tout.
- À ceux qui vivent soit dans le passé (et dans la culpabilité ou le regret), soit dans l’avenir (et dans le souci de vouloir tout prévoir pour que tout soit parfait).
- À ceux qui ont un besoin d’être souvent rassurés.
- À ceux qui idéalisent la vie et qui court après un idéal inatteignable.
- À ceux qui n’ont pas suffisamment confiance en eux, ou à l’inverse, à ceux qui n’ont plus confiance dans les autres.
- À ceux qui veulent tout maîtriser de leur propre vie, et qui veulent aussi maîtriser celles des autres (ou changer les autres).
- La liste est longue…
Si vous prononcez souvent ces mots : « j’aurais dû » ou « je devrais » ou ces mots « mais, si ? » ou « et, si ? » ou « il faudrait que », « c’est nul », « je suis nulle », « il est nul » « c’est pas assez » … vous êtes un parfait candidat.
Si vous avez l’impression d’être sans cesse insatisfait de vous et par les autres, de votre situation, si vous êtes angoissé, toujours stressé, souvent malade… eh bien, vous pouvez continuer à lire cet article. 🙂
Mais avant toute chose, ancrez-vous dans la tête, et à longueur de journée, s’il le faut, les trois « postulats » qui suivent.
Trois éléments essentiels indispensables au lâcher-prise
Le passé est immuable. Vous pouvez toujours vous triturer la tête dans tous les sens, vous ne changerez pas le passé. Il faut soit l’accepter, soit le travailler en thérapie pour apprendre à vivre avec lui.
L’avenir est incontrôlable. Vous pouvez tout planifier de A à Z, il peut toujours se produire un évènement qui remettra en cause ce que vous aviez envisagé. Vous ne pouvez pas maîtriser tous les éléments.
La perfection n’existe pas. Vous aurez beau essayer de faire votre maximum, c’est sans fin. On peut toujours faire mieux, et il y a toujours quelqu’un qui pourra faire mieux.
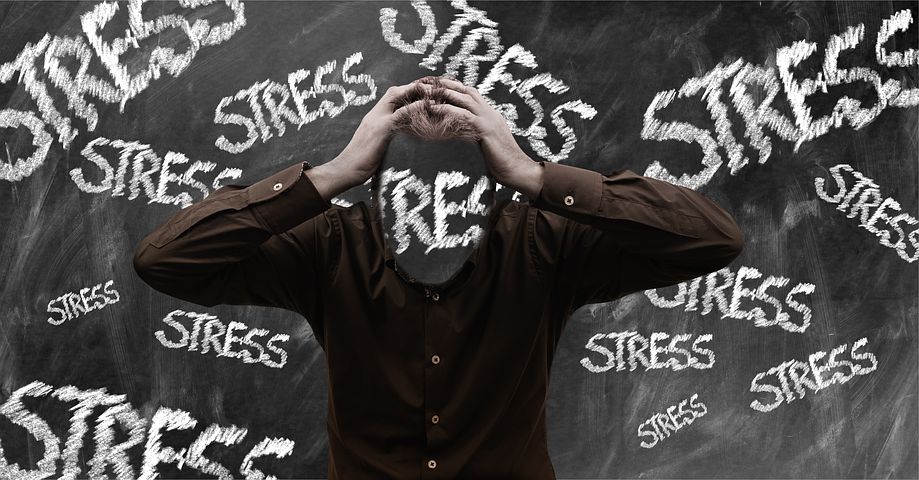
Est-ce facile de lâcher prise ?
Je l’ai déjà évoqué en introduction : non, et c’est peu de le dire. Lâcher prise demande des efforts personnels importants. C’est comme si nous devions nous déprogrammer. Laver notre cerveau de tout ce qui nous a été inculqué, transmis, de toutes nos expériences de vie qui nous fait devenir ce que nous sommes…
C’est un vrai travail. C’est un cheminement qui demande beaucoup de volonté et qui demande du temps.
Comment faire pour y parvenir ?
Se rendre compte, avoir conscience que l’on se pose trop de questions, une majorité étant inutiles
Déjà, la première étape à mon sens, et ce n’est pas si évident que cela : c’est de prendre conscience que notre esprit surchauffe, et surtout que cet état est nocif à notre bien-être et par voie de conséquence à notre santé.
Savoir distinguer les situations sur lesquelles on peut agir de celles sur lesquelles on ne peut rien faire.
Il y a en effet des choses dans la vie sur lesquelles on peut intervenir. Exemple, si votre santé se dégrade parce que vous fumez, vous pouvez de vous-même arrêter. D’ailleurs, je vous conseille fortement l’hypnose. Mais en revanche, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne peut pas intervenir. Exemple, vous avez un entretien d’embauche dans 15 jours à 8 h 30. Ce n’est pas que les dés sont jetés d’avance, mais il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu (transport, forme du jour, interlocuteur, feeling, véritables besoins de l’entreprise…) qu’il est inutile de ne penser qu’à cela et de stresser pendant 15 jours. Tout anticiper est impossible et surtout inutile…
Apprendre à relativiser
Une déception, un problème… ? Il nous arrive à tous d’être confrontés aux aléas de la vie, certains étant plus ou moins graves. Mais dans la plupart des cas, ce n’est pas la fin du monde. C’est juste qu’ils viennent perturber « notre quotidien et notre planification bien établie » et qu’ils déstabilisent l’équilibre que l’on s’efforce d’atteindre. Et pour un grand nombre d’entre nous, ils engendrent une espèce de panique, de stress. Car on a tendance à amplifier les conséquences du problème. On a tous connu l’ordinateur en panne, le métro en grève, bref, ces aléas qui, en soi, ne sont pas dramatiques… mais qui nous mettent dans un état de panique. Dans ces moments, il est alors important de se poser. Et de relativiser, de se dire que ce n’est pas si grave. Mieux vaut une imprimante en panne, qu’une inondation dans un appartement ! Croyez-moi…
Savoir faire le deuil
Pour ceux qui vivent dans le passé, il est primordial d’apprendre à tourner la page, ou tout au moins à accepter que tout ne se soit pas déroulé comme on le voulait ou le pensait. Je vous accorde que c’est très long. On peut en effet avoir du mal à oublier une histoire d’amour malheureuse, le décès d’un proche, un échec professionnel… mais passer son temps à ressasser le pourquoi du comment… ne changera rien au problème. Il faut tirer des leçons du passé, et transformer, quand c’est possible, ses peines en force.
Faire plus confiance aux autres. Travailler son ego…
Si dans de nombreux cas, le manque de confiance en soi engendre de la peur et du stress, le fait de ne pas faire confiance aux autres est également source de stress. Parmi les gens qui ont besoin de lâcher prise, on trouve souvent des gens qui n’aiment pas renoncer ou qui n’aiment pas déléguer (ce fameux besoin de maîtriser). Ils pensent qu’ils sont les seuls à pouvoir trouver une solution ou à faire correctement les choses. Certes c’est une question d’ego, mais pas que. Il faut juste trouver les bonnes personnes. Quant à la confiance en soi, elle se travaille.
Se forcer à apprendre à vivre le moment présent
Il faut également prendre conscience qu’une journée qui passe est une journée qui ne reviendra plus. Prendre conscience de l’instant et le vivre avec plaisir. Si l’on passe son temps tourné vers le passé ou dans l’anticipation, la conclusion est rapide : on n’est jamais dans l’instant. Autrement dit : on ne vit pas.

Quelques outils ou techniques pour vous aider !
La sophrologie
Développée dans les années 60 par un neuropsychiatre, la sophrologie est une alternative efficace aux antidépresseurs que l’on vous prescrira pour « supporter » la vie… D’ailleurs, le mot sophrologie vient du grec, « sos » tranquillité, « phren » qui signifie cerveau, et logos qui veut dire étude. C’est donc l’étude de la sérénité de l’esprit. Sophrologue, je pense donc être en mesure d’en parler et de vous aider. D’ailleurs, je vous invite à me contacter si vous souhaitez en discuter. C’est à mon sens, un excellent moyen d’apprendre à se libérer de sa charge émotionnelle.
La méditation
Il est aujourd’hui prouvé scientifiquement que la méditation, qui est LA gymnastique de l’esprit, aide à diminuer stress, angoisse, anxiété, etc. Elle participe à une amélioration du bien-être. L’avantage est que vous pouvez la pratiquer seule.
Vous déconnectez du monde et notamment des réseaux sociaux
Si les réseaux sociaux peuvent parfois aider à communiquer, ils deviennent pour beaucoup d’individus, une source de stress. Entre les drames, les injustices, la haine, les fake-news, les incitations qui nous sont transmis toutes les secondes sur Facebook, et les images idylliques de paysages, les mannequins photoshoppées, les citations censées nous motiver sur Instagram… nous imposons à notre esprit tout un tas d’informations contradictoires, qu’il ne peut pas gérer. Le soir notamment, obligez-vous à vous déconnecter des réseaux sociaux.
Faire du sport et/ou s’adonner à une activité que l’on aime
Les bienfaits du sport ne sont plus à justifier… La pratique d’une activité physique permet, entre autres, de se reconnecter à l’instant présent. On se vide la tête, on souffle… De même, on aime tous faire quelque chose : lire, cuisiner, regarder des séries, jardiner… Et souvent, on se trouve des excuses pour ne pas s’y consacrer… Eh bien, stop ! Obligez-vous, en vous fixant un horaire strict, à vous décontracter en vous consacrant à quelque chose qui vous plaît.
Il existe d’autres outils, bien sûr, et si vous avez la chance d’habiter Paris, je me ferai un plaisir de vous le transmettre. N’hésitez pas à vous inscrire aux ateliers que j’anime sur ce sujet.
Conclusion
Vous l’aurez compris. Lâcher prise, c’est s’obliger (et le mot est volontairement choisi) à se déconnecter du quotidien, à prendre de la distance par rapport à ce qui nous perturbe l’esprit, à ne pas mener des combats perdus d’avance contre ce qui est inéluctable, c’est renoncer à l’inaccessible, c’est savoir aussi pondérer les conséquences ou les enjeux des situations, et c’est aussi savoir apprécier le moment présent.
Finalement, si vous apprenez à lâcher prise, vous découvrirez ce que veut dire « vivre ».
Lâcher prise, c’est tout simplement apprendre à vivre !
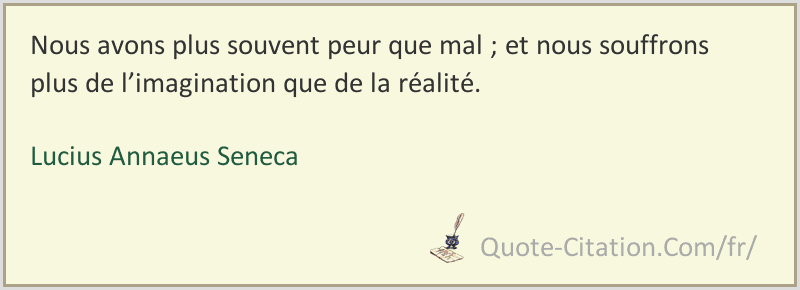
Charlotte Vallet, sophrologue et hypnotherapeute sur Paris
-

L’hypnose : en quoi cela consiste et pourquoi y avoir recours ?
On y croit ou pas… On y est sensible ou pas… On en a peur ou pas. Quoi qu’il en soit, l’hypnose intrigue. Mais aujourd’hui, c’est un outil thérapeutique reconnu, et qui est de plus en plus utilisé notamment pour soulager, voire traiter de nombreux maux de différentes natures et ayant différentes causes. Comment ? En échangeant sans contraintes, avec son propre corps.
Les plus sceptiques d’entre vous devraient se référer aux résultats. Eh oui ! Car même si les mécanismes de l’hypnose ne sont pas encore véritablement connus et explicables, son efficacité ne peut plus être mise en question.
Une preuve ? Depuis une dizaine d’années, l’hypnose remplace l’anesthésie générale pour un certain nombre d’interventions chirurgicales. C’est donc que ça fonctionne ! Qui irait se faire triturer le ventre sans anesthésie ?
Il n’y a pas une seule et unique définition de l’hypnose. De nombreux psychiatres, médecins, etc., en ont donné leur propre définition : Milton Erickson, Daniel Araoz, André Weitzenhoffer, Jean Godin, Michel Kérouac, Olivier Lockert, Bernheim pour ne citer qu’eux… Et contrairement à ce que l’on pense, l’hypnose existe depuis fort longtemps ! Il est difficile de dater exactement ses premières utilisations, mais il est reconnu que dans l’Égypte ancienne, les Égyptiens essayaient déjà d’en tirer des bénéfices. Le pharaon Ramsès II y avait recours notamment pour motiver ses soldats à partir au combat.
Et de nos jours, l’hypnose est reconnue comme une médecine douce, de plus en plus pratiquée, qui participe à atténuer, voire à traiter de nombreux troubles qui nuisent à notre bien-être.
Alors, en quoi cela consiste ? Qui est concerné ? Pourquoi y avoir recours ?

Mais d’abord quelques petits rappels de base (et simplifiés)
L’objectif d’une séance d’hypnose est de modifier l’état de conscience, pour atteindre un état de transe dans lequel des évènements ou des émotions enfouis dans l’inconscient ont plus de chances de refaire surface. Et à partir de ces éléments, une solution est recherchée. Mais conscience, inconscience, transe, quèsaco ?
L’état de conscience : l’état de conscience est celui qui nous guide lorsque nous sommes “éveillés”. Autrement dit, c’est être dans en état de vigilance et de contrôle qui nous permet de guider nos actes en fonction d’un grand nombre de paramètres qui nous conduisent à raisonner et à agir, mais qui nous bloquent aussi.
L’état d’inconscience : c’est un état beaucoup plus subjectif dans lequel s’entremêlent des souvenirs plus ou moins enfouis, des émotions plus ou moins fortes, des intuitions… Mais pour faire plus simple, disons que l’inconscient concerne tout ce qui n’est pas conscient et que nous ne pouvons pas maîtriser.
L’état de transe : non, ce n’est pas uniquement l’état dans lequel se trouve un drogué après avoir pris son héroïne… C’est d’ailleurs même un état que nous connaissons tous très bien sans même le savoir. C’est un état dans lequel on focalise tellement notre attention sur quelque chose de bien précis que l’on en oublie tout le reste. Un état proche d’une ultra concentration. Il nous arrive à tous, en exerçant une activité, d’être tellement concentré que l’on ne se rend plus compte de rien.
Et c’est à partir de ce principe que l’hypnose fonctionne. L’objectif est de se frayer un chemin entre l’état de conscience et l’état inconscience.
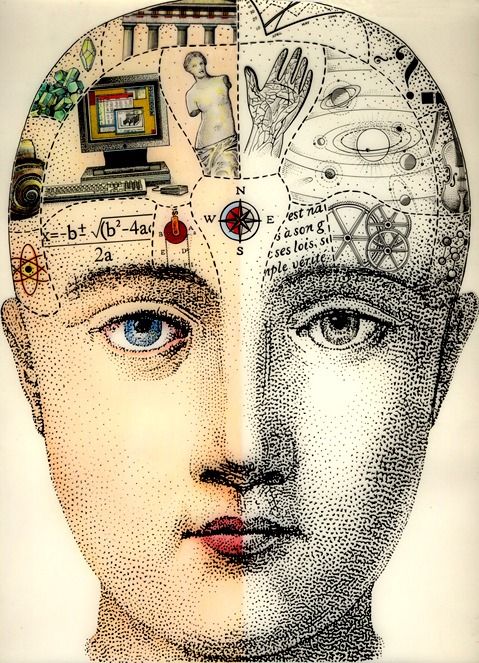
Les différents types d’hypnose
Il existe différents types d’hypnose, mais je n’aborderai ici que les deux plus connues, l’hypnose classique (traditionnelle) et l’hypnose Ericksonienne.
L’hypnose classique, c’est celle que tout le monde connaît. En effet, lorsque l’on prononce le mot hypnose, le commun des mortels pense aux hypnotiseurs que l’on voit dans les spectacles, et qui ont « le pouvoir d’endormir » les gens. La personne est passive, et l’hypnotiseur utilise des injonctions pour modifier l’état de conscience des individus. C’est un type d’hypnose autoritaire, si l’on peut dire.
Mais dans le cadre d’une démarche thérapeutique, ce n’est pas le même type d’hypnose qui est utilisé. Dans ce cas, il s’agit de l’hypnose appelée « hypnose Ericksonienne ». Ce type d’hypnose dite « moderne » doit son nom à Milton Erickson, un psychiatre américain mort en 1981, qui était dans son enfance daltonien et dyslexique. À 17 ans, il contracte la poliomyélite qui le rend complètement paralysé. Il ne peut alors que parler et bouger les yeux. Et c’est dans ce contexte qu’il découvre le pouvoir de l’autosuggestion. Autrement dit, il se convainc qu’il peut se guérir. Peu à peu, il réussit à faire bouger ses muscles, et en quelques mois, il recouvre toutes ses facultés motrices. Un miracle ? Non, les miracles n’existent pas. Nous avons en nous une force qui nous permet de vaincre certains maux.
Dans le cas de l’hypnose Ericksonienne, le patient est dans un état de profonde relaxation, en transe, comme je l’ai défini précédemment. Contrairement à l’hypnose traditionnelle, le patient participe activement à sa mise en situation hypnotique.
Et pour ceux qui veulent aller plus loin encore, ils peuvent avoir recours à l’hypnose « spirituelle », au cours de laquelle l’hypnothérapeute guide le patient à la recherche de ses vies antérieures.
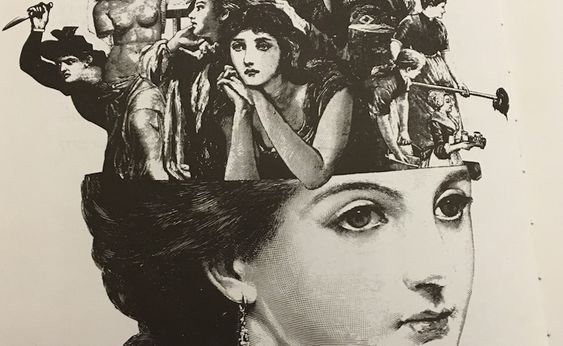
Tout le monde peut-il être hypnotisé ?
Dans le cadre de l’hypnose dite classique (celle des spectacles), il se dit que seuls 10 % des gens peuvent être hypnotisés. Il s’agit de personnes « suggestibles ». Dans les salles de spectacle, les personnes montant sur scène ont été choisis préalablement selon leur suggestibilité.
À l’inverse, de nombreuses études montrent que 80 % des individus sont réceptifs à l’hypnose Ericksonienne. Bien évidemment, le patient doit être consentant. D’une part, cet outil thérapeutique requiert l’adhésion du patient, mais d’autre part, il ne faut pas faire partie de 5 % d’individus qui y sont complètement réfractaires.
Bien sûr, dans les 80 %, c’est plus difficile pour les gens qui sont perpétuellement dans le contrôle, mais même les plus tenaces peuvent être hypnotisés. Il faut alors plus de séances et surtout de la bonne volonté.
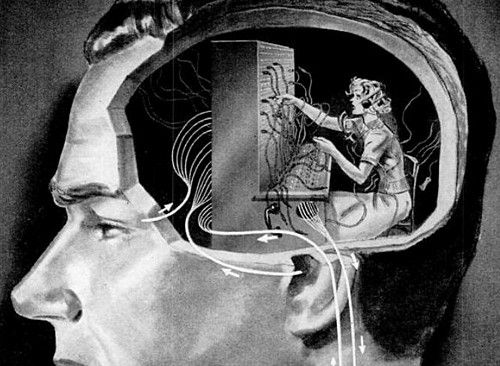
Que peut-on attendre de l’hypnose ?
Même s’il est difficile de généraliser, l’hypnose a fait ses preuves notamment pour affronter une situation particulière qui nuit à notre quotidien et donc pour trouver des solutions afin d’adopter de nouveaux comportements. Le champ des problèmes traités est très vaste, et je ne citerai ici les principales problématiques pouvant relever de l’hypnose Ericksonienne.
- Lutter contre certaines addictions comme le tabac, par exemple.
- Lutter contre la douleur. En état d’hypnose, le corps libère des endorphines qui sont des antalgiques naturels.
- Lutter contre l’obésité ou pour maigrir tout simplement.
- Diminuer les troubles du sommeil.
- Diminuer les troubles de la sexualité (et notamment des blocages induisant des problèmes de stérilité).
- Diminuer les angoisses et le stress.
- Traiter des troubles dermatologiques tels que le psoriasis.
- Soulager des problèmes musculaires, de dos notamment.
- Soulager le syndrome du côlon irritable.
- Comprendre les troubles alimentaires (anorexie, boulimie).
- Faire resurgir, entre autres, des blessures et des traumatismes que le cerveau a enfoui dans l’inconscient et qui nuisent à l’épanouissement (méthode utilisée par Freud).
Comment se déroule une séance d’hypnose ?
Elle s’effectue en présence d’un thérapeute qui a suivi les formations nécessaires. Elle consiste en un échange entre le patient et le thérapeute.
D’une façon générale, une première séance est cependant nécessaire afin que le thérapeute recueille, avec l’accord du patient, des éléments de vie qui lui seront nécessaires pour guider les entretiens.
Puis lors des séances suivantes, le thérapeute grâce à ses outils, amène le patient dans un état de transe, dit « hypnotique » qui peu à peu le conduit vers son inconscient.
Pour ma part, voici comme je procède lors d’une séance d’hypnose :
- Accueil, mise en confiance du patient.
- Phase de questionnement notamment sur la problématique à traiter et les attentes du patient.
- Phase d’explication de l’hypnose avec des mots simples et réconfortants.
- Phase de relaxation-projection dans un souvenir agréable suggéré par le patient dans le questionnement initial.
- Phase de travail. Le principe est de travailler sur l’inconscient du client en état de transe.
- Sortie de la phase transe-hypnotique.
- Débriefing.
- Planification de la prochaine séance.
Une séance dure environ une heure. Mais en général, une séance ne suffit pas… Selon le problème à traiter, il faut prévoir entre 5 et 10 séances.
Quelques exemples concrets :
- Arrêt du tabagisme : entre 1 à 5 séances. S’il en faut plus c’est qu’il y a un problème plus important à gérer. Un manque de volonté de la part du patient, par exemple.
- Perte de poids : entre 8 et 12 séances.
- Insomnies : entre 1 à 3 séances.
Est-ce dangereux ?
Non, disons-le d’emblée. Quel que soit l’état d’hypnose, vous restez toujours maître de vos actions. Et pour ceux qui se posent la question (à juste titre), on finit toujours par se réveiller. Et contrairement à ce qu’il peut se dire, un hypnothérapeute ne peut pas avoir d’influence sur vos pensées. L’hypnose n’est pas un lavage de cerveau. Vous pouvez donc y aller en toute confiance, sous réserve bien sûr de choisir un véritable thérapeute.
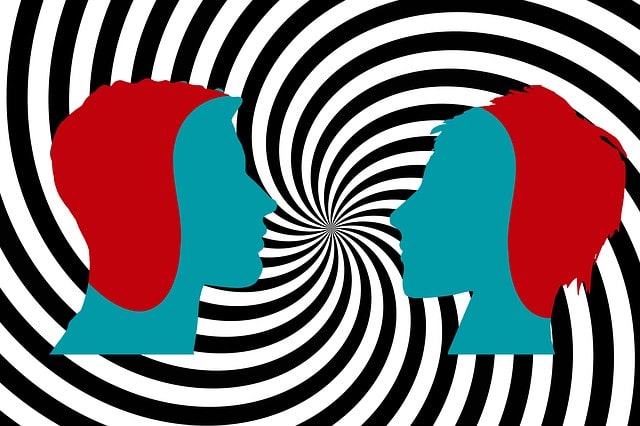
Vous êtes intéressé(e) ?
À la fois sophrologue et hypnothérapeute, j’ai suivi diverses formations m’octroyant les compétences et les aptitudes pour pratiquer l’hypnose et vous aider à résoudre divers problèmes. J’interviens à Paris et en proche banlieue. N’hésitez pas à me consulter ma page pro ou à me contacter directement en MP ou par mail : charlottevallet@hotmail.com.
« L’hypnose, c’est une relation pleine de vie qui a lieu dans une personne et qui est suscitée par la chaleur d’une autre personne »
Erickson
À très bientôt !
Charlotte Vallet
Sophrologue et Hypnothérapeute à Paris et proche banlieue
-

Quand l’esprit domine le corps
Platon disait « les MAUX du corps sont les MOTS de l’âme, ainsi on ne doit pas guérir le corps sans chercher à guérir l’âme. »
Dans les traditions indiennes et chinoises, le corps et l’esprit ne font qu’un, depuis la nuit des temps. Pourtant, c’est encore loin d’être le cas dans notre civilisation occidentale, où pour monsieur Tout-le-monde, le corps et l’esprit sont deux entités indépendantes. La faute à Descartes (et à ses disciples), qui considérait que l’âme (entité immatérielle) était radicalement distincte du corps (machine). C’est ce que l’on appelle le « dualisme ».
Mais, heureusement, depuis Descartes, la science a évolué, et la médecine reconnaît aujourd’hui l’interdépendance entre le corps et l’esprit. L’esprit peut influer sur le corps, et le corps sur l’esprit.
De nos jours, dans une société qui nous soumet à de multiples émotions en tout genre, notre corps subit de nombreux chocs émotifs que nous ne sommes pas toujours en mesure de gérer, et qui peuvent se traduire par un mal-être qui se répercute en maladie(s).
Cependant tout ceci est assez complexe, et c’est la raison pour laquelle j’ai souhaité rédiger cet article afin de tenter de vous livrer des explications simples, mais aussi des solutions.
Quelques définitions préalables et quelques explications
Le corps
Commençons par le plus simple : le corps. Et contentons-nous de la définition du Larousse. Le corps se définit comme « La partie matérielle d’un être animé considérée en particulier du point de vue de son anatomie, de son aspect extérieur ». Rien de très difficile jusqu’à présent.
L’esprit
Mais si l’on tape le mot « esprit » sur internet, on y trouve une dizaine de définitions, selon que l’on se place d’un point de vue psychologique, psychanalytique, philosophique, métaphysique, spirituel, religieux…
Pour le commun des mortels, l’esprit est « associé » au cerveau. Cependant, ce sont deux choses différentes. Le cerveau est concret : on peut le visualiser, l’analyser, le traiter. L’esprit n’est pas matérialisable. Il est invisible, propre à chacun, privé, subjectif.

Demandez à quelqu’un de vous donner une définition du mot esprit ? Personne n’aura la même.
C’est pourquoi, pour simplifier, j’associerai dans cet article, le mot « esprit » à « pensées et émotions », et que je me baserai sur l’hypothèse émise par les neurosciences : l’esprit siège dans notre cerveau.
Désormais, un nombre important d’études montrent que nos pensées, nos émotions, nos ressentis ont une influence sur notre santé. Il a été prouvé que des pathologies graves telles que le cancer, les AVC et les infarctus peuvent avoir un lien direct avec notre « esprit ».
Et ne l’oublions jamais au cours de cette lecture, l’inverse est également vrai. Des pensées positives améliorent la qualité de vie et peuvent même améliorer l’état de santé. D’ailleurs, illustrons cela tout de suite et parlons de l’effet placebo.
L’effet placebo : la preuve que l’esprit et le corps sont en lien direct
Pour ceux qui ne connaissent pas l’effet placebo, il s’agit d’obtenir un effet thérapeutique réel en faisant croire à un patient qu’il prend un médicament alors qu’il prend du sucre. Précisons que tout le monde n’est pas réceptif à ces expériences, mais bon nombre de personnes y sont sensibles.

Pour votre culture générale, on parle de l’effet placebo depuis des siècles. Mais c’est Henry Beecher qui était anesthésiste, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a publié la première véritable étude sur ce sujet, suite à ce qu’il avait observé pendant la guerre. En effet, n’ayant plus de morphine pour soulager ses patients, il leur injectait, sans leur dire, des doses d’eau salée. Et pour 35 % d’entre eux, la douleur diminuait. Même si l’on dit qu’il avait surestimé ce chiffre, il n’en demeure pas moins que l’effet placebo est aujourd’hui incontesté et incontestable. Certaines personnes qui pensent recevoir un véritable traitement voient leurs maux diminuer, ce qui prouve par A + B que la pensée agit sur le corps et dans ce cas, dans le bon sens.
Mais à l’inverse, lorsque nos pensées ou émotions sont négatives, elles agissent dans le mauvais sens. Et l’on parle alors, le plus souvent de maladies psychosomatiques.
Qu’est-ce qu’une maladie psychosomatique
C’est la conséquence de ce que je viens d’évoquer. Par exemple, en cas de stress, d’angoisse, de mal-être induits par des pensées négatives, le corps réagit, et des maladies se déclarent. Contrairement à ce que certains pensent, les maladies psychosomatiques sont de véritables maladies.

Mais comment est-ce possible ?
En reprenant l’hypothèse que l’esprit siège dans le cerveau, cela s’explique facilement. Notre système nerveux est composé de dizaines de milliards de neurones. Et le système nerveux agit directement sur notre système endocrinien et notre système immunitaire.
Aussi, dès lors que nos émotions sont négatives, des phénomènes chimiques se déclenchent, ce qui crée un déséquilibre du système nerveux, ce qui entraîne un déséquilibre dans les autres systèmes qui sont censés nous protéger.
Si le système immunitaire ou le système endocrinien deviennent défaillants, eh bien on est malade, et pour de vrai !
Un exemple ?
Lorsque nous sommes stressés, des réactions en chaîne se déclenchent, et de véritables pathologies peuvent en découler :
- Troubles de la digestion : ballonnement, diarrhées, constipation, crampes abdominales
- Troubles de l’alimentation : anorexie-boulimie
- Hypertension et migraines
- Crises de panique
- Épuisement, neurasthénie, douleurs inexpliquées
De même, lorsque nous sommes de bonne humeur, les signaux sont inversés, et nous sommes moins sujets à tous ces maux, voire nous pouvons en guérir certains.
Certains vont même plus loin : chaque maladie a un sens
Dans le livre « Ton corps dit : Aime-toi ! » de Lise Bourbeau, une coach en développement personnel, une relation directe est établie entre nos émotions et vingt pathologies.
Que l’on y croie ou pas, Lise Bourbeau vous démontre que chaque maladie nous livre un message. Et pour elle, tout passe par un travail sur soi.
Un exemple, et en simplifiant énormément, pour l’auteur, le mal au dos peut traduire différentes choses :
- Lorsque l’on a mal dans le bas du dos, c’est que l’on se sent submergé par des contraintes et que l’on y répond par devoir, alors que l’on a plutôt envie de liberté.
- Lorsque l’on a mal au milieu du dos, c’est un signe d’insécurité matérielle.
- Et s’il s’agit du haut du dos, c’est une souffrance affective ou que l’on se sent surveillé.

D’ailleurs, on connaît toutes les expressions : en avoir plein le dos, avoir quelqu’un sur le dos
Bien sûr, ici je vous résume sa vision qui est largement argumentée dans son ouvrage.
Un petit résumé s’impose
De nos jours, la dualité entre le corps et l’esprit est révolue. Il est désormais reconnu que des interactions incessantes se produisent entre les deux, et dans les deux sens.
Notre esprit recueille nos émotions.
En fonction de ces émotions, notre cerveau déclenche des réactions en chaîne.
Selon notre « façon de faire face », notre fébrilité, notre état de fatigue, etc., notre corps réagit plus ou moins bien, souvent “moins” que “bien” d’ailleurs.

Les solutions
Si vous allez consulter un médecin, rares seront ceux qui vous diront de traiter la cause d’origine, et dans notre exemple précédent, de traiter la cause d’une difficulté à gérer le stress, par exemple. Si le stress engendre chez vous des maux d’estomac ou des ballonnements, le médecin vous enverra faire une fibroscopie, et vous prescrira trois ou quatre pilules différentes. Attention, je ne généralise pas, ni pour les médecins, ni pour les pathologies. Mais à titre personnel, j’ai plutôt rencontré des médecins qui se préoccupent plus des conséquences que de la cause. Sachant aussi que certaines maladies ne sont pas liées à notre état mental.
Cependant, dans de nombreux cas, des alternatives existent, alternatives qui tenteront de s’attaquer au problème de fond. Citons par exemple, l’hypnose, l’acupuncture, la méditation, la sophrologie dont j’ai fait mon métier.
Ainsi pour finir cet article, je vous parlerai de deux techniques, l’une que l’on peut pratiquer seule : la méditation, et l’autre pour laquelle vous êtes accompagné(e) : la sophrologie.
La méditation
Pour certains, le mot méditation fait sourire, et pourtant cette pratique millénaire fait désormais l’objet d’un consensus dans le corps médical. Lors d’un congrès, en avril 2012, réunissant 700 médecins, psychologies, neurologues, les effets positifs de la méditation ont été observés par IRM et par Scanner.
La méditation consiste à apprendre à vous détacher de vos préoccupations et à ne vous concentrer que sur le moment présent.
L’avantage, c’est que vous pouvez pratiquer la méditation seule, mais c’est aussi un inconvénient, car certains éprouvent le besoin d’échanger.
La sophrologie
Sophrologue de métier, je vous livre ici en quoi la sophrologie peut vous aider dans la gestion de vos émotions.
La sophrologie a pour but d’apprendre à gérer les tensions, le stress, les peurs afin d’harmoniser le corps et l’esprit.
C’est d’ailleurs la raison d’être de ce blog !
Avec la sophrologie, vous êtes guidé(e) par un professionnel qui sait adapter son travail à votre état. Si vous êtes intéressé(e), je vous invite à me contacter et à prendre un rendez-vous, ou à participer aux ateliers que j’organise.
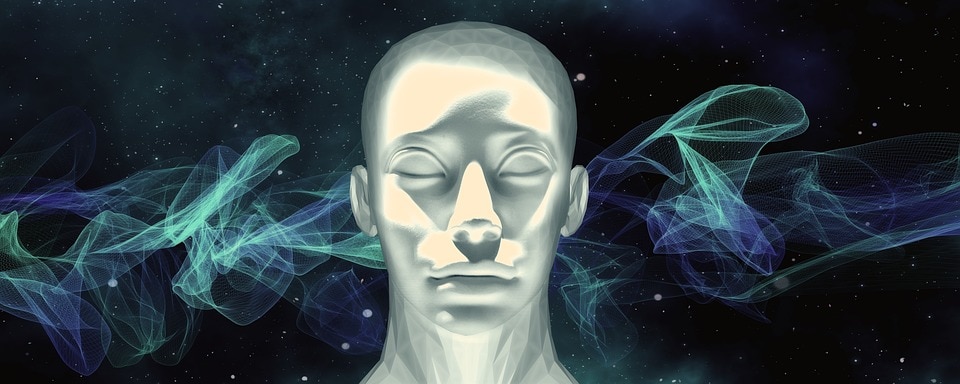
Conclusion
Si toutes les pathologies ne sont pas en lien direct avec nos pensées et nos émotions, une partie d’entre elles le sont, et c’est désormais admis et reconnu par le corps médical. Pour autant, les patients ne sont pas toujours orientés vers les « bons » traitements ou les « bons » praticiens. Ils sont soulagés de leur douleur « physique », mais ne le sont pas de leur douleur « mentale ». Les médecine douces peuvent donc être LA solution.
A Bientôt,
Charlotte Vallet
Sophrologue et Hypnothérapeute sur Paris et proche banlieue
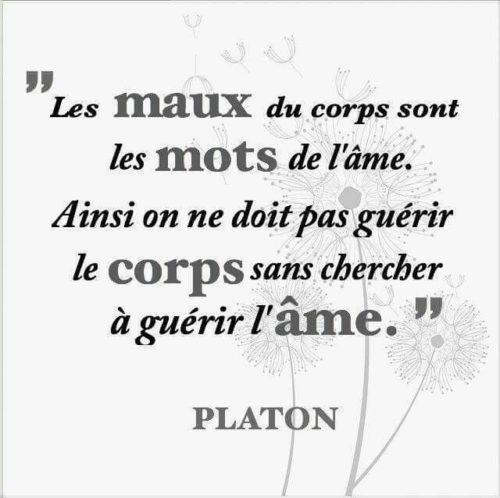
-

Le sommeil : cette arme qui peut se retourner contre nous
Il est deux heures du matin, et le 235 453e mouton vient de sauter la barrière… Il faut réagir.
Malheureusement vous n’êtes pas seul(e) à rencontrer des problèmes de sommeil. Même si ce n’est pas rassurant, sachez que d’après les statistiques, 30 % des Français se plaignent de leur sommeil tous les troubles confondus.
Et parmi les calvaires de la vie, ne pas dormir, quand on a envie de dormir, en est un dont on se passerait bien.D’aucuns diront que dormir une véritable perte de temps ! Pourtant, le manque de sommeil de façon répétée peut occasionner des troubles plus ou moins importants, et plus ou moins graves. En tout cas, ce qui est sûr, c’est que le manque de sommeil perturbe le quotidien et les relations sociales.
Alors pourquoi est-il important de bien dormir ? Que faire pour améliorer la qualité de son sommeil ?
À quoi sert le sommeil ?
Au XIXe siècle, des expériences ont été menées en privant des individus de sommeil pendant trois jours : les conclusions ne se sont pas fait attendre :
– Perte ou trouble de la mémoire
– Temps de réaction augmenté
– HallucinationDepuis, les expériences se sont largement poursuivies. Aujourd’hui, il est connu et reconnu que le sommeil joue un rôle déterminant dans la concentration, la mémorisation, l’apprentissage, le temps de réaction et le sens de l’orientation. Mais pas que…
Une mauvaise qualité de sommeil augmente les risques d’apparition de signes dépressifs, augmente la prise de poids, favorise l’hypertension, diminue le rôle de notre système immunitaire…
Sans compter la mauvaise humeur ! Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, quand j’ai mal dormi, je suis particulièrement grognon, et c’est peu de le dire…
Y-a-il des normes quant à la durée du sommeil ?
Nous ne sommes, une fois de plus, par tous égaux face à la durée de sommeil. Certains sont de petits dormeurs, d’autres des moyens, et d’autres encore de gros dormeurs.
Par ailleurs, le besoin de sommeil évolue avec l’âge. Un bébé peut dormir 17 heures, une personne âgée 7 heures. Avec 5 heures de sommeil, un adulte « petit dormeur » peut être comblé.
Mais, il existe tout de même une « moyenne ». Pour les adultes, il est préconisé de dormir entre 7 heures et 9 heures par nuit.
En fait, il n’y a pas de normes, et à chacun sa « dose ». Une bonne qualité du sommeil s’évalue à votre état au réveil. Si vous vous levez en chantant (rires) et en forme, c’est que vous avez suffisamment et bien dormi. Je sais… ce n’est pas si simple… mais c’est tout de même un très bon indicateur.
Mais pourquoi dormons-nous mal ?
Les causes
Les causes sont diverses, et plus ou moins graves. En général, elles sont classées en quatre catégories :
– Physiologiques (excès de substances énergisantes, alcool, repas trop copieux, médicaments…)
– Psychologiques (angoisse, anxiété, stress, choc traumatique…)
– Pathologiques (fièvre, maladie, maladie génétique…)
– Environnementales (chaleur, bruit, conjoint qui ronfle, lumière…)C’est pourquoi, lorsque nous voulons retrouver le sommeil, il faut trouver une solution en fonction de la cause.

Le cycle du sommeil
Il faut également savoir que nous ne dormons pas de façon continue. Le sommeil se divise en 4 à 6 cycles qui durent environ 90 minutes, et dans chacun des cycles, il y a trois périodes :
• Le sommeil léger (endormissement : autour de 20 minutes)
• Le sommeil profond (sommeil réparateur : entre 60 et 75 minutes)
• Le sommeil paradoxal (là où l’on rêve : entre 15 à 20 minutes)Selon la cause des troubles, le sommeil est affecté différemment dans l’un ou plusieurs de ses cycles. Le nombre de troubles étant important, je ne vais pas tous vous les lister. En revanche, je vous invite à lire des articles, tels que celui-ci : troubles du rythme circadien, rédigé par la Directrice du Centre d’étude et de traitement des rythmes circadiens humains à l’IUSM Douglas.
Ou alors, de vous diriger vers des sites de référence tels que celui de l’INVS (Institut National du Sommeil et de la Vigilance).

Les bonnes attitudes pour retrouver le sommeil
L’environnement : Le cadre, le bruit, la température, la lumière
Déjà, l’environnement est fondamental. Il faut aimer l’endroit où l’on dort. Un petit truc d’emblée : offrez-vous une housse de couette sympa, douce et que vous prenez plaisir à regarder.
Ensuite, dans un esprit plus classique, votre chambre doit être agréable, ventilée… Voici quelques conseils :
• Dites adieu au chauffage…
• Investissez dans des doubles rideaux opaques si vous n’avez pas de volets roulants.
• Achetez des boules quies, si besoin.
• Virez du lit tout ce qui n’est pas utile. Le conjoint qui ronfle, par exemple… (rires)
• Achetez des ampoules 25 watts, évitez les éclairages agressifs.
• Peignez les murs dans des couleurs apaisantes.
• Pensez aussi à votre literie (matelas et oreillers de bonne qualité)Adoptez un rituel
Essayez de vous contraindre (oui, je sais, ce n’est pas toujours facile) à vous coucher à peu près à la même heure. Fixez-vous une heure limite. Une heure avant cette heure limite, diminuez l’éclairage, mettez votre téléphone en mode avion. Puis, à l’heure dite, éteignez toutes les sources de lumière (même les appareils en vieille sont à éteindre).
Dans le même esprit, réservez votre lit à dormir et à l’amour. Bannissez toutes autres activités.Exposez-vous à la lumière du jour et obligez-vous à dormir dans le noir complet.
Le jour, exposez-vous le plus possible à la lumière solaire. Il faut faire comprendre à notre organisme la différence entre le jour et la nuit. Un peu de discipline, s’il vous plaît ! (rires). En revanche, obligez-vous à dormir dans la noirceur la plus totale. Et prévoyez de la lumière tamisée la nuit si vous devez vous lever.
Évitez les siestes
On préconise souvent de faire des siestes. Oh que oui, si vous ne souffrez pas de troubles de sommeil. En revanche, évitez-les si vous voulez vous endormir à une heure raisonnable.
Adoptez des habitudes alimentaires saines
Je ne vais pas m’éterniser sur ce point. Il est connu et reconnu que manger juste avant de dormir nuit au sommeil, et que les repas copieux sont fortement déconseillés. En plus, bonjour les kilos…
Limitez la consommation d’alcool (et de drogues)
En revanche, je vais parler de l’alcool, car c’est ce que l’on appelle « un faux ami ». Eh oui, en fait, on pense tous que l’alcool aide à dormir. Eh non ! l’alcool aide à s’endormir. Mais, le sommeil qui suit est de très mauvaise qualité. D’ailleurs, il n’est pas rare de faire des cauchemars quand on a abusé des Mojitos… Et si votre petit copain ou copine ronfle… je suis certaine que vous avez dû constater que l’alcool n’arrange pas les choses !!
Ne regardez jamais l’heure la nuit
En effet, lorsque l’on regarde l’heure la nuit, le cerveau se met au travail. Il compte le nombre d’heures qu’il nous reste à dormir. Et dans la majorité des cas, c’est une source de stress.
Avouez-le… Vous devez vous lever à 7 heures, vous vous réveillez à 6 heures moins le quart… L’horreur ! Déjà vous avez l’impression de ne pas avoir dormi, et vous vous dites, il ne me reste qu’une heure quinze à dormir… Insomnie garantie… Et ne parlons même pas de l’humeur…
Arrêtez de compter les moutons et faites l’amour
Franchement, comptez les moutons, ça ne sert à rien. Bien au contraire… Alors, voilà une astuce. Réveillez votre conjoint, et faites l’amour. Il est prouvé que c’est excellent pour la santé et pour le sommeil. Je vous invite d’ailleurs à lire mon article sur ce sujet.
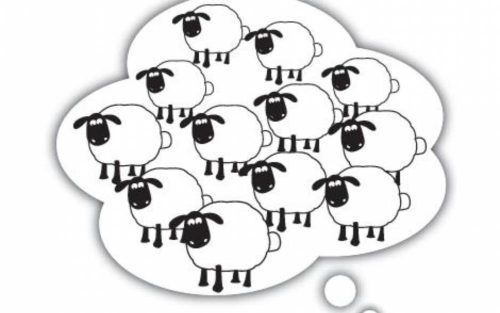
Mais n’abusez pas d’activités physiques
« Fais du sport, tu dormiras mieux… » Qui n’a pas entendu cela ? Eh bien, ce n’est pas si vrai. Si faire du sport de façon modérée est en effet recommandé, une activité trop intense nuit à la qualité du sommeil. Comme pour beaucoup de choses, il faut trouver la juste mesure.
La sophrologie et le sommeil
Ces petites astuces peuvent suffire à améliorer la qualité de votre sommeil. Mais parfois, les causes sont plus profondes, et tout ce que j’ai évoqué précédemment ne suffit pas. C’est pourquoi, je vous conseille d’essayer quelques séances de sophrologie. Il s’agit d’apprendre à faire des exercices de relaxation musculaire et mentale.
Selon les problèmes que vous rencontrez, et pour rejoindre au plus vite les bras de Morphée, le Dieu des songes, il existe une grande variante d’exercices pour :
– Pour se détendre
– Pour ralentir le rythme cardiaque
– Pour ne plus appréhender l’endormissement
– Pour faire le vide
– Pour dénouer les tensions
– Etc.Sophrologue, je peux vous accompagner dans votre démarche. Contactez-moi en MP, si vous le souhaitez.
Et si vos problèmes sont liés à une phobie du lundi, n’hésitez pas à lire mon article sur le lundi.

Conclusion
On ne le répétera jamais assez : le sommeil, c’est la santé (encore plus que le travail, rires). Notre corps se régénère, se répare, et fait le vide dans nos émotions.
Mais à raison de 8 heures de sommeil par nuit, à 40 ans, on a passé plus de 13 années de sa vie à dormir. Pour faire simple, on passe 1/3 de notre vie à dormir. Alors tant qu’à faire, essayons de rendre ces années utiles, en faisant de notre sommeil une arme réparatrice !
Bon après, si vous ne dormez pas, c’est peut-être que quelqu’un est amoureux de vous ! Une légende dit que « quand vous ne pouvez pas dormir, c’est que vous êtes éveillée dans le rêve de quelqu’un d’autre ». Je vous le souhaite !
À très bientôt !
Charlotte Vallet
Sophrologue et Hypnothérapeute à Paris et proche banlieue
-

Et si l’on parlait ego ?
Déjà sachez que le mot « ego » ne prend pas d’accent. Car comme l’a twitté Bernard Pivot, en 2018, « jamais d’accent sur le e de ego ! Ce serait un pléonasme puisqu’un ego ne cesse de mettre l’accent sur lui ».
Eh oui, nous associons tous le mot « ego » à égoïste ou égocentrique, en tout cas à quelque chose de péjoratif, surtout quand il s’agit des autres. Mais nous avons tous notre part d’ego…
C’est pourquoi j’ai souhaité faire un petit tour sur le sujet, et voir dans quelles mesures trop d’ego peut nuire non seulement à sa vie personnelle, professionnelle, sociale, mais aussi à celle des autres.
C’est parti…
Mais tout d’abord qu’est-ce que l’ego ?
Il existe plusieurs définitions selon que l’on se place d’un point de vue philosophique ou psychologique. Mais nous n’allons pas dans cet article, entrer dans des définitions complexes. Soyons concret.
Pour faire simple, on peut définir l’ego comme la représentation que l’on se fait de soi-même. L’image que l’on se renvoie. Le moi, plutôt le « moi je ».
Selon les individus, on pourrait dire qu’il y a 3 types de manifestation de l’ego :
- Ceux qui ont un ego « normal ». Ce qu’ils pensent d’eux-mêmes est en adéquation avec ce qu’ils sont.
- Ceux qui ont un ego « sous-dimensionné ». Ce sont des gens qui ont toujours tendance à se sous-estimer.
- Ceux qui ont un ego « surdimensionné ». À l’opposé des précédents, ils se surestiment.
Tout est donc une question de dosage. Et sur ce plan, nous sommes tous très différents, et c’est très souvent lié à notre histoire.
Si ceux qui ont un ego sous-dimensionné peuvent développer certains troubles dont je parlerai sûrement dans un prochain article, ceux qui ont un ego surdimensionné sont aussi à l’origine de troubles graves, qui ont parfois des conséquences graves, et pour eux et pour leur entourage.
Ego, égoïste, égocentrique, narcissique : De quoi parle-t-on ?
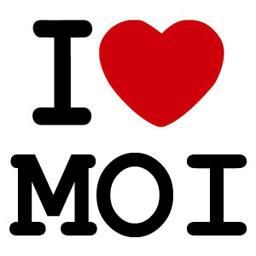
Bien sûr, il y a un lien entre ego, égoïste, égocentrique, puisqu’ils ont tous la même racine « ego » qui signifie « moi ».
On pourrait dire :
- Qu’un égoïste manipule les autres pour servir ses propres intérêts, sans pour autant se soucier de l’image qu’il renvoie aux autres.
- Qu’un égocentrique est égoïste qui est en plus centré sur lui-même et sur l’image qu’il renvoie aux autres.
- Qu’un narcissique relève de la pathologie. Il est à la fois égoïste et égocentrique avec, en plus, l’intention de nuire.
Nous sommes tous un peu égoïstes et égocentriques. Nous pourrions également débattre de l’individualisme qui est encore une notion qui s’en rapproche. Mais ce n’est pas le sujet.
Comment reconnaître un ego surdimensionné ?
On parle d’ego surdimensionné lorsqu’un individu a une haute image de lui-même. Mais attention, il peut s’agir aussi d’un jugement porté par quelqu’un sur quelqu’un. En effet, la personne concernée n’en a pas forcément conscience.
Mais quand elle en a conscience, elle se croit unique, indispensable.
Voici quelques signes pour les reconnaître. Ces personnes :
- Détestent avoir tort
- Cherchent sans cesse de la reconnaissance
- N’aiment pas l’imprévu
- Ont une vision limitée des choses
- Ne sont jamais responsables de rien
- Se trouvent toujours des excuses

Les psychologues attribuent souvent ces comportements à des blessures, à un manque de reconnaissance dans l’enfance. Ce qui fait, qu’arrivés à l’âge adulte, elles ont une soif d’exister à tout prix.
On cite souvent comme exemples, les chefs d’entreprise qui ont une soif de tout contrôler et de vouloir plus et toujours plus, ou les hommes politiques qui ont une ambition démesurée.
Mais si on critique souvent les personnes à l’ego développé, ce « défaut » est pour elles, porteur. Mais, encore une fois, tout est une question de mesure.
Car si l’ego peut être un ami, il peut aussi être un véritable ennemi.
Ego quand tu nous nuis…
Trop d’ego dans la vie professionnelle
Qui n’a pas rencontré Superman (ou Superwoman) dans sa vie professionnelle ? Il sait tout, il a tout fait, il ne parle que de lui, et en plus, c’est à lui que l’on doit tout.
Quoi de plus insupportable que de côtoyer au quotidien ce genre d’individus. En tout cas, le sort qu’il leur est réservé n’est pas des plus enviables. S’ils peuvent briller un temps, ils se retrouvent souvent isolés, et ils finissent souvent par être confrontés à plus forts qu’eux. Et la chute peut être terrible.
Au travail, mettre son ego de côté est fondamental lorsque l’on travaille en équipe. L’humilité paye souvent beaucoup plus.

Trop d’ego dans la vie personnelle
Comme au travail, vivre avec quelqu’un qui manifeste des signes d’égoïsme ou d’égocentrisme peut virer au calvaire surtout lorsque cela atteint le narcissisme. Et depuis quelques années, les articles sur les pervers narcissiques ne cessent de nous alerter sur les dangers de ce type de relations toxiques.
L’ayant moi-même vécu, je suis bien placée pour en parler. D’ailleurs, je vous invite à lire mes deux articles sur ce thème, Ici, le premier, là, le second. On dit souvent que l’amour est un don de soi… Ego et amour sont donc deux mots complètement antinomiques.
Si vous avez la malchance de rencontrer ou de vivre avec quelqu’un qui présente des signes d’égocentrisme… n’hésitez pas un seul instant. Prenez vos jambes à votre cou.
Trop d’ego dans la vie sociale
Dans la vie sociale, les réseaux sociaux n’ont pas arrangé les choses. Ils ont permis aux égocentriques non seulement de se dévoiler, mais de s’exprimer ouvertement. Qui n’a pas dans ses amis, celui ou celle qui publie (ce qu’il veut laisser paraître) pour chercher à se valoriser ou à chercher de l’admiration ?
Je suis là (sous un parasol alors que vous bossez), j’ai fait ça (un super exploit), je pense ça (quel con celui qui ne pense pas comme moi), je suis belle (regardez comme je suis mince), voici ma nouvelle moto (bien posée devant l’Audi)… Les exemples ne manquent pas.
je, je, je, ma, mon, moi…
L’objectif étant double : se prouver et prouver aux autres que « j’existe » et obtenir le plus de « j’aime » possible pour en mettre plein la vue aux copains.
Si, au début, on peut parfois porter un regard indifférent, à force, ça agace… et le mot est faible.
Mais, il n’y a pas que sur les réseaux sociaux. On a tous en tête ce pote, en soirée, qui sait tout, qui a tout fait, et qui rentre dans une colère monstre quand on le contredit.
Le résultat final est le même, à force, ces individus finissent par s’isoler socialement tant ils sont insupportables.
L’avantage de « soigner » son ego
Ce n’est pas si évident. Car comme dit plus haut, les individus ayant un ego surdimensionné n’en sont pas forcément conscients. Ce sont les autres qui le voient. Et lorsqu’ils en sont conscients, et compte tenu de leur personnalité, ils n’en voient pas les inconvénients.
C’est pourquoi dans cet article, je m’adresse plutôt aux personnes qui sont plus ou moins conscientes que leur ego leur nuit. En général, cela se traduit souvent par de l’orgueil. Bien sûr, ce n’est pas si simple, mais sachez que plus vous vous vexez facilement, plus votre ego vous domine.
Et je fais partie de ces personnes qui se vexent facilement. Et c’est un point que j’ai travaillé en Sophrologie, comme je vais vous l’expliquer dans le paragraphe suivant. Et depuis, je me sens mieux !

On retrouve son libre arbitre
Travailler sur son ego permet de se débarrasser des émotions négatives. On n’a pas sans cesse ce besoin de posséder, d’être reconnu… Car ses émotions créent beaucoup de frustrations quand les besoins ne sont pas assouvis. Moins on veut, moins on est déçu.
On s’apaise
Lorsque notre ego prend le dessus, on vit dans une pression permanente. On vit dans la compétition. Tout le monde est un rival. Un égocentrique n’est jamais satisfait, il lui faut toujours plus, toujours mieux, et on mène une véritable compétition avec soi-même et avec les autres.
La vie n’est pas un ring de boxe. En tout cas, pas toujours ! Et la considérer comme tel engendre un stress permanent et bon nombre d’angoisses.
On gagne en bienveillance, donc en respect des autres
Ce n’est pas en essayant de montrer aux autres que l’on est le plus fort que l’on gagne leur respect, bien au contraire. On attise surtout la jalousie. En diminuant son ego, en étant plus tourné vers les autres, on a des retours beaucoup plus sincères.
En quoi la sophrologie peut nous aider à mieux gérer notre ego ?
Si vous ne connaissez pas la sophrologie, je vous invite à vous renseigner et surtout à lire mon prochain article sur ce sujet. Pour ce qui concerne le sujet traité aujourd’hui, la sophrologie peut aider à :
- À regarder les autres de façon différente
- À enclencher un processus inverse
- À apprécier le quotidien, la vie
- À voir le bien plutôt que le mal
- Bref, à lâcher prise et à retrouver une véritable estime de soi.
Si vous me suivez, vous savez que je suis sophrologue et que je peux soit vous aider, soit aider quelqu’un de votre entourage qui est concerné. N’hésitez pas à me contacter en MP.
Conclusion
L’ego peut donc se résumer à l’amour que nous nous portons et qui, quelque part, nous rassure. S’il est fondamental de se porter de l’amour et de se regarder avec bienveillance, il est également fondamental de ne pas se surestimer, ni se sous-estimer.
L’ego peut être porteur mais trop d’ego peut être destructeur. C’est souvent la conséquence d’un mal-être très profond qui nécessite d’être pris en considération.
N’hésitez pas à en parler pour vous libérer !
À très bientôt !
Charlotte Vallet
Sophrologue et Hypnothérapeute à Paris et proche banlieue
-

Voilà pourquoi faire l’amour est essentiel !
Aujourd’hui, je voulais aborder un thème un peu “chaud”, comme on dit !
En effet, même si peu à peu, les langues se délient, parler de sexe est toujours un peu tabou. Depuis le film « Cinquante Nuances de Grey », et grâce à Christian Grey, le sexe et les pratiques sexuelles se sont un peu démocratisées. Mais ce n’est pas encore un sujet que l’on ose aborder, même avec ses amis.
Pourtant, l’industrie de la pornographie est l’une des plus rentables au monde.
Quel paradoxe !!
Bien sûr, il ne faut pas confondre pornographie et faire l’amour. Mais je ne suis pas là pour débattre de cela, chacun est libre de faire ce qu’il veut de son corps.
Pour ma part, je souhaite juste aborder les bienfaits que peuvent procurer les relations sexuelles. Et plus particulièrement lorsque l’on a la chance d’avoir un amoureux !
En effet, lorsque l’on fait l’amour, notre corps libère tout un tas de substances qui nous procurent une sensation d’euphorie, puis de bien-être.
Mais, malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux face à cet acte qui symbolise l’amour. Ce n’est parfois pas évident pour certaines d’entre nous de se lâcher… Et c’est bien dommage ! C’est pourquoi, je terminerai cet article en vous expliquant en quoi la sophrologie peut aider à se sentir mieux notamment dans le domaine des relations sexuelles.

Les bienfaits de faire l’amour
C’est le ciment d’un couple
Aimer et être aimée sont bien sûr le ciment d’un couple. Mais faire l’amour, c’est l’incontournable, c’est faire durer l’amour.
En effet, la complicité, la confiance, la tendresse sont des ingrédients indispensables à la vie de couple et à l’amour. Mais ce sont aussi les ingrédients d’une amitié.
Et ce qui distingue l’amitié de l’amour, c’est le désir physique, l’attirance sexuelle.
Et ne tournons pas autour du pot… Il n’y a pas de secrets. Quand le désir s’estompe, les problèmes commencent. En tout cas pour une majorité de couples. C’est souvent la raison essentielle qui conduit à l’infidélité, qui est aujourd’hui responsable de 35 % des divorces…
Il est donc fondamental d’entretenir le désir. C’est facile à dire, je sais. Car la routine s’installe progressivement et le plus souvent inévitablement. Et avant, à l’époque de nos grands-parents, on n’en parlait pas, et on n’osait pas. Aujourd’hui, on en parle beaucoup plus, on en prend conscience, on sait que la routine est un danger, un tue-l’amour. Et sur le Net, on lit de plus en plus d’articles sur ce sujet. Notamment sur les « nouvelles » façons de pimenter sa vie de couple (sextos, sextoys, assouvir des fantasmes, amour libre…)… Ou alors sur les « nouvelles » façons « d’aimer »…
Faire l’amour est donc une condition sine qua none de garder son partenaire et d’entretenir l’amour. Mais pas que…
Faire l’amour est un véritable médicament
Tout d’abord, sachez que faire l’amour est un véritable anti-stress. Si vous ne connaissez pas le cortisol, sachez que c’est l’hormone responsable du stress. Eh bien, il a été montré que faire l’amour (plusieurs fois par semaine) diminue de manière drastique la sécrétion de cette vilaine hormone. Vous êtes stressée ? Vous savez ce qu’il vous reste à faire !
De plus faire l’amour augmente la production d’immunoglobulines A. Ces molécules renforcent le système immunitaire, qui est notre système de défense. Beaucoup de chercheurs défendent l’idée qu’une vie sexuelle active réduit les risques de maladie cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et même les risques de cancer.
Migraine ? Blablabla…
Lorsque l’on fait l’amour, le corps fabrique également des endorphines. Grâce aux endorphines qui sont libérées, faire l’amour peut diminuer et soulager les maux de tête et les migraines. Et ce n’est pas moi qui le dis ! Ce sont des neurologies de l’université de Münster, en Allemagne, qui l’ont démontré.
Alors attention, mesdemoiselles et mesdames, si votre partenaire lit cet article, et que vous simulez une migraine pour éviter de faire l’amour, vous risquez d’être prise à votre propre jeu. Là, vous n’aurez plus aucune excuse.
Faire l’amour améliore la qualité du sommeil
Dans le même esprit, faire l’amour libère également des hormones et parmi elles, il y a 5 hormones « somnifères » :
- La prolactine (sensation de bien-être)
- L’endorphine (effet relaxant)
- La dopamine (sensation de bien-être)
- La mélatonine (effet somnifère)
- L’ocytocine (effet anti-stress)
Ces hormones nous aident à trouver un sommeil profond et réparateur. C’est pourquoi, il est plutôt conseillé de faire l’amour avant de dormir.
Et il est vrai, qu’après un rapport sexuel qui s’est bien passé, on se laisse aller, on est profondément détendue et relaxée. On ne pense à rien. Ce que nous prépare à mieux dormir. Et c’est connu : « qui se sent bien, dors bien ». Alors, faire l’amour, c’est dire adieu aux insomnies !

En plus… On perd des calories…
En effet, faire l’amour, c’est un sport ! En tout cas, je l’espère pour vous (rires). Et c’est tout de même plus agréable de faire l’amour que de faire 20 km, seule, sur un vélo d’appartement. Enfin à chacun sa façon de voir les choses… Sachez qu’une demi-heure de galipettes (tout dépend des galipettes, bien sûr), vous perdez autour de 100 calories, et de façon agréable. Si vous voulez en perdre plus… Il n’en tient qu’à vous…
Et plus on fait l’amour, plus on a envie de le faire
Eh oui ! Faire l’amour augmente la libido. En effet, si l’on a une vie sexuelle épanouie, le corps s’habitue, et cela engendre des réactions physiques. La circulation sanguine dans les parties vaginales s’améliore, l’élasticité des muscles aussi, la lubrification vaginale est favorisée… Et tous ces phénomènes font que le corps en redemande ! Plus on fait l’amour, plus on a envie de le faire. Il y a pire comme situation…

On prend (ou reprend) confiance en soi
C’est pour ma part, une raison essentielle de faire l’amour. En effet, si l’on a la chance d’avoir un partenaire amoureux, en qui l’on a confiance, c’est plutôt très très très agréable de se sentir désirée, complimentée et aimée. Quoi de plus valorisant et de plus euphorisant que de constater que l’on plaît à quelqu’un, que notre corps lui fait de l’effet ? On en oublie ses complexes et ses imperfections. On apprend à accepter son corps, et on se regarde avec plus de bienveillance. C’est comme une potion magique de se sentir en confiance.
De plus, pour ma part, c’est aussi un moyen de l’entretenir. C’est une belle motivation pour rester séduisante. C’est en tout cas essentiel pour l’estime de soi.
Mais, en revanche, pour certaines, le manque de confiance peut être un véritable frein aux relations sexuelles. Dans ce domaine, le problème de la confiance en soi est donc, soit un cercle vertueux (on a confiance en soi, on fait l’amour), soit un cercle vicieux (on n’a pas confiance en soi, on appréhende le sexe).
C’est pourquoi, je voulais finir cet article en m’adressant à celles qui sont plutôt dans le cercle vicieux…

Que faire si vous ne vous sentez pas à l’aise ?
Un certain nombre de femmes peuvent ne pas se sentir à l’aise lorsqu’il s’agit de relations sexuelles, même avec un conjoint qu’elles aiment et qui les aiment. Selon une enquête, 55 % de Françaises reconnaissent connaître, ou avoir connu des difficultés sexuelles. Et on lit souvent ce chiffre sur le Net : 8 % des femmes déclarent n’avoir jamais eu d’orgasme dans leur vie…
Les raisons sont multiples, traumatisme lié à l’enfance, traumatisme lié à un partenaire inconvenant, complexes, peurs, angoisses… Et plutôt que de trouver du plaisir et de l’épanouissement, les relations sexuelles sont source de stress, voire d’angoisse. Pour certaines, une véritable contrainte, même un calvaire car douloureux…
Alors si vous en faites partie, la sophrologie peut peut-être vous aider.
En effet, la sophrologie permet, entre autres, de vaincre certaines peurs. Parmi les blocages d’ordre sexuel, on trouve certaines causes (pathologies, psychoses, mésententes profondes), et ces causes ne peuvent pas être résolues grâce à la sophrologie.
Mais dans de nombreux cas fonctionnels ou psychologiques, la sophrologie peut aider à :
- Revaloriser l’image de soi
- Surmonter des expériences traumatisantes
- Réactiver le désir
D’ailleurs, la sophrologie est de plus en plus recommandée par les médecins, les sexologues et les psychologues.
Sophrologue, je peux vous accompagner si vous le souhaitez. N’hésitez pas à me contacter en MP.
Conclusion
Il n’y a pas de mal à se faire du bien ! Le langage corporel est une véritable façon de communiquer. Et compte tenu de tous les bienfaits que faire l’amour procure, c’est un excellent moyen de garder le moral, et surtout de garder son partenaire. Tous les hommes aiment les femmes qui ont une sexualité épanouie, et surtout qui sont libérées de leurs complexes. Alors, lâchez-vous. Et si vous n’y parvenez pas, et que cela vous soucie, n’hésitez pas à en parler ! Il y a toujours des solutions à tout.
À très bientôt !
Charlotte Vallet
Sophrologue et Hypnothérapeute à Paris et proche banlieue

-

Et toi, qu’est-ce qui te donne le SMILE ?
Aujourd’hui, nous sommes lundi. Et le lundi est, pour un grand nombre d’entre nous, un jour morose.
Alors, pour bien commencer la semaine, je me suis demandé, ce week-end, ce qui me procurait de la joie au quotidien. J’ai fini par dialoguer avec moi-même pour y répondre.
C’est une question que l’on se ne pose pas souvent. On préfère plutôt se demander si l’on est heureux ou malheureux. Sachant que la quête du bonheur n’est pas toujours une fin en soi.
Par ailleurs, nous avons la fâcheuse tendance à penser que nous ne somme pas heureux. Notre cerveau a plutôt tendance à nous rappeler les moments difficiles plutôt que les moments positifs.
Et c’est prouvé ! Écoutez autour de vous, et comptez le nombre de fois où vous entendez « je suis fatigué ; j’ai froid ; je ne sais pas comment je vais faire pour faire telle ou telle chose ; cette personne m’énerve ; je me sens mal ; mon appartement est en bazar; je me sens trahie ; elle ne m’aime pas … ».
Il est acquis que nous (les êtres humains), nous nous complaisons dans la plainte. Elle anime nos journées.
Cela dit, elle nous épuise tout autant !
Et si nous regardions les choses différemment ? Et si plutôt que regarder ce qui ne va pas, nous regardions ce qui va bien ? Faire un bilan de ce qui est positif dans sa vie peut aider à s’apercevoir que, finalement, la vie est belle !
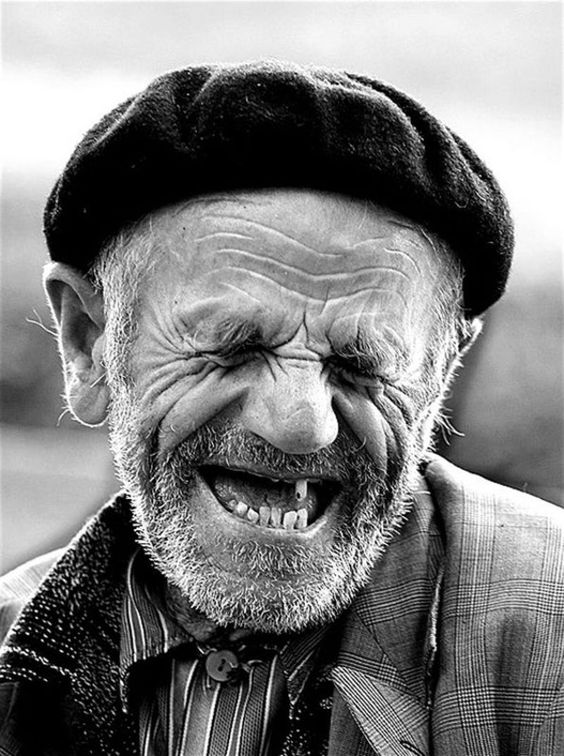
Mon expérience
Si je me réfère à mon année 2018, voici les moments qui m’ont procuré de la satisfaction :
- Janvier – J’ai emménagé dans mon nouvel appartement, après une rupture difficile. Le décorer m’a procuré un plaisir intense.
- Février – Il a neigé à Paris. La neige a tenu plusieurs jours, ce qui est plutôt rare, ici. Il faisait très froid et les voitures avaient du mal à circuler, mais que c’était beau !
- Mars – J’ai fini le semi-marathon avec une de mes amies sans m’être trop entraînée. L’ambiance était si chaleureuse ! Des musiciens, des chanteurs, des fans… Vous vous sentez tout puissant.
- Avril – Je suis retournée en Afrique, pour la première fois après y avoir vécu, ce qui m’a fait redécouvrir l’univers magique de ce continent. Les odeurs de poulets braisés dans les rues, l’attieké, l’alloco, la gentillesse des africains, et le mantra “tout est possible” qui vous habite à nouveau.
- Mai – J’ai débuté une formation “Switch Collective”, ce qui m’a permis de me reconvertir dans la joie et l’apaisement.
- Juin – J’ai commencé ce blog qui est devenu ma vitrine, mais surtout mon outil de communication. C’est aussi mon “bébé”, et j’en suis assez fière.
- Juillet – On a gagné la coupe du monde, et l’ambiance a été à son apogée durant plus d’un mois. Les Français étaient proches et soudés.
- Août – J’ai découvert les joies de la Bretagne. Je n’ai pas pour habitude de découvrir les régions françaises, préférant partir à l’étranger dès que je le peux. Et pourtant, cette fois, j’ai adoré. Les paysages sont magnifiques, sauvages et différents du reste des régions. Tout ce que j’aime.
- Septembre – J’ai retrouvé ma ville (qui est selon moi la plus belle), après plusieurs mois sur d’autres territoires. Prendre conscience de la beauté de cette architecture hors du commun, de la diversité culturelle, c’est magique.
- Octobre – J’ai profité de l’été indien. Été qui habituellement se termine en septembre, mais là, l’été s’est prolongé, et j’ai pu profiter du soleil en cette période souvent triste.
- Novembre – J’ai commencé l’organisation de mon voyage au Népal, et ce, pour la deuxième fois. Ce qui me fait sourire, ce sont tous les préparatifs purement logistiques.
- Décembre – J’adore les fêtes de Noel et la chaleur de mon entourage à cette période.
Essayez de faire de même. Obligez-vous à faire un bilan mensuel ou hebdomadaire de ce qui s’est bien passé, et de ce qui vous a procuré du plaisir.
Vous constaterez que, finalement, le verre est plutôt à moitié plein qu’à moitié vide !

Comment (re)trouver le sourire ?
Finalement, avoir le sourire ou non, c’est assez subjectif. Et nous sommes tous différents face à cela. Certains auront “moins” que vous (sur le papier), mais ils se contentent de peu ou en attendent moins… Ils parviennent à apprécier des petits plaisirs au quotidien.
Il y a tant de petites choses qui procurent des petits plaisirs :
- Le sourire d’un inconnu dans le métro
- Un rayon de soleil, un ciel bleu
- La blague d’un collègue quand on arrive au travail le matin
- Le rire des enfants dans la rue
- Le chocolat viennois pris au Starbucks du coin
- Un compliment de sa belle soeur
- La fin d’une séance de sport avec une amie
- Marcher au bord de la mer
- Rentrer dans le jean que l’on portait, il y a 10 ans
- Croiser des amoureux dans la rue
- La bienveillance
- Boire une bière avec quelqu’un que vous appréciez
- Réserver des vacances
- Gagner un pari
- Marcher des heures dans les rues avec de la musique
- Recevoir une bonne nouvelle dans sa boite mail
- Se préparer avant un diner ou une sortie
- Apprécier un bon repas, que l’on aura cuisiné

Le pouvoir du moment présent
Alors, si vous aussi, vous avez envie de profiter de la vie, je vous conseille fortement la lecture de ce livre : “Le pouvoir du moment présent” d’Eckart Toll. Il est incontournable. Vous y trouverez des solutions pour trouver une paix intérieure et pour apprendre à vous épanouir.
“Au coeur de cet enseignement se trouve la transformation de la conscience : en vivant dans l’instant présent, nous transcendons notre ego et accédons à ” un état de grâce, de légèreté et de bien-être “. Ce livre a le pouvoir de métamorphoser votre vie par une expérience unique.”
En effet, nous vivons constamment dans le passé ou dans le futur, mais rarement au présent. Et comme l’avenir nous fait peur, nous avons tendance à anticiper toutes les situations de façon à éviter l’échec.
Alors, oui, préparer l’avenir est important. Mais il ne faut pas se laisser submerger par cette anticipation. Le hic, c’est que la peur n’évite pas le danger, et l’anticipation n’évite pas l’échec. Il est impossible de tout contrôler, car de nombreuses situations ne dépendent pas de nous.
Le passé, quant à lui, est essentiel car il a fait de nous ce que nous sommes. En l’occurence, il faut l’accepter. On ne le change pas… Il faut juste en tirer les leçons.
Aussi, pour être un plus apaisé(e), il est fondamental de vivre le moment présent en pleine conscience.
La sophrologie est un outil de choix pour apprendre à vivre dans le moment présent et apprendre à se relaxer.
Si vous souhaitez plus d’informations sur cette méthode, je suis à votre disposition pour en discuter par message privé.

Charlotte VALLET
Sophrologue et Hypnothérapeute à Paris et proche banlieue
charlottevallet@hotmail.com
-

La fiabilité, le pilier de l’amitié
La fiabilité, c’est la capacité à faire preuve de constance et de régularité. Mais avant toute chose, c’est tenir ses engagements. Que ce soit envers un collègue, un membre de sa famille ou un ami.
Aujourd’hui, c’est surtout dans le cadre de l’amitié que je souhaite vous en parler. Car j’ai pris énormément de recul, ces dernières années concernant ce sujet. Et maintenant que je suis en accord avec moi-même sur ce point, j’ai eu envie de partager avec vous mon expérience et de vous donner quelques petits conseils.
Lorsque l’on vieillit, notre groupe d’amis se resserre pour laisser place à un cercle d’amis très restreint. On lit souvent que nous avons au maximum 5 vrais amis sur lesquels compter. C’est tout à fait vrai. Et si vous en comptez 5 autour de vous, c’est déjà un grand nombre, soyez-en fiers !

La fiabilité, c’est quoi ?
Vous pouvez considérer qu’une personne est fiable à partir du moment où elle est là pour vous, et que vous pouvez lui faire confiance sur tous les points. Une confiance aveugle !
Bien plus qu’une présence, l’amitié se concrétise par des actes. Un ami est un pilier dans votre vie, grâce notamment à :
- Son écoute
- Ses conseils
- Ses attentions
- Son affection
- Les moments de qualité passés ensemble
- Sa constance
Le seul hic, c’est qu’aujourd’hui l’individualisme a tendance parfois à primer, et que chacun pense à soi avant de penser à autrui. Penser à soi en priorité, c’est normal, car nous sommes aussi notre meilleur ami, mais oublier de respecter l’autre, n’est pas excusable.
Et, le manque de fiabilité peut être considéré comme un réel manque de respect.

Mon expérience
Pour ma part, je fais partie des personnes très sociables, mais aussi très solitaires. Je compte mes amis sur les doigts de la main, et ce, depuis bien longtemps.
Plus jeune, j’ai cumulé les déceptions relationnelles, et je me suis vite faite à l’idée qu’il fallait compter principalement sur soi.
J’ai très longtemps fait confiance et je me suis fortement attachée à des personnes qui n’étaient pas sur la même longueur d’ondes que moi.
Ce qui, en soi, n’est pas très important car, comme le disait si bien Thimoté Gustave “il faut cultiver l’indifférence et non la différence”. En l’occurrence, j’ai longtemps côtoyé des personnes peu fiables, sans m’en rendre vraiment compte. Je n’attendais pas grand choses des autres, ni de moi-même, d’ailleurs.
Résultat des courses : je pardonnais TOUT.
Voici quelques exemples de situations que j’acceptais, et que je n’accepterai plus jamais, depuis que je me respecte :
- J’avais rendez-vous à 13 heures au restaurant. J’y étais à 12h50. La personne arrivait à 14heures sans la moindre excuse : je m’énervais (j’ai mauvais caractère), mais je pardonnais.
- Quelqu’un me proposait de me rendre un service et, finalement ne respectait pas son engagement sans même me prévenir. Ce qui avait parfois d’énormes répercussions sur ma vie personnelle ou professionnelle car je comptais sur elle : je m’énervais, mais je pardonnais.
- Une invitation à mon anniversaire (on ne fête son anniversaire qu’une fois dans l’année), la personne me promettait de venir, et étonnement, je n’avais aucune nouvelle d’elle le jour J. D’autres priorités peut-être… ?
- Des demandes restant sans réponses. Je sollicitais des amis pour obtenir des informations cruciales pour moi, à cette époque. Aucune réponse. Puis quelques jours après, je recevais un ” ça va ?”
J’ai fini par perdre beaucoup de mon énergie et de ma patience. Et là, je me suis imposée à dire NON et à ne plus accepter ce genre d’attitude !
J’ai pris conscience que ces attitudes étaient incompatibles avec l’amitié ! Surtout lorsque vous, vous vous efforcez à être irréprochable.
Est-ce de l’égoïsme de la part de l’autre? Un manque de confiance ? Une certaine forme d’autisme ? Mais, j’ai appris que tant que la personne n’est pas bien avec elle-même, elle ne sera jamais fiable avec vous. Sachez-le.

Mes conseils pour devenir fiable
Je dis ce que je fais, et je le fais
- On ne s’engage à faire uniquement ce qui est faisable
Evidemment, il n’est pas toujours évident de s’engager à faire un foot avec ses amis si vous êtes dans une période de votre vie ou votre santé vous joue des tours. Dans ce cas, il n’y a aucun intérêt à vous engager face à cette proposition que vous ne tiendrez jamais. Vous perdrez votre temps, et vos amis perdront leur énergie.
- Je dis NON sans culpabiliser
Si vous ne voulez pas faire quelque chose, ne vous obligez pas à le faire pour faire plaisir à autrui. Ce n’est pas égoïste de dire NON, en l’occurence ce serait même lâche envers vous-même, et envers l’autre, de vous engager dans une action que vous ne souhaitez pas réaliser. Faites preuve de fermeté, écoutez vos envies les plus fortes, pas celles des autres.
- Prévenir en cas d’annulation
Il nous arrive à tous de nous engager auprès d’un ami pour lui rendre un service, et finalement nous ne pouvons pas y répondre. Ce n’est pas dramatique, ce sont des choses qui arrivent. Mais, en revanche, pensez-bien à le prévenir suffisamment à l’avance et à vous excuser.

Je revois mes habitudes
- Je réponds rapidement aux messages que je reçois
Une technique qui fonctionne bien pour montrer que vous êtes une personne régulière et présente, est de répondre rapidement à un message ou à un appel téléphonique. Si vous rappelez votre interlocuteur une semaine plus tard, votre ami aura eu le temps d’oublier votre existence durant ce laps de temps.
- Je décide d’arriver à l’heure
La ponctualité est importante pour avoir confiance en son ami. Essayez de partir un peu plus tôt qu’à votre habitude, afin d’arriver dans les temps.
- S’excuser en cas d’erreur dans la relation
Il est possible de faire un impair sans s’en rendre compte. Mais une fois que votre ami vous en a fait part, n’oubliez pas de mettre votre ego de côté et de vous excuser.
- Faire toujours de son mieux
Si vous décidez de rendre un service (monter un meuble, l’initier au sport, lui faire un massage, l’aider sur la création d’un dossier de presse…), faites de votre mieux pour lui montrer que son projet vous tient à coeur.

Je deviens une personne de confiance
- Atteignez vos objectifs
Finalement, avant d’essayer d’avoir une attitude irréprochable envers les autres, il faut en avoir une envers soi-même. Par exemple, si vous décidez d’aller à la salle de sport 3 fois par semaine à compter du mois de février : faites-le ! Ou diminuez vos objectifs.
Si vous ne savez pas vous fixer des objectifs et que vous ne parvenez pas à y répondre, vous n’arriverez pas à vous comporter de façon correcte avec vos proches.
- Dites toujours la vérité
Même si la vérité est difficile à entendre, c’est aussi grâce à elle que vous réussirez à faire avancer vos proches et que vos proches vous feront avancer par la même occasion.
Vous vous faites du soucis pour une amie qui se laisse aller ? Dites-le lui de façon constructive, mais avec fermeté. Les personnes le plus dures avec vous sont aussi celles qui vous montrent le plus d’intérêt. Qui aime bien, châtie bien !
- Construisez des relation solides
Un peu comme pour le mariage, l’amitié c’est “pour le meilleur et pour le pire”. Soyez là pour vos amis en cas de pépins, de détresse, de tristesse. Apprenez à écouter sans même donner des conseils. Soyez une épaule essentielle.
À très bientôt !
Charlotte Vallet
Sophrologue et Hypnothérapeute à Paris et proche banlieue
-
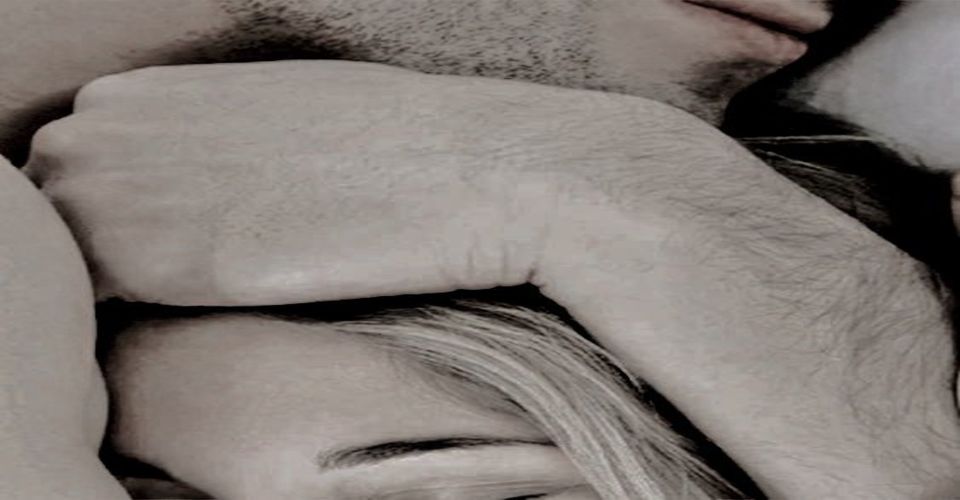
Dites au revoir aux manipulateurs
La vie à deux n’est pas toujours simple, mais elle se transforme en un véritable enfer lorsque l’on rencontre un pervers narcissique. Alors, oui, on en parle beaucoup de ces fameux pervers narcissiques, et parfois on fait des amalgames. Mais amalgame ou pas, mieux vaut en parler trop que pas assez, car les conséquences de ces relations toxiques ne sont pas anodines. La personne, qui en est victime, peut être détruite, et met en général beaucoup de temps à se reconstruire et à refaire confiance aux hommes.
Je dis « aux hommes », mais il existe bien évidemment des femmes qui manifestent aussi ce genre de comportement. Et ces relations nocives n’affectent pas que les relations amoureuses. Elles sont de plus en plus dénoncées dans les relations professionnelles, par exemple (hiérarchie abusive). On les trouve également au niveau familial (relations parents/enfants).
Dans cet article, nous n’aborderons que les relations amoureuses et les hommes, mais il était important de le souligner.
Le problème majeur de la relation toxique, c’est que lorsque l’on en prend véritablement conscience, les dégâts sont déjà considérables. C’est pourquoi il est essentiel d’en prendre conscience le plus tôt possible. Si cela semble évident, la plupart des femmes qui en vivent une n’en sont pas conscientes. Ou alors plutôt, elles le sont, mais elles sont dans le déni.
Alors comment être sûre que l’on est dans une relation toxique ? Et comme s’en libérer ?
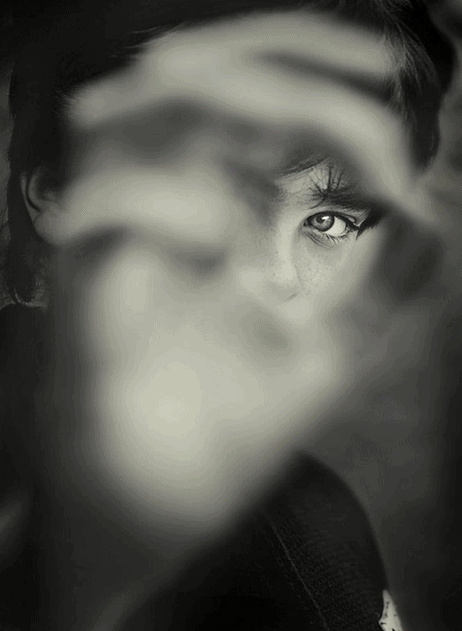
Qu’est-ce qu’une relation toxique ?
Une relation toxique est une relation dans laquelle on est manipulée, dans laquelle on reste même si l’on sait que l’on y est malheureuse. Une relation nocive nous tire vers le bas. Elle nous épuise. La relation toxique est le plus souvent passionnelle dans le sens où elle passe par sentiments et des comportements extrêmes.
Essayons d’établir les profils des protagonistes.
Le portrait du pervers narcissique
Le pervers narcissique a deux visages. Un côté charmeur très développé, c’est un excellent séducteur. Il est en général brillant. Aux yeux des autres, il est presque un modèle de perfection. Mais dans l’intimité, il se révèle tout autre. Pas au début… mais assez rapidement. Voici sa deuxième face.
- Le pervers narcissique est égoïste et égocentrique. Il fait passer son propre intérêt avant le vôtre, et tout doit tourner autour de sa personne. Il ne supporte pas que vous ayez une vie en dehors d’une vie centrée sur lui.
- Le pervers narcissique est autoritaire. Ils vous imposent (de façon souvent détournée) ce que vous devez faire. Et il a toujours réponse à tout.
- Le pervers narcissique est manipulateur et est un flatteur. Lorsqu’il s’aperçoit qu’il est allé trop loin, il se confond d’excuses, vous comble de cadeaux, etc. Il a l’art et la manière de se faire passer pour une victime. C’est un excellent comédien. Il répond souvent de façon floue.
- Le pervers narcissique est un destructeur. Il parvient peu à peu à vous convaincre que tout ce que vous faites est nul ou pourrait être mieux fait. Il vous met en difficulté, vous dévalorise, vous fait perdre toute votre confiance en vous.
- Le pervers narcissique est systématiquement dans la critique. Il est intolérant envers les autres, quels qu’ils soient. Mais il l’exprime de façon très sournoise.
En général, ces comportements sont attribués à une enfance difficile qui a engendré des adultes qui souffrent :
- D’un important complexe d’infériorité
- D’un sentiment de vulnérabilité
- D’un sentiment de frustration et de perpétuelle insatisfaction
Ils ont une haine violente qui les ronge de l’intérieur, et qui les conduit à adopter les comportements décrits plus haut pour se sentir exister. Ils ont besoin d’humilier l’autre pour se sentir valorisé.

Le portrait de sa victime
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les victimes ne sont pas forcément des femmes influençables. Ce sont en général des femmes plutôt fortes, joyeuses, intelligentes, tournées vers les autres et qui sont dans l’empathie. Elles n’ont qu’une faiblesse, si l’on peut dire, elles manquent de confiance en elles. Elles ont un besoin exacerbé de reconnaissance et se positionnent souvent comme des « sauveuses ». C’est aussi presque un défi pour elles de se faire aimer. Quand elles aiment, elles ne sont pas dans la demi-mesure.
Je vous conseille d’ailleurs la lecture de mon témoignage (https://www.charlottevallet.fr/se-liberer-dune-relation-amoureuse-nocive/)

Comment s’en libérer ?
Disons-le d’emblée. C’est extrêmement difficile de se sortir de ce cercle infernal. Car, comme dit dans l’introduction, lorsque l’on prend enfin conscience que la relation est toxique, il y a déjà eu beaucoup de dégâts. Car le pervers narcissique a su créer une relation que l’on peut nommer de relation « addictive ». Et comme pour un drogué, la période de sevrage est difficile.
Prendre conscience de la situation et ne plus être dans le déni
C’est simple à dire, mais loin d’être facile.
Le pervers narcissique est si doué qu’il réussit toujours à retourner la situation à son avantage. C’est un véritable cercle infernal. Le manipulateur parvient toujours à se rendre indispensable, à faire croire à sa partenaire, qu’elle ne peut pas vivre sans lui.
Les relations sont, en général, passionnelles, et ils jouent sur le côté amour fou. Un peu comme les hommes qui battent leurs femmes, et qui se « rattrapent » le jour d’après, en pleurant, en s’excusant, et faisant des cadeaux… Et en jurant que c’est la dernière fois…
Ce n’est pas que les femmes n’en ont pas conscience… Mais deux phénomènes s’entrecroisent :
- Leur côté Mère Teresa qui leur fait croire qu’elles vont pouvoir changer les choses, et surtout changer leur partenaire.
- La phase de déni. En effet, s’avouer que l’on vit dans une relation toxique, c’est quelque part, s’avouer que l’on s’est trompée, que l’on a permis que l’on nous trompe, que l’on a accepté l’inacceptable… Et ce n’est pas si simple.
Il faut donc admettre que l’on ne pourra jamais changer ce personnage. Ce type de comportement relève de la psychiatrie. Et même les psychiatres n’y parviennent pas. C’est une maladie, et il faut le prendre comme tel.
Puis, il faut accepter cet échec. Ou plutôt l’assumer. Se poser les bonnes questions. Se demander pourquoi on a été attirée par ce genre de personnage ? Car si on ne trouve pas les réponses, les chances de reproduire la même chose sont malheureusement très élevées.
Se comporter différemment entre le moment de l’acceptation et le départ
Une fois que l’on est conscient, et dans la période intermédiaire, car les séparations ne se font pas toujours du jour au lendemain, il faut impérativement changer de comportement.
Réapprendre à dire NON, réapprendre à utiliser JE plutôt que TU, et surtout commencer à appliquer des règles et à poser des limites.
Il faut également reprendre des activités car en général, les victimes ne font quasiment plus rien et n’ont presque plus de vie sociale.
C’est, en effet, souvent difficile à appliquer dans ce contexte, car il faut se préparer à vivre une véritable guerre. Car lorsqu’il se sent menacé, le pervers narcissique redouble d’efforts et est capable du pire. Attention à la violence, notamment, qui s’invite très souvent dans ce genre de relations.
Mais lutter est le seul moyen de mettre un terme définitif à la relation.
Un autre conseil est de rester le plus calme possible. De ne pas entrer dans le jeu de ce bourreau qui n’attend qu’une chose, que sa victime sorte de ses gonds et perde tout contrôle.
L’indifférence fait également beaucoup d’effet. Il faut apprendre à ne pas répondre. À ne plus réagir. À ne plus se justifier. Ça aussi c’est difficile.

Ne plus avoir aucun contact avec la personne responsable
Ça aussi, on pourrait penser que cela va de soi. Mais c’est encore loin d’être facile. C’est même une étape très difficile, car tant que le pervers narcissique n’a pas trouvé une autre proie, il s’acharnera pour rester dans votre vie d’une façon ou d’une autre, qui peut aller jusqu’au harcèlement.
Un pervers narcissique ne supporte pas l’échec. Ne l’oubliez jamais.
Travailler l’estime de soi
Que l’on se l’avoue ou pas, une femme ayant vécu ce genre de relation n’a plus aucune estime de soi. Déjà, à la base, elle manquait de confiance en soi, là cela va encore plus loin. Elle a perdu toute estime d’elle-même.
Et c’est un véritable frein qui l’empêche de se reconstruire dans tous les domaines de sa vie.
Là encore, toutes les femmes n’en ont pas véritablement conscience… Mais si elles ont vécu avec un tel personnage, elles n’y ont pas échappé.
Se reconstruire, n’est pas du tout évident. Et, ce n’est pas facile d’y parvenir seule. Et le plus souvent, il faut se faire aider par des professionnels.
Au cas où vous souhaitez en apprendre beaucoup plus, je vous conseille le dernier ouvrage de Marion Blique, « J’arrête les relations toxiques ». .
Des séances de sophrologie ou d’hypnose peuvent également aider à la reconstruction. N’hésitez pas à me contacter par le biais de ce blog si vous êtes intéréssés.

Conclusion
Avec le pervers narcissique, au début de la relation, vous penserez sans doute vivre le plus beau conte de fées de votre vie. Mais, malheureusement, vous vivrez aussi le plus violent cauchemar. Sous son masque, il n’a qu’un but, s’emparer de votre territoire, vous broyer pour se valoriser.
Alors pour celles qui en ont conscience, mais qui sont encore dans le déni… Réagissez le plus vite possible.
À très bientôt !
Charlotte Vallet
Sophrologue et Hypnothérapeute à Paris et proche banlieue




